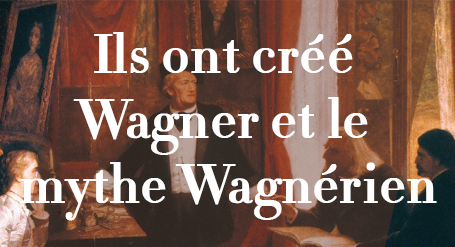
Cette section présente une série de portraits biographiques de ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à l’édification de l’œuvre wagnérienne. Des amitiés ou des inimitiés parfois surprenantes ou inattendues, des histoires d’amour passionnées avec les femmes de sa vie, parfois muses et inspiratrices de son œuvre, mais également des portraits d’artistes (chanteurs, metteurs en scène, chefs d’orchestre…) qui, de nos jours, se sont “appropriés” l’œuvre du compositeur et la font vivre différemment sur scène.
SILJA Anja
(née le 7 avril 1940)
Soprano
Née à Berlin dans une famille d’origine finlandaise, Anja Silja commença à étudier le chant dès l’âge de six ans avec sa propre grand-mère Egon Friedrich Maria Anders van Rijn. Elle donna à dix ans son premier concert au Titania Palast de Berlin.
Phénomène incroyable, elle démarra sa prodigieuse carrière à l’âge de seize ans sur les scènes des théâtres de Braunschweig avec des rôles comme Rosina, Zerbinetta et Micaëla. Deux ans plus tard, en 1958, elle était engagée à l’Opéra de Stuttgart puis celui de Francfort, et en 1960, à seulement vingt ans, elle fit ses débuts à Bayreuth dans le rôle de Senta. D’une présence scénique électrisante, quasi magnétique (elle savait conférer à son Elsa, sa Senta ou son Elisabeth un tempérament farouche, presque halluciné), son chant se caractérisa avant tout par la recherche de la vérité, de la sincérité, de l’expression, même si cela devait se faire au détriment de la ligne vocale.
Jusqu’à la mort de Wieland Wagner, dont elle était ouvertement la maîtresse et l’égérie, elle chanta dans presque toutes ses productions à Bayreuth et en Europe : elle interpréta Elsa de Lohengrin, Elisabeth de Tannhäuser, Eva des Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Freia dans L’Or du Rhin, la Troisième Norne dans Le Crépuscule des dieux, Isolde, Brünnhilde, Vénus… Artiste aux multiples facettes et chanteuse à l’étendue vocale extrêmement étendue, son répertoire comprenait aussi paradoxalement que cela puisse paraître – en marge du répertoire wagnérien – les rôles de Reine de la Nuit (qu’elle chanta en 1959 et qui lui valut d’être qualifiée de Callas allemande ), Fiordiligi, Leonore (Fidelio et La forza del destino), Desdemona, Lady Macbeth, Lulu … avec une voix reconnaissable entre toutes (quoique pour ses détracteurs trop “métallique”) mais toujours droite et inspirée par les talents scéniques indéniables de l’artiste.
A la mort de Wieland Wagner, face à une famille Wagner déchirée, les portes de Bayreuth lui furent fermées. Mais tant d’autres étaient ouvertes : Vienne, Zurich, Barcelone, Berlin, Hambourg, New York, Londres, Paris, Aix-en-Provence, Glyndebourne …
Elle vit aujourd’hui à Paris, dans la maison qui fut celle d’André Cluytens. Avec une longévité professionnelle impressionnante, elle a chanté en mai 2015 le rôle de la vieille dame dans le “Candide” de Bernstein et n’a pas encore chanté sa dernière note !
SB
ANJA SILJA, METTEUR EN SCENE
TROIS ARTICLES TEMOINS DE LA PRODUCTION DE LOHENGRIN AU THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE (BRUXELLES, 1990)
1- QUAND ANJA SE SOUVIENT DE WIELAND
Il y a trente ans, Anja Silja arrivait à Bayreuth. Elle avait tout juste vingt ans. Sa rencontre avec Wieland Wagner sera capitale. Elle partagera sa vie, il la mettra en scène de manière géniale. Dans Freia, dans Senta, dans Elsa, dans Eva, dans Elisabeth à Bayreuth. Dans Elektra, dans Salomé, dans Brünnhilde sur d’autres scènes européennes dont Bruxelles et Paris. A la mort de Wieland elle quittera Bayreuth et, longtemps, ne chantera plus que dans les productions du petit-fils de Richard. Le vieux Klemperer qui effectuera le voyage sur la Colline sacrée pour l’entendre, en fera sa Senta; il aurait aimé enregistrer aussi la Walkyrie. Le magnétisme qu’elle exerçait à la scène ne pouvait se comparer qu’avec celui de Callas. Habitée par les personnages qu’elle interprétait, elle savait leur donner une dimension inouïe. Même l’épisodique Freia dans le dernier Ring de Wieland en 1965 deviendra une composition majeure, toujours présente dans nos mémoires lorsqu’ une nouvelle déesse de la Beauté et de la Jeunesse sera livrée aux géants dans l’Or du Rhin. Après son mariage avec Christoph von Dohnanyi, elle prendra le chemin d’autres scènes et à la Monnaie de Bruxelles elle abordera même l’univers de l’opérette viennoise. Un soir, elle y remplacera au pied levé Sylvia Sass dans Lady Macbeth. Elle pensait un jour y chanter Ortrud mais Gérard Mortier est arrivé à la convaincre de faire ses débuts souvenir des mémorables soirées de l’été 1962 à Bayreuth ? Sans elle, Wieland avait signé un autre Lohengrin presque plus beau, à l’Opéra de Vienne. Allait-elle rendre un hommage dévot à l’ami quí l’avait révélée à elle-même ?
D’une certaine manière, son Pygmalion était présent sur le plateau de la Monnaie. Dans l’esprit du décor, essentiel. Dans le choix des costumes, atemporels. Dans le jeu des acteurs, hiératique. Dans l’utilisation des éclairages, ponctuels. Elle a bien appris la leçon mais une nouvelle maturité et sa sensibilité contemporaine lui ont dicté une lecture très personnelle. Un grand rideau de scène reproduit les vagues mousseuses d’une mer agitée. Le cygne surgira des eaux comme la colombe chez Magritte. Les chœurs de femmes, tout de blanc vêtus, portent les voiles noirs du deuil. Les guerriers arborent des cuirasses grises et de grands boucliers comme jadis dans le Ring de 1965. Lohengrin n’est plus un héros: le fils de Parsifal a davantage l’allure d’un Maître. Elsa n’est pas une princesse, mais une jeune femme désespérée et terriblement seule. Elle regarde avec confiance son sauveur, puis troublée par les propos d’Ortrud, elle n’ose plus croire à son bonheur et les yeux dans le vide, incapable d’en tendre et de voir, se résigne à sa destinée avant de s’effondrer sur le sol.
Tina Kiberg a les attitudes de Silja, son corps élancé légèrement déhanché comme le David de Michel-Ange. Lorsqu’elle apparaît à la fenêtre, le temps de dire son rêve aux étoiles, nous retrouvons le souvenir de Bayreuth en 1962. Silja avait une voix très particulière et une technique aberrante qui lui permettait tout. Tina Kiberg, superbe actrice, ne possède pas un timbre personnel et son Elsa est tout aussi plate que son Agathe au Châtelet. Le médium, parfois sourd, se libère dans un haut médium percutant.
Une légère vibration de la voix lui permet de traduire l’éclair du frisson amoureux, mais son émission de soprano lyrique, capable de beaux piani, éprouve quelques difficultés surtout dans le duo de la chambre, trop dramatique pour elle. L’aigu devient alors incertain et le timbre se déchire. L’Ortrud de Livia Budaï n’est pas le cobra de Varnay dont les morsures étaient fatales, mais plutôt un python qui s’enveloppe lentement autour du corps d’Elsa, l’étouffant sans que sa victime ne s’en rende compte. Seules les imprécations du deuxième acte et la redoutable scène finale accusent d’évidentes limites dans le registre aigu. Josef Protschka affronte Lohengrin avec des moyens insuffisants. Si la fréquentation du chant wagnérien lui permet quelques raffinements dans la ligne, ce ténor lyrique se voit dans l’obligation d’engorger sa voix pour donner de l’épaisseur à son émission et de la consistance à son timbre. Il a tendance à parler dans le récit piano du dernier acte et lorsqu’il doit retrouver l’accent héroïque, l’instrument se fatigue et perd le contrôle de la justesse. Tout à fait problématique le Telramund de Franz Ferdinand Nentwig aux moyens très usés, incapable de soutenir la tessiture aiguë d’un rôle déjà proche de Wotan. Resplendissant, en revanche, le Héraut de Eike Wilm Schulte, autoritaire et vaillant, tout droit venu de Bayreuth, aux côtés du noble Henri l’Oiseleur de Harald Stamm.
Ceux qui se souviennent de l’Orchestre du Théâtre de la Monnaie, avant l’arrivée de Gérard Mortier et de Sylvain Cambreling, auront du mal à reconnaître cette phalange aujourd’hui. Cambreling tient sa formation d’une main de fer en ne lui permettant aucune incartade. A la splendeur des cordes il allie la justesse des cuivres, portant son orchestre au niveau des plus grands. Sa lecture retire toute sensualité au rapport presque cérébral entre Elsa et Lohengrin, et rend le dialogue entre Ortrud et Telramund encore plus prémédité, plus cruel. Il fait également ressortir à merveille les tensions conflictuelles des protagonistes, la rage obsessionnelle du désespoir d’Elsa, sa névrose, son angoisse existentielle. Avec une nervosité, une acuité, voire une violence uniques. Qui oserait encore dire que la France n’a pas de grands chefs ?
Sergio SEGALINI
in Opéra International, avril 1990
2- EN 1962, ANJA SILJA CHANTAIT « LOHENGRIN » sous la direction de Wieland Wagner. Aujourd'hui, elle le met en scène.
Le style de Wieland Wagner, on est peut-être trop jeune ou pas assez favorisé pour l’avoir vu s’épanouir à Bayreuth au début des années 60. Mais on en a entendu parler : hiératisme, intemporalité, transposition de l’univers de Wagner dans un climat abstrait de rêve éveillé, personnalisé par les seules lumières et les allusions picturales.
Anja Silja fut l’une des chanteuses fétiches de Wieland à cette époque. Elle ne chanta le rôle d’Elsa, dans Lohengrin, qu’une fois à Bayreuth, en 1962. Et cette chanteuse impressionnante (force dramatique, voix électrisante, corps de cariatide) a, depuis, mené fort bien sa vie. Loin de Bayreuth. Loin de Wagner.
Qui a oublié sa Marie, dans Wozzeck d’Alban Berg, à Bruxelles puis au Châtelet, il y a quelques années ? Éventuellement dans des rôles légers (Johann Strauss). Elle a épousé le chef d’orchestre Christoph von Dohnanyi. Londres fête, ce printemps, son cinquantième anniversaire. Anja Silja n’est pas près de s’arrêter de chanter.
Simplement, à l’appel de Gérard Mortier, elle a fait un nouveau détour par Bruxelles en ce mois d’avril. Un détour muet. Elle qui voulait se remettre à chanter dans Lohengrin (elle s’était jusqu’alors refusée à réécouter du Wagner depuis la mort de Wieland, en 1966), elle qui était tentée par le rôle sombre d’Ortrud, rôle qu’elle n’avait jamais chanté, Silja s’est finalement retrouvée de l’autre côté de la barrière : à la mise en scène, se souvenant de Bayreuth 1962 comme d’hier.
Elle ne devait pas imiter Wieland. Elle ne l’a pas fait. Ce n’est pas, dans Lohengrin, la féerie, la mythologie qui l’intéressaient (la mise en scène de Bayreuth était, dit-on, à la Monet, une fête mystique étincelante). Certes, le syle Wieland est cité et sa manière très particulière de faire évoluer les chœurs en processions lentes. Mais ce que Silja a voulu analyser, c’est l’incommunicabilité.
L’histoire d’amour impossible entre un demi-dieu inclassable, en tout point différent de notre humanité, fils de Perceval, chevalier du Graal, et une femme comme les autres, curieuse de tout connaître, de découvrir le monde, Eve éternelle tentée par le fruit de l’arbre de la connaissance, amoureuse trop aimante pour supporter d’ignorer l’identité de son chevalier.
Des costumes sombres, bruns ou marron, des gestes dénués d’emphase et de solennité manifestent symboliquement dans la mise en scène de Silja la « banalité » de ses héros. Le chœur des femmes est en blanc, rien d’autre. Déchus de leur dignité au second acte, Ortrud et Telramund portent des costumes de deuil, sans autre précision. Et l’on pourrait presque qualifier ce Lohengrin de « bourgeois » si les soldats brabançons qui composent le chœur ne portaient l’inévitable casque prussien, et le roi Henri la traditionnelle vareuse sanglée du gradé.
La mer omniprésente
Mais ce ne sont là que désignations de fonction, simples allusions à un climat militaire et épique qui sous-tend une bonne partie de la partition (début du premier acte, second tableau du deuxième acte), climat que le décor, ici, s’interdit de confirmer. Car la mer est là, sans arrêt. Soit qu’on la devine derrière les murs du palais et de la cathédrale. Soit qu’elle se reflète sur les hauts piliers pendant que s’élève l’épithalame. Soit qu’elle occupe tout le fond de scène quand s’y dessine, en blanc, la forme immense du cygne, à peine plus insolite qu’un grand nuage, qu’une ombre portée. La mer, c’est la seule part d’irrationnel que s’est permise Silja. Ça, et la mobilité des décors géométriques, panneaux verticaux qui glissent latéralement, murs horizontaux qui disparaissent dans le sol. Ça, et des éclairages symboliquement contrastés : Elsa en pleine lumière, Ortrud dans la pénombre, alors que la musique – au moment le plus inspiré de l’opéra – chante mensongèrement leur solidarité au second tableau du deuxième acte.
Elsa, à la Monnaie, c’est Tina Kiberg. Révélation : jamais le mot ne s’est à ce point imposé. Une révélation déjà repérée dans ce même rôle en janvier dernier par Claudio Abbado à Vienne (Lohengrin était Placido Domingo) ; une révélation déjà retenue par Eva Wagner à la Bastille pour la saison à venir. Mais une révélation que Bruxelles a consacrée : voix solide comme un roc, émotion limpide. Silhouette élancée, port noble, beauté brune, mais beauté comparable à celle d’Anja Silja au même âge. Combien de fois a-t-on eu la chance d’assister, sur une scène d’opéra, à un tel passage de relais ?
Un Lohengrin tchèque (Josef Protschka, ténor jamais passionnant mais stylistiquement juste), une Ortrud hongroise (Livia Budai-Batky, mezzo aux accents parfois superbes, mais trop mélodramatique), un roi allemand (Harald Stamm, jeune voix impériale), un héraut (Eike Wilm Schulte) passé par Bayreuth, composent l’une des distributions le plus « haut de gamme » dont on puisse rêver, malgré un Telramund (Franz-Ferdinand Nentwig) un peu fatigué.
Et l’orchestre ? Dirigé par Sylvain Cambreling, dont la baguette ne cesse de s’assouplir, de s’humaniser, cet orchestre maison se révèle (surtout dans le deuxième acte, composé le dernier et bien supérieur aux deux autres) comme l’une des formations européennes capables de chanter dans Wagner pupitre par pupitre, cuivres et contrebasses compris (sans oublier les aigus arachnéens du premier prélude), de chanter très simplement, sans jamais laisser le rythme s’alanguir. Bientôt (et ce Lohengrin aura été la meilleure des préparations), on pourra voir un Ring complet à la Monnaie.
Anne REY
3 - LES AIGUS DE L'ENFANT PRODIGE : Anja Silja se Souvient de Bayreuth
« Je n’ai chanté le rôle d’Elsa dans Lohengrin qu’une fois à Berlin et une fois à Bayreuth, avec Wieland Wagner, dit Anja Silja. Je n’avais que vingt ans, j’ai fait ce qu’il m’a demandé. Dans l’ensemble, d’ailleurs, les chanteurs ne se posent pas de questions. S’ils ne comprennent pas ce qu’un metteur en scène leur demande et s’ils sont intelligents, ils réclament des explications. C’est ce que font les enfants. Sur ce plan, Wieland Wagner était un père parfait
» C’était à la fois un patron de grande entreprise et une personnalité d’une puissance exceptionnelle. Il avait une vue d’ensemble exacte de ce qu’il voulait voir sur scène, mais il savait aussi focaliser le drame sur des détails très simples, sur des gestes de base, qui expliquaient tout sans presque rien montrer.
» Moi aussi, comme les chanteuses modernes, j’ai chanté beaucoup trop jeune, j’ai accepté des rôles que j’aurais dû refuser. Entre vingt et vingt-deux ans, j’ai été Elektra, Isolde, Brunhilde… personne ne ferait plus cela aujourd’hui. J’ai eu l’aubaine, ensuite, de rencontrer Wieland Wagner et de bénéficier de ses conseils. Mais ma plus grande chance a été la solidité de ma technique.
» Je crois avoir été la plus jeune chanteuse professionnelle : à six ans, je montais sur scène. Entre dix et douze ans, j’ai chanté des arias. A quinze ans, j’ai débuté à l’opéra. Dès ce moment, j’ai tenté ma chance à Bayreuth. Mais il a fallu que j’attende encore quatre ans pour que Wieland m’engage dans le rôle de Senta du Vaisseau fantôme. A dix-huit ans, j’avais fantôme. A dix-huit ans, j’avais été la Reine de la Nuit à Aix-en- Provence.
» J’ai eu mon grand-père pour professeur de chant – il était peintre, officiellement. A six ans, j’avais le timbre très clair d’un enfant, mais, à part cela, je chantais comme un adulte, avec la tenue de voix d’un adulte. On appelle cela un enfant prodige. Mais le vrai mystère, c’est que j’étais capable, si petite, de comprendre exactement ce que mon grand-père attendait de moi, ce qu’il voulait m’apprendre, et la façon dont je devais utiliser ma voix. Ma mère était actrice, et elle a fait la tournée des armées pendant la guerre. Quand elle est revenue, en 1948, j’avais huit ans. Mes grands-parents n’ont pas voulu qu’elle me reprenne. »
» Je n’ai jamais pensé à ma voix comme à un instrument à faire du beau son. Le plus important n’est pas la beauté de la voix, mais sa force, l’émotion qu’elle projette. S’il faut crier pour l’exprimer, je crie. S’il faut faire des choses « laides », il faut oser. C’est pourquoi je hais le disque. Les chanteurs qui enregistrent veulent vendre ce qu’ils chantent. Mais ce n’est pas l’essentiel !
» Adolescente, je pouvais monter dans l’aigu beaucoup plus haut encore que ne l’exige le rôle de la Reine de la Nuit. Ensuite, j’ai perdu… une octave et demie. Cela ne m’a pas empêchée de chanter tous façon dont je devais utiliser ma chanter tous les grands rôles coloratur.
» Tina Kiberg n’est pas une soprano colorature. Mais si elle fait les bons choix, si elle ne chante pas n’importe quoi – comme le fait Jessye Norman en ce moment, par exemple, – elle est la voix « top » du futur. Il y a longtemps que je n’avais vu une telle présence en scène. »
Propos recueillis par Anne REY.
Vous souhaitez apporter des informations complémentaires et ainsi enrichir cet article, contactez-nous !



