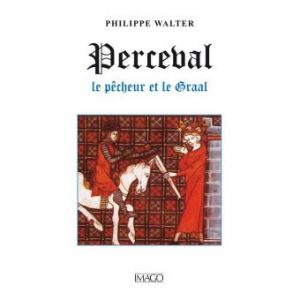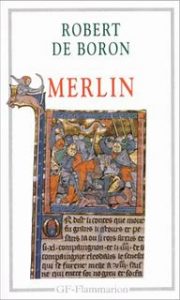Lorsque Richard Wagner s’éteint en 1883, c’est tout un empire artistique et un royaume (celui de Bayreuth) qui menacent de s’écrouler. Conserver un temps comme une œuvre intouchable dans un mausolée, survivre à la disparition du compositeur … parfois même pour mieux y échapper : Cette section raconte l’histoire de l’aventure wagnérienne après la mort du compositeur jusqu’à aujourd’hui, des appropriations des plus douteuses aux créations contemporaines les plus intéressantes.
JULIEN GRACQ ET RICHARD WAGNER
L’HÉRITAGE LITTÉRAIRE DE RICHARD WAGNER

Wagner et Thomas Mann; Emile Zola librettiste : le naturalisme à l’opéra face au wagnérisme ; Wagner et Marcel Proust ; Le Crépuscule des Dieux, roman d’Elémir Bourges ; Julien Gracq et Richard Wagner ; Tolkien et Wagner, les deux enchanteurs
par Françoise DERRE
Les liens artistiques entre Richard Wagner et Julien Gracq sont réels et bien connus alors que leurs deux créations et leurs deux tempéraments sont antinomiques. D’un côté, le flamboiement, l’ouverture au monde, le désir de communiquer au plus grand nombre les résultats de l’effort artistique, de l’autre la retenue, une ardente indifférence au succès, une œuvre qu’on pourrait caractériser d’élitiste. La curiosité qui m’a poussée à ce rapprochement est liée au souvenir d’une belle représentation du Roi Pêcheur au théâtre des Célestins de Lyon, il y a quelques années. Une curiosité d’ailleurs partagée par d’autres : il existe en effet un article paru en 1968, “Thèmes wagnériens dans les romans de J. Gracq”, un autre consacré au “Roi Pêcheur, le Graal ou l’envers de la représentation”, de 1995, également peut-être une thèse de l’université d’Angers. Mon propos n’a pas d’ambition scientifique ; il est seulement de préciser l’opinion qu’avait l’écrivain français du compositeur allemand, la vision qui avait émergé au cours des années, et de risquer une comparaison entre Parsifal et le Roi Pêcheur.
Louis Poirier – car c’est son patronyme, le pseudonyme de 1939 étant emprunté à Julien Sorel et Gracq aux Gracques romains- est né à Saint-Florent-le-Vieil, le 27 juillet 1910, dans une famille de la petite bourgeoisie ; il a fait ses études à Nantes puis à Paris pour intégrer l’ E.N.S. de la rue d’Ulm, après de longues années non indifférentes d’internat. Il choisit d’étudier la géographie et en 1934, le voici agrégé d’histoire et géographie. Il enseignera dans différents lycées, brièvement à l’université de Caen, avec l’interruption de la mobilisation en 1939 et d’un internement en Silésie jusqu’en 1941. En 1970, il fera valoir ses droits à la retraite.
Est-ce là toute sa vie ? Non : il a étudié le russe aux Sciences Orientales, est diplômé de l’Ecole des Sciences politiques, il aime les échecs et le football, il voyage avec sa mère ou sa sœur, hors de France lorsqu’enfin il s’achète une voiture. En parallèle, il a la vie de Julien Gracq : toutes les découvertes qu’il fit en arrivant à Paris, par exemple en 1929 une représentation à l’Opéra de Parsifal, véritable révélation, le cinéma, la littérature contemporaine : Claudel, Gide, Valéry. Des rencontres enrichissent son horizon intellectuel, avec le communisme auquel il adhère en 1936 -mais il renverra sa carte au PCF à l’annonce du pacte germano-soviétique, avec surtout le surréalisme, principalement en la personne d’André Breton. Une étroite relation intellectuelle s’établit entre les deux hommes, sans que jamais Gracq n’appartienne au groupe lui-même. D’autres contemporains retiennent durablement son attention, ainsi Ernst Jünger, André Pieyre de Mandiargue, Jean-René Huguenin, bien d’autres. Car entre temps, il est devenu un écrivain réputé : en 1959 paraît chez le libraire José Corti, éditeur des surréalistes, Au château d’Argol, puis Un beau ténébreux, en 1945, qui obtient trois voix au prix Renaudot. Le Roi Pêcheur paraît en mai 1948 et un an plus tard, la pièce est montée au théâtre Montparnasse. La notoriété ne viendra cependant qu’en 1951 avec Le rivage des Syrtes, entachée de scandale d’ailleurs car J. Gracq refuse le prix Goncourt qu’on lui a décerné. Une autre œuvre romanesque voit le jour en septembre 1958, Le balcon en forêt, qui replonge le lecteur dans la période de la drôle de guerre. Avec plusieurs recueils de nouvelles, des poèmes en prose, cela est l’essentiel de ses œuvres de fiction. Mais sa production d’essayiste l’emporte peut-être en volume : une étude sur A. Breton, La littérature à l’estomac, où il règle ses comptes avec la critique littéraire officielle, une traduction du Penthésilée de Kleist, et une floraison d’écrits mi-autobiographiques, mi- critiques solidement étayés de réflexion philosophique. Toute cette oeuvre remplit deux tomes de la Pléiade, car l’auteur fut publié de son vivant dans la prestigieuse collection, en 1989 et 1995. Julien Gracq est mort en décembre 2007.
Dans ses écrits critiques, dans des entretiens accordés à des journalistes et hommes de lettres, Gracq s’est volontiers confié sur sa formation, son évolution, ses goûts. On peut ainsi relever de fréquentes allusions à Wagner, que je voudrais vous communiquer, malgré le caractère fastidieux de citations successives.
Dans un entretien avec Jean-Paul Dekiss, de 2000, Gracq expose en peu de mots quels furent ses éléments formateurs : “Il y a eu pour moi Poe quand j’avais douze ans, Stendhal quand j’en avais quinze, Wagner quand j’en avais dix huit, Breton quand j’en avais vingt-deux. Mes seuls véritables intercesseurs et éveilleurs. Et auparavant [.. .], il y a eu Jules Verne. je le vénère un peu filialement.” L’écrivain est parfois moins lapidaire et se penche, avec Jean Roudant en 1981 sur les années de sa jeunesse : “Ce qui a compté dans ma formation, à côté de la littérature, c’est la musique et exactement l ‘opéra. J’ai été élève du lycée de Nantes de 1921 à 1928. Il est très difficile aujourd’hui de se représenter la place que tenait alors l’opéra dans la vie « culturelle” d’une ville de province. Il y avait une troupe engagée à l’année et qui jouait d’octobre à juin chaque soir […]. Ce qui représentait l’évasion, le rêve, c’était l’opéra plus que le cinéma). Naturellement, le répertoire était celui de la province : Massenet, Gounod, Bizet, Meyerbeer, Puccini, Ambroise Thomas […].
Lorsque j’ai découvert Wagner et Parsifal à dix huit ans, j’ai eu la même impression qu’en passant de Jules Verne à Edgar Poe. […] L’opéra avec son emprise totalitaire sur son public -le livret, le texte, les décors, l’action, la musique- est sans doute resté pour moi l’image même en art de l’indépassable en même temps que de l ‘ébranlement affectif maximum. […] .Wagner est sans doute plus propre qu’un autre musicien à provoquer une fixation exclusive, surtout chez quelqu’un qui n’a comme moi, qu’une culture musicale tout à fait sommaire. Plus d’un musicien, on le sait, le considère comme un musicien pour littérateurs. Il est de fait qu’il tend la main à la littérature par l’intermédiaire du théâtre, puisque le drame chez lui est création de part en part et non un livret qu’on met en musique. Le texte de ses drames avait pour lui autant d’importance que la partition. Mais si je reviens toujours à Wagner, c’est certainement, entre tous les musiciens, comme à celui dont l’énergie créatrice se transforme presque tout entièrement chez l’auditeur plutôt qu’en plaisir de l ‘oreille, en émotion, en ébranlement émotif généralisé. Il est une source inépuisable d’énergie émotive. C’est ce qu’il a pour moi d’irremplaçable ; j’admets fort bien que d ‘autres lui en fassent grief ”
Ces dernières phrases se détachent fortement de la banalité des propos antérieurs. Un peu plus tard, en 1986, un autre interlocuteur, Jean Carrière, le questionne sur ses rapports avec la musique. Gracq rappelle qu’il n’a jamais su jouer d’un instrument. « La musique est un goût qui est resté chez moi à l’état sauvage, tout en m’envoûtant. Et c’est un goût qui est resté aussi sans doute à l’état impur, avec beaucoup de ponts jetés en direction de la littérature et de la poésie. Wagner, qui m’a fasciné dès que je l’ai connu, est dramaturge de part en part, et quel dramaturge! Personne pour faire comme lui déboucher naturellement sur le mythe une construction dramatique à la fois simple et puissante. ” Gracq aborde aussi un aspect plus concret de l’opéra en général ; il s’élève contre “ l’impérialisme arbitraire et parfois presque délirant des metteurs en scène, impérialisme qui semble ne rencontrer aucune résistance ni du côté des auteurs ni de celui du public, mais qui m’a obligé plus d’une fois à quitter la salle vers le premier entracte. » Il ressort clairement de ces confidences que Gracq admire profondément, à sa manière très personnelle, la création wagnérienne.
Mais c’est dans ses essais et œuvres critiques qu’il formule avec le plus d’acribie, de pertinence, et parfois de malignité ses impressions d’auditeur et de spectateur. En voici quelques aperçus, en commençant par un reproche fréquent auquel il n’adhère pas. Dans le recueil En lisant en écrivant, paru en 1980 et réunissant des réflexions des années 1974 à 1979, il aborde l’antisémitisme prétendu du compositeur allemand : “Les griefs les plus durs qu’on lui fait sont les moins établis. Son antisémitisme musical, né si longtemps avant l’affaire Dreyfus, ne tirait guère à conséquence : vers 1925, il se trouvait des compositeurs pour déclamer contre la musique “nègre” qui n’ont jamais pour autant été interdits d’opéra. Jamais Wagner ne s’est séparé d’un collaborateur ou d’un ami parce que: le choix obstiné de Levi pour conduire son testament musical, Parsifal, choix maintenu malgré pressions et lettres anonymes qui accusaient le chef d’orchestre de coucher avec Cosima, est plutôt noble. Sa culpabilité par contact avec Hitler, fanatique de ses œuvres, ne supporte même pas l’examen. ” Auparavant, Gracq avait soulevé un autre reproche, les rapports à l’argent : “Il y a dans l’attitude de Wagner vis-à-vis de l ‘argent quelque chose de Dieu le Père redescendant sur terre pour faire la manche en arguant d’une rallonge au sixième jour: Tirer de l’argent des poches où il s’en trouve, comme on met en perce des futailles, de plus en plus d’argent enfin énormément d’argent, est la forme galopante qu’a prise chez lui la malédiction de l ‘or. Le goût des robes de chambre en soie de Chine, puis des meubles et des domestiques, puis des palais vénitiens, puis des sanctuaires dramatiques « personnalisés »a certes sa logique de progression propre, mais on sent qu’il a aussi pour fonction cachée de remonter chaque fois la mécanique […] de la fuite en avant, la course du lévrier qui décuple en même temps et tient en respect la meute créancière. Un roi de conte de fées qui tombe dans son jeu par magie n’y change rien, que d’élever brutalement le niveau des relances : il y avait là une de ces plaies d’argent qui passent pour non mortelles sans doute parce qu’elles ont les meilleures raisons du monde de ne mourir qu’avec vous ». Et Gracq de conclure avec un certain amusement sur ces deux reproches : “Il a signifié le premier, plutôt impérieusement, que le génie avait le droit de formuler certaines exigences matérielles : qui s’en plaindrait ?Et fait monter à des taux inconnus le chiffre des réquisitions de la gloire : infiniment moins tout de même que Picasso.”
En revanche, point d’indulgence à propos d’un autre phénomène. Dans Lettrines, recueil de 1967, il cite d’abord Nietzsche dans son Ecce Homo : “]e dis que Wagner a été le grand bienfaiteur de ma vie ”, puis : “je me réveillai un jour à Bayreuth… Où étais-je donc ?Je ne retrouvais rien ; c’est à peine si je reconnaissais Wagner” Et Gracq d’emboîter le pas : “On ne peut aimer aujourd’hui Wagner que malgré. Que d’objections contre lui qui nous hérissent ! Il a donné la dernière touche – avec mille complaisances – moins à un style qu’à un signalement du génie le moins supportable qui fît jamais. Il a exercé le sacerdoce de l ‘art dans une cour du Bas Empire : parfums lourds, sirènes raides, encensoirs, brocarts de sacre, diadèmes et tiares et tout ce que l’érotisme sénile mêle à l’encens de subtilement énervant. Plus que tout autre, il est responsable de ce rite impudique : le pèlerinage d’art (Il cite Lavignac). Il est le premier à qui on ait dit des messes, le premier qui ait interposé dans ses rapports avec le public l’entremise d’une liturgie obligatoire et compliquée. Le premier à recruter ce public non par choix, mais par initiation […]. L’abîme mystique, les triduums d’art chaperonnés par l’agence Cook, la défense d’applaudir à Parsifal, le piédestal du roi fou, l’heure sacrée où Richard Wagner mourut à Venise, le béret de velours noir et la robe de chambre asiatique et puis la queue : les Feuillets de Bayreuth, Sâr Péladan, la crinière d’André Suares -voilà quelques-unes des images peintes sur l ‘écran dont notre regard se détourne.
Il l’a mis en place lui-même. Ou du moins, il n’a rien fait pour l’écarter. Son œuvre retombe sur lui et sur sa famille comme un manteau de sacre. Le succès de Bayreuth, aussi foudroyant que Lourdes […] : il faut y venir ; il faut fréquenter. Il n’y avait avant personne comme Wagner pour faire toucher, pour insister, pour vouloir qu’on vous miraculât. Comme il a souhaité que sa gloire existât !
Prenons tout de même garde. Presque toutes nos objections à Wagner s’appellent non Wagner mais Bayreuth . Ce n’est pas Wagner qui s’est démodé mais Bayreuth. C’est cette part de lui qui a construit Bayreuth, et, l’ayant construit, s’est préoccupé vraiment outre mesure d’y recevoir; d’en faire les honneurs. Wagner en art est un prophète qui s’est voulu un ordinateur du culte. Il est le premier artiste génial à oser nous dire : ce n’est pas tout d’admirer; voici comment il faut que vous m’admiriez.”
Toujours dans le même article, Gracq avoue comment il ressent la musique du compositeur : “La musique de Wagner est une technique instinctive du spasme, la reprise monotone, fiévreuse intolérable, juste au défaut de l’âme, d’une passe acharnée (La mort d’Isolde, l’interlude de Parsifal, le prélude de Lohengrin, celui de l’Or du Rhin). Nulle n’entraîne un aussi terrible gaspillage nerveux […] Wagner corrode, digère, assimile, “wagnérise” beaucoup de choses, plus qu’aucun autre musicien. Le halo wagnérien, le murmure de forêt vierge […]. Ici Wagner commence, et après tout ce qu’en peut dire le dépit amoureux, il reste que trois mesures de lui sont encore ce qui s’élève parmi les sons de plus malaisément confondable – avec la rumeur de la mer, perçue dans l’extrême lointain.”
Au hasard des lectures, on rencontre encore de nombreuses références wagnériennes à des œuvres déterminées, Siegfried et Parsifal rapprochés de la Penthésilée de Kleist, sur le Vaisseau fantôme dans les Carnets du Grand Chemin, publiés en 1992, ce qui atteste la permanence de l’intérêt de l’écrivain pour le musicien ; ou bien sûr la première représentation de Lohengrin à Weimar, ou encore une comparaison entre “le culte idolâtre” rendu par des docteurs ès musique à Mozart, Bach et Beethoven et le dédain des mêmes pour Wagner, ce qui amène cette réflexion : “Peu m’importe qui est le plus grand : ce qui est sûr pour moi, c’est qu’il y a dans Wagner un au-delà de Beethoven. ”D’une liste loin d’être épuisée, terminons ce survol des considérations wagnériennes de Gracq par une formule étonnamment claire ; dans le recueil En lisant en écrivant, il a parlé de Balzac dans l’œuvre duquel il fait un choix et continue : “De même, « j’aime Wagner » signifie pour moi en réalité: Parsifal et Lohengrin ôtés dont je ne retrancherais pas une note et partiellement Tristan, je n’ai envie que de grappiller ça et là dans le reste quelques motifs, quelques scènes, quelques passages d’orchestre isolés ; la Tétralogie, son climat, ses héros, son intrigue me restent aussi étrangers qu’une saga traduite du finnois ou du vieil islandais.”
En guise de charnière avec la deuxième partie de cet exposé, voici deux courtes références qui témoignent – l’une très concrète, l’autre purement affective – de la préférence de Gracq pour Parsifal . Elles appartiennent toutes deux aux Carnets du Grand Chemin. Voici la première : Gracq s’exprime sur l’opéra filmé, critique le Don Giovanni de Losey et continue : “C’est en quoi la solution du décor-valise de Syberberg. dans Parsifal (de 1982), malgré ses partis-pris provocants et outranciers , restait séduisante : le refus de tout lointain (où l’intensité musicale se dilue), la manière qu’avait l’action de planter ses tentes, selon les moments, sur tel méplat, ou tel repli du masque wagnérien conservait au drame musical, à chaque instant, une clôture souple et amovible, le préservait des courants d’air déstabilisant qui sont le prix de la beauté paysagiste et architecturale formelle de Don Giovanni ». La seconde référence : « Rêve cette nuit- malheureusement interrompu par un réveil prématuré – tant la sensualité religieuse et le génie liturgique atteignaient à leur manière aux plus hauts moment de Parsifal.”
Ce n’est pas seulement Wagner qui a déclenché l’intérêt de Gracq pour la légende du Graal. Depuis toujours, l’écrivain a préféré la littérature médiévale à celle de l’antiquité grecque et romaine ; cette dernière crée des mythes qui sont “des procès-verbaux implacables d’échecs”, tandis que les mythes ouverts du Moyen Âge racontent des “tentations permanentes et récompensées”. Dans la littérature médiévale, Gracq aime le caractère irrationnel, et certes, les Romans de la Table Ronde n’en manquent pas. Le conte du Graal en particulier surgit de façon diffuse dans maintes créations gracquiennes, sous forme de comparaisons, de citations ou d’images. Ce conte vient du fond des temps, et, comme le dit un spécialiste, “le paganisme des forêts reste vivace malgré l’emprise du christianisme” et plus tard malgré les efforts méritoires d’un Chrétien de Troyes, d’un Wolfram von Eschenbach pour canaliser et christianiser tant d’aventures rocambolesques des chevaliers merveilleux. Gracq ne résiste pas au surnaturel omniprésent et tout-puissant des récits qui se moquent de l’histoire.
Parmi tous, le personnage de Perceval est en soi si complexe qu’il a donné lieu à une étude du médiéviste Philippe Walter, intitulée Perceval, le pêcheur et le Graal, un travail d’une érudition et d’une audace confondantes, s’appuyant sur l’étymologie, la linguistique, le structuralisme, procédant par analogie entre les mythologies chrétienne, indo-européenne, amérindienne, eurasiatique pour aboutir à une vision surprenante des protagonistes du conte. Voici, à titre d’échantillon, quelques lignes tirées de l’épilogue : “C’est l’histoire d’un roi malade qui ne guérira peut-être jamais tant que Saturne hantera le ciel. Pourtant, face à Perceval, le roi méhaigné, silencieux et mélancolique, attend sa rédemption. Le pêcheur est devenu pécheur, victime d’une fatale faute […]. La lance qui saigne, comme si elle avait été blessée dans sa chair, mime la plaie suppurante du Roi Pêcheur lui-même blessé dans un combat. Cette blessure a affecté sa virilité : elle est une castration, comparable à celle de Cronos-Saturne. Le Roi Pêcheur, éminente figure saturnienne, a ainsi été féminisé. Le sang de la lance qui saigne devient dans l’imaginaire du récit un sang féminin. (Le bas de son corps participe du poisson. Mais la blessure qu’il a subie à tous les caractères d’un saignement menstruel – Ph. Walter se réfère là à un article de C. Gaignelet, A plus haut sens) […] Pourtant cette castration réelle ou symbolique du saturnien Roi Pêcheur donne un pouvoir singulier de connaissance suprême, comme si toute révélation vers le cœur des secrets du monde devait se payer d’une mutilation sexuelle […]. La mélancolie de Perceval représente le moment clé du récit. C’est l’instant décisif où bascule le destin royal du héros qui s’ignorait. C’est le moment où s’affirme sa vocation mélancolique et saturnienne.”
Cette bien longue citation, va s’avérer utile pour comprendre l’intention profonde de Gracq.
Revenons à quelques mots plus classiques pour éclairer l’œuvre de Chrétien de Troyes, composée vers 1180 : le récit a longtemps été considéré comme inachevé, ce que contestent certains médiévistes actuels. Chrétien de Troyes partageait la quête du Graal entre deux héros, les chevaliers Gauvain et Perceval, dont les destins se complètent plus qu’ils ne s’opposent. Le premier, Gauvain, est engagé dans de trop multiples aventures terrestres pour accéder au rôle du prêtre du Graal, et le deuxième trop simple pour aller au bout de l’entreprise spirituelle. Perceval, en effet, interdit devant la splendeur du Graal qui passe et repasse devant lui, ne pose pas les questions fatidiques : qui le Graal sert-il ? Pourquoi saigne la lance ? Le lendemain matin, il voudrait se renseigner sur ce qu’il a vu la veille, mais le château est désert, les portes fermées. Son cheval sellé l’attend, et le chevalier s’en va déçu et frustré. Les rencontres qu’il va faire vont lui permettre de deviner son nom, qu’il ignorait jusqu’alors; bientôt il souhaite retrouver le Graal et percer son mystère. Mais sa recherche – début de l’idée de Quête – restera vaine. Cinq années plus tard, un peu avant le jour de Pâques, il croise la route d’un ermite (son oncle maternel) qui le confessera et lui révélera que le Graal contient une hostie, nourriture du père du Roi Pêcheur.
Deux textes en vers, appelés “continuation”, du XIIIème siècle, reprennent le sujet ; le premier ne s’intéresse qu’à Gauvain, l’autre accorde un deuxième passage salvateur de Perceval chez le Roi Pêcheur.
A coté de ces poèmes, existe au XIIIème siècle une énorme production en prose, la trilogie de Robert de Boron (Joseph, Merlin, Perceval), le cycle du Lancelot-Graal et la Queste del Saint Graal, où l’on assiste à une christianisation radicale du sujet, par exemple par l’intervention de Joseph d’Arimathie, le “créateur” du Graal, et par le rôle prépondérant non plus de Perceval mais de Galaad, seul assez pur, étant du lignage du Christ, pour accomplir la promesse de sauver et de maintenir le culte du Graal. Ainsi ces versions plus tardives bousculent l’équilibre entre merveille et miracle qui caractérisait l’œuvre de Chrétien de Troyes. Au XIIIème siècle également, Wolfram von Eschenbach se rattache au texte de son prédécesseur du XIIème siècle, Chrétien, non sans en modifier des détails importants. Il donne au roi méhaigné le nom d’Amfortas, fait intervenir une sorcière dont l’aspect monstrueux n’a presque plus rien d’humain mais à l’âme pure et noble, Cundrie. Chez l’auteur allemand, le Graal est une pierre, “lapis exillis”, aux vertus magiques, dont celle d`empêcher de mourir toute personne en sa présence; aux privilégiés, elle fournit en abondance boissons et aliments exquis. Mais surtout, au livre IX de l’œuvre , Wolfram fait apparaître un ermite, Trevizent, oncle de Parsifal, vers lequel son cheval mène le jeune chevalier qui ne sait plus en quoi réside sa quête. L’ermite fournit des explications familiales et spirituelles, absout Parsifal de ses péchés, de sorte que ce dernier peut retourner au château du Graal. C’est là la différence essentielle par rapport au récit de Chrétien: Parsifal posera la question fatidique :“Bel oncle quel est donc ton tourment ?” A ces mots, on vit sur le visage d’Amfortas “ces couleurs que les français, dans leur langage, appellent un teint fleuri” (flôre, en allemand).
Amfortas est guéri, Parzival devient le roi du Graal. Le rejoint à Montsalvage son épouse Condwiramour, accompagnée de leurs deux enfants, dont le chevalier-roi fait maintenant la connaissance : Kardeis et Loherangin dont la mission sera de sauver une duchesse de Brabant.
Dans Parsifal, Wagner s’inspirera très librement du récit en près de 25.000 vers de Wolfram von Eschenbach, dont il n’ignore pas les faiblesses et qu’il nomme “le poème confus et stupide de Wolfram… ce superficiel profond qui n’a rien compris au contenu essentiel de la légende”. Il en élimine les digressions, en accentue le caractère religieux et inclut dans son “Bühnenweihfestspiel” un personnage de grande signification humaine, symbolique et mythologique, Kundry. Comme ce n’est pas le propos ici de passer en revue les exégèses qui président à la relecture du Parsifal de Wagner et à ses mises en scène contemporaines, nous nous référerons, pour rendre possible la comparaison avec la pièce de Gracq, à la vision classique de l’œuvre, imprégnée de christianisme et portée par l’idée de rédemption grâce à un sauveur, telle qu’elle apparaissait par exemple dès 1898, à un commentateur français, Henri Lichtenberger.
Lorsqu’on rapproche les deux œuvres, d`emblée une différence s’impose : celle de leur titre, Parsifal d’un côté, le Roi Pêcheur de l’autre. Il est clair que Gracq choisit Amfortas pour protagoniste. De ce choix, toute l’évolution de sa pièce en quatre actes va découler. Le premier acte se déroule dans la salle d’armes du château de Montsalvage. Quelques chevaliers devisent en attendant d’aller prendre leur tour de garde; ils se plaignent de la brume, du silence, de la forêt étouffante, de leur inaction. Ils en rendent responsable leur roi qui expie sa faute, tout en ayant pitié de lui. Ils espèrent encore un miracle qui ranimerait le service du Graal et leur rendrait leur jeunesse. Kundry parait, ainsi que Clingsor sous un déguisement de chevalier; il apprend à la jeune femme qu’il a rencontré dans la forêt le prédestiné, le Pur, et qu’elle doit le détourner de sa mission car elle est “belle, toujours, à lui en faire perdre l’esprit”. Elle refuse: bien que sensible au charme pervers de la déchéance de Montsalvage et de son roi, elle veut voir renaître la gloire et la vie : “J’attends le triomphe du Graal.” On amène alors Amfortas sur une litière, suivi de son bouffon Kaylet, un enfant un peu boiteux. A ce compagnon, le roi confie son espoir : “Tu crois qu’il viendra, le très Pur ?”. Puis, se parlant à lui-même : “Oui, il viendra, c`est la Promesse. Il faut qu’il monte et que je descende…” Alors reparaît Clingsor, l’eunuque, qui annonce au roi la nouvelle inespérée: il a rencontré celui qui va le guérir. Et il commente ainsi ce qui va advenir : “tu seras comme les aveugles guéris à qui la lumière du jour est brûlure. . .Tu as régné, mais c’est fini, Amfortas, fini. Il faut disparaître, il faut t’effacer.” Si son maître le désire, il se fait fort d’empêcher la venue du sauveur. Le roi se dit prêt à recevoir le salut, mais résume sa vie d’une façon ambiguë : “Tu le sais, on m’appelle ici le Roi Pêcheur. Je me fais parfois mener en barque, à l’ombre des saules. […] Mes chevaliers chassent dans les bois et le roi jette les filets comme un pauvre. Parfois je prends quelque poisson… Va- t’en, Clingsor je te pardonne, laisse-le venir…”
Ainsi s’achève le premier acte, acte d’exposition très réussi au plan technique. Le spectateur est plongé dans une temporalité vague, un Moyen-Âge attesté par des chevaliers, un eunuque-magicien, un ermite aussi dans la forêt voisine. L’espace s’accorde à cette notion imprécise du temps : un château-fort, non loin d’un lac, dans le brouillard. Et le nœud de l’action se dégage sans peine des dialogues: ainsi la léthargie où sont plongés royaume et personnages est la conséquence d’une faute commise par le roi, concrétisée par la blessure purulente – mais d’une faute rachetable puisqu’un sauveur est promis. Remplira-t-il sa mission, malgré de possibles embûches ? Il faut garder à l’esprit les derniers mots du roi à la fin de l’acte, prononcés du bout des lèvres : “Laisse-le venir…”
Le deuxième acte va permettre la rencontre de l’autre protagoniste, Perceval, revêtu d’une armure blanche. La scène est au bord du lac, près de la cabane de l’ermite Trévizent. Les deux personnages se saluent et bien vite, Perceval révèle avec exubérance sa nature profonde : “C’est ma vie cela: désirer et satisfaire enlacés comme la bouche à l’air, comme les doigts de la main à la poignée de l’épée.” Impulsif, extraverti, “enivré de sa jeunesse” comme dit l’ermite. Il se nomme Perceval le Gallois et révèle le but qu’il poursuit: conquérir le Graal. Trévizent met alors toute son éloquence et sa sagesse en œuvre pour détourner le jeune homme de son entreprise : “Quoi que je sache du Graal, il ne me serait pas permis de te le dire, et tu n’apprendras rien de moi. Je suis du parti qui a renoncé. J’ai choisi la mort tranquille- la certitude.” Le vieil homme préfère la résignation au désir, ce qui n’entame en rien la résolution de Perceval : “Je délivrerai le Graal dans ce monde ou dans nul autre, à jamais. » Il se dirige vers le lac où Amfortas et son escorte tirent de l’eau un énorme poisson. Perceval, grand bavard, raconte à ce seigneur inconnu son projet : “Vous avez entendu parler du Graal ?” Amfortas ne se trahit pas, lui montre cependant sa mystérieuse blessure, et l’invite à Montsalvage, où va l’accompagner Kundry qui les rejoint soudain. Le jeune chevalier en est tout surpris : “ Vous êtes si belle… Je suis si étonné(…). Dans ce bois perdu, je me suis cru au bout du monde”.
A la fin du deuxième acte, tous les actants du drame sont en place : un jeune idéaliste confiant en son étoile que ne sauraient freiner les propos quiétistes d’un vieil ermite, un roi, mais un homme souffrant, apparemment épris de sa souffrance et plein de dissimulation, une femme mystérieuse, expérimentée, émue par la naïveté du jeune homme de seize ans.
Le troisième et le quatrième actes se déroulent dans une salle du château de Montsalvage. Perceval ne se sent pas à l’aise entre ces murs qui lui semblent être un “fantôme de pierre”. “J’ai peur de ce roi qui jette les filets et de ce château qui vous prend au piège, et de ce sang partout sur les étoffes, qui n’est pas le sang rouge des batailles, mais le sang pourri de la femme malade… le sang d’Amfortas !” Le roi survient, alors s’engage une longue conversation où Amfortas essaie d’expliquer la malédiction qui pèse sur le monde : “Montsalvage est très vieux et Montsalvage ne bouge plus guère, et l’ombre y gagne et le couvre comme un drapeau noir parce que les coups d’épée et les aventures et le Graal, tu les vois devant toi, libres et dansants dans la lumière et qu’il contemple les choses faites, les élans retombés, les gestes pétrifiés […] le destin scellé !” Avec amertume, il affirme au jeune homme qu’ils se ressemblent tous deux, à deux étapes de leur destinée. Horrifié par cette sentence, Perceval bouscule le roi dont la blessure se rouvre. Le jeune homme la découvre et recule de dégoût. Il faut appeler Kundry pour la soigner. Le roi précise encore : “Kundry ne soigne que les blessures qu’elle a faites. Ce que tu as désiré, je l’ai fait. (Avec un rire sauvage) Je suis là pour qu’on voie ! Je suis celui par qui le scandale arrive!” Perceval, comme étourdi, quitte la salle. Restés seuls, Amfortas et Kundry ont un entretien véhément.
Elle reproche au roi de ne pas avoir montré le Graal au jeune homme pur. Il est trop tard, rétorque Amfortas. Elle réplique : “Parce que tu ne le veux pas ! Parce que tu es là devant à monter la garde, comme une araignée venimeuse dans sa toile.” Autre argument : “Aie pitié. Est-il possible que tu te complaises dans ce supplice ? Que tu te plaises à tout tuer autour de toi, à en mourir, jour après jour ? Si tu n’as pas pitié de toi, n’as-tu pas pitié de nous, de Montsalvage ?”
Rien n’ébranle le Roi Pêcheur. Il sait que “l’espoir en la Promesse n’est plus une planche de salut, c’est un plancher où on marche. […] Et quand l’espoir est devenu un vice, il y a, à l’exaucer, crois-moi, le danger le plus grave. ” Non, il ne méprise pas ses sujets : le Graal n’est pas fait pour la terre. “Ce que tu appelles bienfait, je l’appelle malédiction. […] Le Graal est devenu le rêve du monde. Je ne veux pas en faire l’exterminateur.” A la fin de cette scène très pathétique, Amfortas annonce à ses chevaliers qu’il officiera ce soir, selon la Promesse et en dépit de la souffrance que cela lui coûte. Kundry envoie en cachette le petit Kaylet rattraper Perceval qui s’éloignait du château et convainc le Pur de participer à la cérémonie. Il s’endort de fatigue et d’émotion. Elle “le couvre d’un manteau avec des gestes maternels” et le regarde dormir et murmurer dans son sommeil : “Herzeleide… Montsalvage… Kundry !… Le Graal !”
On comprend l’importance de cet acte, où Amfortas refuse le salut au nom d’un immobilisme qui se déguise en pitié pour la faiblesse humaine. Au point de vue théâtral, l’extrême fin de l’acte ranime – ou anime – une action très réduite et étouffée par de longs, trop longs, dialogues. L’intervention de Kundry va-t-elle porter ses fruits ?
Au début du quatrième acte, sans coupure temporelle avec le précédent, Perceval rêve, entend les voix discordantes des êtres qu’il a rencontrés ce jour, signe de l’immense confusion de son esprit d’où a disparu toute certitude. Les suivantes de Kundry, “très jeunes, presque des enfants” précisent les didascalies, surviennent pour le préparer à la cérémonie, le vêtir du grand manteau blanc, une scène pleine de grâce, de spontanéité, sans la moindre connotation ambiguë. Le jeune homme est prêt lorsque paraît, marchant avec peine, Amfortas, “revêtu d’un splendide manteau royal, rouge sang”. Dernière épreuve pour le jeune chevalier. Amfortas joue cartes sur table : “Perceval, si tu le veux, tu seras tout à l’heure roi du Graal” Eblouissement du jeune homme. Mais son adversaire – car c`est ainsi qu’il faut voir Amfortas – s’emploie à lui dépeindre la puissance insupportable, intolérable du Graal : “Tu oublieras tout l Où tu vas, il n’est plus de souvenir […] Tu seras seul à jamais ! Le Graal dévaste !… Kundry mourra ! Tout se qui est impur se dessèche où brille le Graal. » Perceval réagit avec lucidité : “Ainsi c’est ta dernière ruse. Avant de me céder la place, tu cherches à me désespérer. […] Tu m’as empoisonné le cœur. Est-il à ce point terrible de régner sur le Graal ? Oui Perceval… Terrible… Il est terrible pour un homme que Dieu l’appelle vivant à respirer le même air que Lui.” Au bord de la folie, Perceval accompagne le roi dans la salle voisine, éblouissante de la lumière qui émane du vase sacré. Les portes se ferment devant la curiosité légitime du spectateur : malgré tout, en présence du Graal, Perceval va-t-il poser la question fatidique ? Kundry reparaît pleine d’angoisse: elle obtient de Kaylet, l’enfant-bouffon, qu’il épie par une haute fenêtre la cérémonie qui se déroule dans la salle voisine. L’enfant voit le roi, ses chevaliers, Perceval tout pâle. Le Graal paraît, Perceval s’agenouille et ne dit rien. La cérémonie est terminée, les portes s’ouvrent. Amfortas reparaît, Kundry devine que Perceval est parti et le reproche amèrement au roi qui répond : “Non, Kundry. Celui que Montsalvage attendait – c’était un simple. » Il lui pose la main sur le front : “ Ne pleure pas. La folie du Graal n’est pas éteinte… Un autre viendra…” La pièce se clôt sur les mêmes paroles dérisoires qu’au tout début : “Espérance dans le Sauveur ! Rédemption à Montsalvage.”
Ainsi, la pièce de Julien Gracq n’a guère de ressemblance dramaturgique et encore moins de ressemblance conceptuelle avec le “Bühnenweihfestspiel” de Wagner. Elle est un avatar d’une notion immémoriale présente dans diverses mythologies : l’idée de Quête, d’Aventure, cette fois transcrite dans la “Weltanschauung” d’un homme du XXème siècle. Ce serait, en effet, faire injure à Gracq de ne donner à son œuvre qu’un substrat psychologique, à savoir : mieux vaut endurer le mal pour régner que de perdre la possibilité même de régner ; Amfortas ne voudrait pas de successeur, ne songerait qu’à satisfaire une ambition dévorante entachée de masochisme.
On peut rejeter cette interprétation en rappelant que c’est l’audition de Parsifal à l’Opéra de Paris qui a profondément touché le futur écrivain, alors âgé de dix-neuf ans. Dans l’Avant-Propos à l’édition de la pièce, presque vingt ans plus tard, Gracq redit son admiration devant la “toute-puissance de transfiguration” dont dispose Wagner quand il modèle à sa guise le mythe médiéval, en précisant qu’il s’agit d’une puissance semblable à celle d’un jeteur de sons : “Wagner est un magicien noir, c`est un mancenillier à l’ombre mortelle, des forêts sombres prises à la glu de sa musique, il semble que ne puisse plus s’envoler après lui aucun oiseau.” Gracq ajoute bien vite : “Il reste pourtant que cette matière n’est pas épuisée.”
Ainsi, dans les années 1942-43, le Roi Pêcheur prend forme après que l’écrivain ait réuni une solide documentation : il a lu en traduction le Parsifal de Wolfram von Eschenbach et toutes les versions françaises précédentes ou contemporaines, depuis Chrétien de Troyes jusqu’à la Queste du Graal. Il va y puiser de façon tout à fait arbitraire, sans respecter aucune contrainte de lieu, de temps, ni même de personnages. Il n’en respectera pas plus l’esprit, celui d’une Rédemption par un Sauveur. Pour employer une tournure à la mode, il revisite le mythe. Que sort-il de cette innovation ?
D’abord, une réaction liée à l’époque où est créée la pièce, 1949 : le surréalisme n’est pas mort encore, ni son initiateur et guide, André Breton. De tous les livres de Gracq, c’est celui que Breton a le plus aimé : “Le Roi Pêcheur est une merveille. Vous n’avez jamais rien donné d’aussi beau. L’atmosphère du drame est inouïe, le lieu est sublime, ce paysage-plaie annule tous les autres.” Enthousiasme assez peu éclairant. Mais il est vrai que Gracq établit un parallèle entre la quête du Graal et les aspirations du surréalisme; l’Avant-Propos ne laisse aucun doute à ce sujet : “Le compagnonnage de la Table Ronde, la quête passionnée d’un trésor idéal, qui, si obstinément qu’il se dérobe nous est toujours représenté comme à portée de la main, figurent par exemple un répondant – au retentissement indéfini – pour certains des aspects les plus typiques de phénomènes contemporains parmi lesquels le surréalisme.” Le créateur de la pièce et le créateur du surréalisme étant à l’unisson, il serait vain de contester cette similitude de pensée.
Mais cette interprétation marquée par l’histoire littéraire n’explique sans doute pas ce qui fait l’intérêt du drame de nos jours. Contrairement à Wagner dont l’intention était de concrétiser à l’aide d’un mythe une vision chrétienne du salut (laissons de côté les querelles sur la pureté de cette intention), contrairement donc à une transcendance, Gracq ne veut voir dans la quête du Graal qu’une aventure terrestre et n’y propose aucune rédemption d’ordre religieux. Trévizent, l’ermite, n’est-il pas le premier à se méfier du Graal ? “Je me méfie de cette vieille outre qui a recueilli bien étrangement le vin nouveau.” Dans son entretien avec Jean Carrière, Gracq exprime très simplement le fond de sa pensée : à l’âge de dix-huit ans, il a abandonné la pratique religieuse liée à son éducation, et il ajoute : “En revanche, dépourvu que je suis de croyances religieuses,-je reste par une inconséquence que je m’explique mal, extrêmement sensibilisé à toutes les formes que peut revêtir le sacré, et Parsifal par exemple a pris pour moi sans qu’il y ait déperdition de tension affective – au contraire – la relève d’une croyance et d’une pratique qui se desséchait sur pied.” Les événements évoqués dans la pièce sont bien faits pour écarter toute transcendance : ainsi les petites servantes du quatrième acte parlent du roi Amfortas en l’appelant le Prince Rabat-Joie, et toutes de rire ; le mal dont il souffre n’est d’ailleurs pas lié dans leur esprit à l’idée d’une faute. C’est par l’intermédiaire d’un enfant, perché sur une corniche, qui raconte ce qu’il aperçoit que le spectateur a une vague représentation de la cérémonie du Graal; Kaylet prétend être ébloui par la lumière, mais Kundry le rembarre : “Il n’aveugle plus personne…” Le service du Graal n’est qu’un rituel desséché, tout juste bon à faire taire Perceval mis auparavant en condition par Amfortas. Aucune atmosphère mystique ne titille l’âme du spectateur, point d’Enchantement du Vendredi Saint.
Et pourtant, cette pièce de théâtre n’est pas une œuvre de dérision, un persiflage habile de légendes désuètes. Non, car si une transcendance au sens religieux du terme est absente, le sacré dans une acception philosophique et païenne imprègne l’œuvre de part en part : le sacré inhérent à tout être qui aspire à sortir de ses limites. La conversation avec l’ermite est dans ce sens éclairante : Trévizent : “J’ai choisi la mort tranquille -la certitude. Et quel est l’autre choix ? La vie. La vie ? La vie, c’est toi qui te mets en route, ignorant et mal averti, dans la forêt des pièges et des miracles, à la recherche d’un but imbécile. […] Et cela te trouble ? Le désir trouble toujours, Perceval” Mais Perceval ne se laisse pas abattre : “Il me semble que je saurais le nommer et le reconnaître [ le : le sens de sa mission] et à quoi je vais essayer de te le dire. Il me semble que c’est… que ce serait, oui – d’avoir le désir et de l’accepter sans trouble, les yeux ouverts… Le désir et la certitude immédiate d’une extraordinaire récompense.” N’est-ce pas le sacré tel que peut l’incarner un Prométhée malgré les maux qui le tortureront, ou un Icare malgré sa chute ?
Dans cette œuvre de Gracq, comme dans toutes les autres, il y a le refus de se fixer dans une vérité, la certitude que le désir est la valeur suprême : désir innocent, optimiste chez Perceval, révolte angoissée de Kundry, celle dont Gracq a dit dans la préface qu’elle “porte ses couleurs”. Tous deux traduisent une exigence d’absolu et le refus de la condition humaine. Cependant, objectera-t-on, c’est Amfortas qui l’emporte, comble de l’ambiguïté. Il a réussi à décourager Perceval et explique à Kundry éplorée après le départ du jeune chevalier : “Je l’ai traité mieux qu’un messie, mieux qu’un élu, mieux qu’un prophète. Je l’ai laissé choisir. Tu le poussais au Graal les yeux bandés, comme le bétail glorieux du sacrifice. J’ai préféré le traiter comme un homme.” Et il poursuit par la phrase déjà citée : “La folie du Graal n’est pas éteinte… Un autre viendra…” De ces répliques ressort une notion présente dans toute l’œuvre de fiction de Gracq, celle de l’attente, autre forme de désir car sans but défini. L’attente, une tension de l’être, une distanciation par rapport à ce qui est, une attente “pure” (J.L. Leutrat ). Non pas l’attente interminable des chevaliers qui répètent mécaniquement “Espérance dans le Sauveur« . Mais une attente qui laisse percevoir une forme particulière de sacré, la folie qui habite le vrai “simple”, ce que Perceval trop obnubilé par le but à atteindre n’était pas. Phrase ténue dans la masse d’un dialogue théâtral chargé d’idées, dont le sens ne se révèle à la réflexion, trop ténue peut-être pour dissiper une impression attristante de scepticisme qui peut naître de l’œuvre.
![]() ANNEXE
ANNEXE
La publication du Roi Pêcheur en 1948, chez José Corti, n’eut guère d’écho, mais la représentation de la pièce suscita des controverses passionnées. La première eut lieu le 15 avril 1949 au théâtre Montparnasse, dans une mise en scène de Marcel Herrand. Lucien Nat composait un Amfortas rationaliste sceptique face à Maria Casarès, une Kundry passionnée et à Jean-Pierre Mocky, trop “jeune premier” en Perceval. Les critiques déterminants d’alors, Jean-Jacques Gautier et René Kemp éreintèrent la pièce. Mais il y eut aussi des louanges. L’éditeur de la Pléiade a dressé un tableau très amusant des opinions imprimées alors, en juxtaposant les contraires. J’en retire deux exemples : “C’est long, c’est triste, c’est ruisselant d’ennui, c’est à la fois compliqué et sommaire, sans une once de vérité humaine, sans un atome d`émotion authentique” Le Figaro. En face: “Une poésie qui n’est jamais là pour elle-même […] Une sorte de tension constante de la lutte spirituelle […] Un mouvement qui ne s’arrête pas. Une des très rares soirées, la seule peut-être de l`année où l’on se sentit au contact de la beauté. » La Table Ronde. Autre juxtaposition: “ Un indicible ennui […] Certains avaient pris le parti de s’assoupir.” La Tribune des Nations. En face : “L’oeuvre vous tient et ne vous lâche pas.” Le Figaro littéraire.
Ce n’est qu’en 1991, à Lyon, que Jean-Paul Lucet se risqua à monter à nouveau cette œuvre. Je cite Michel Murat : “Le décor unique de forêt pétrifiée, très sombre, d’une verticalité oppressante et fendu en son milieu par une silencieuse fontaine de sang, échappe à l’écueil de la reconstitution stylisée. La pièce jouée sans entracte se maintient dans son rythme au prix d’un nombre restreint de coupures. La réduction à deux des chevaliers et des servantes, accroît cette concentration. Ainsi resserrée, le Roi Pêcheur est apparu comme un œuvre tendue et grave, dont la résonance intime se devine à travers les figures du mythe.”
Bibliographie :
– Julien Gracq. Le Roi Pêcheur (José Corti. 1996). Œuvres complètes. Pléiade. Gallimard. Édition établie par Bernilde BOIE.1989 et 1995
– Julien Gracq. Entretiens (José Corti 2002)
– Philippe BERTHIER. Julien Gracq critique. D’un certain usage de la littérature. (PUL .1990)
– Hubert HADDAD. Julien Gracq, la forme d’une vie. (Le Castor Astral. 1986)
– Jean-Louis LEUTRAT. Gracq. Classiques du XXème siècle. (Paris.1967)
– Michel MURAT. L’enchanteur réticent. Essai sur Julien Gracq. (José Corti)
– Will MELENDON : Thèmes wagnériens dans les romans de Julien Gracq (The French review. XLI. 1968. P 539/548.)
– MAROT Patrick : Le Roi Pêcheur. Le Graal ou l’envers de la représentation. Cahiers de L’Association internationale des Etudes Françaises. XLVII. 1995. P.115/134.
– Michelle SZKILNIK. Perceval ou le roman du Graal. (Gallimard Folio. 1998)
– Philippe WALTER. Perceval. Le pêcheur et le Graal (Images. 2004)
Vous souhaitez apporter des informations complémentaires et ainsi enrichir cet article, contactez-nous !