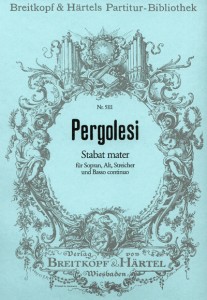 STABAT MATER DE PERGOLESE
STABAT MATER DE PERGOLESE
Stabat mater de Pergolèse
arrangé pour grand orchestre avec chœurs
par Alexis Lvoff,
membre des académies de Bologne et de Saint-Pétersbourg.
Revue critique par Richard Wagner (1840)
Première publication in Revue et Gazette musicale de Paris, 11.10.1840.
Il existe encore d’honnêtes musiciens qui mettent leur plus vive jouissance à rechercher les chefs-d’œuvre des anciens maîtres pour se pénétrer de leur mérite incomparable ; et quand on apporte à cette étude autant de zèle et d’intelligence que l’auteur dont nous allons parler, les travaux qui en résultent ne méritent pas moins d’estime et de reconnaissance que des ouvrages originaux. Ce serait une grave erreur que de supposer à M. Lvoff la prétention d’ajouter à la perfection de l’œuvre de Pergolèse, quand évidemment il n’a eu pour but que d’en rappeler le sublime exemple à l’école moderne et de le faire classer dans le répertoire des exécutions contemporaines. Sous l’influence de cette conviction, et malgré tous les scrupules esthétiques suscités par ce mode d’arrangements secondaires, on ne saurait donc contester l’importance et l’intérêt de la publication actuelle.
À une époque comme la nôtre, où les diverses branches de l’art musical ont pris une extension si divergente, au point de s’être souvent modifiées de la manière la plus anormale, c’est un besoin essentiel et un noble devoir que de remonter aux sources primitives, pour y puiser de nouveaux éléments de force et de fécondité. Mais pour resserrer utilement ces liens de parenté avec les grands maîtres du temps passé, la pratique de leurs compositions, adaptées s’il le faut aux exigences du goût moderne, aura toujours plus d’efficacité qu’une imitation pâle et médiocre de leur merveilleux style. Ce dernier procédé offre, en effet, le danger d’une pente rétrograde, les imitateurs en question s’attachant trop fréquemment à reproduire surtout dans leurs pastiches des formes surannées que réprouve la pureté du goût.
Les admirateurs exclusifs de l’ancienne école sont tombés dans une exagération vicieuse en préconisant sa facture incomplète au même degré que le fond et la pensée de ses œuvres.
Autant celle-ci avait de grandeur et de noblesse, autant les détails de l’exécution matérielle se ressentent de l’inexpérience, des tâtonnements d’une science à son début ; et l’on ne peut révoquer en doute le perfectionnement des formes, sinon de nos jours, du moins pendant la période intermédiaire qui succéda à cet âge d’or de l’art musical.
Ce fut avec Mozart, le chef de l’école idéale, que la musique, religieuse sous le rapport de la facture, parvint réellement à son apogée ; et si je ne craignais d’être mal interprété, j’oserais dire qu’il serait à souhaiter que tous les ouvrages du temps précédent nous eussent été transmis revêtus de formes analogues, car la perfection de celles-ci aurait été une compensation suffisante aux inconvénients de cette transformation, désavantage fort léger d’ailleurs, puisque Mozart n’était pas trop éloigné de l’époque primitive, et que sa manière en a conservé le sentiment et les traits caractéristiques. Il a prouvé, au contraire, avec éclat combien les anciens chefs-d’œuvre pouvaient être embellis par la vivacité et la fraîcheur du coloris, sans rien perdre pour ainsi dire de leur mérite intrinsèque, notamment par l’arrangement de l’oratorio du Messie de Haendel.
Nous sommes loin de blâmer ceux qui voudraient qu’on n’exécutât l’œuvre de Haendel que dans une cathédrale, avec un chœur de trois à quatre cents voix, appuyé des orgues et d’un quartette composé d’un nombre égal d’instruments à cordes, pour jouir de tout l’éclat et de toute l’énergie primitive de la composition. Sans doute que, pour l’individu jaloux d’apprécier la valeur historique de la musique de Haendel, il serait préférable de l’entendre rendue avec des moyens aussi puissants, chose presque impossible, du reste, à réaliser aujourd’hui, en raison de cette circonstance majeure et bien notoire, à savoir que Haendel improvisait lui-même sur l’orgue l’accompagnement des premières exécutions du Messie. N’est-il pas permis de croire que le compositeur à qui l’emploi perfectionné des instruments à vent était encore inconnu, se serait alors servi des orgues pour produire les mêmes effets que Mozart confia plus tard à ces instruments à vent améliorés ?
En tout cas, l’instrumentation de Mozart a embelli l’ouvrage de Haendel dans l’intérêt général de l’art. Il fallait, à la vérité, le génie d’un Mozart pour accomplir une pareille tâche avec une mesure aussi parfaite. Celui qui entreprend aujourd’hui un travail analogue ne peut donc rien faire de mieux que de le prendre pour modèle, sans chercher surtout à compliquer sa facture si simple et si naturelle. Car l’application des procédés d’instrumentation moderne serait le plus sûr moyen de rendre méconnaissables le thème et le caractère des anciennes œuvres.
Telle a été du reste la louable préoccupation de M. Lvoff. L’examen de sa partition démontre qu’il a pris pour type la sage instrumentation de Mozart. Trois trombones, deux trompettes, les timbales, deux clarinettes et deux bassons, tels sont les éléments de l’adjonction faite à l’orchestre primitif. Mais le plus souvent les clarinettes et les bassons ont seuls un rôle actif dans l’accompagnement, à l’instar de celui rempli par les bassons et les cors de bassette dans le Requiem de Mozart. La plus grande difficulté a dû être la traduction générale du quatuor des instruments à cordes, car Pergolèse l’avait écrit tout entier dans le style naïf du vieux temps, se bornant à trois parties la plupart du temps, et quelquefois même à deux. Fort souvent le complément d’harmonie allait de lui seul, et l’on a peine à s’expliquer pourquoi le compositeur a omis de l’écrire, ce qui produit des lacunes très sensibles. Mais dans d’autres endroits, ce remplissage offrait de grandes difficultés, surtout là où la mélodie semble ne comporter que trois parties, ou seulement deux, et où une voix supplémentaire peut être considérée comme superflue ou même nuisible. Ce grave obstacle a néanmoins toujours été surmonté avec bonheur par M. Lvoff, dont on ne saurait trop louer en général la discrétion. Les instruments à vent qu’il introduit, loin de couvrir jamais ni d’altérer le thème original, servent au contraire à l’éclairer davantage. Ils ont même un certain caractère indépendant qui concourt à l’effet d’ensemble, tout à fait suivant les règles adoptées par Mozart, et nous citerons notamment à cet égard la strophe quatrième, Quæ mœrebat. Quelquefois seulement, par exemple au début de la première partie, c’est peut-être à tort que la partie des violons a été transférée aux bassons et aux clarinettes ; non que l’auteur ait méconnu ici le caractère de ces derniers instruments, mais parce que la basse conservée des instruments à cordes paraît trop pleine et trop sonore avec les nouveaux dessus.
Toutefois il est étonnant que l’auteur d’un travail si consciencieux se soit laissé entraîner une fois à altérer la partie de basse au commencement de la deuxième strophe, où M. Lvoff a modifié la phrase entière, au grand désavantage de la mélodie primitive, ce qu’il aura fait sans doute pour éviter un passage d’une certaine dureté qui se trouve chez Pergolèse dans la partie d’alto. Mais il y avait, selon nous, moyen de remédier à cette rudesse sans sacrifier la jolie basse du grand compositeur. C’est, du reste, le seul exemple, dans tout l’ouvrage, d’un changement défavorable et inutile. Il témoigne à cela près du zèle le plus consciencieux et d’une appréciation pleine de délicatesse du chef-d’œuvre ancien, même dans de petits détails d’un caractère un peu suranné.
Ce qu’il y a de plus audacieux dans l’entreprise de M. Lvoff est, sans contredit, l’adjonction des chœurs, puisque Pergolèse n’écrivit le Stabat que pour deux voix : une de soprano, une de haute-contre. A la rigueur, il eût mieux valu respecter l’intention originelle du maître ; mais comme pourtant cette introduction de chœurs n’a nullement gâté l’ouvrage, et que, d’ailleurs, les deux parties de chant primitives ont été conservées dans toute leur indépendance, on ne saurait adresser à l’arrangeur aucun blâme sérieux, et il faut même reconnaître qu’il a ajouté à la richesse de l’ensemble, car cette adjonction a été opérée avec une rare habileté et une intelligence supérieure du texte.
Ainsi, dans le premier morceau, la fusion intermittente du chœur avec les voix de solo rappelle heureusement la manière dont les deux chœurs sont traités dans le Stabat de Palestrina. Toutefois, c’est principalement sur le chœur que porte l’inconvénient de l’adjonction des parties complémentaires dans les passages précités où Pergolèse avait dessiné sa mélodie exclusivement pour deux ou trois. Ici l’arrangeur a dû restreindre le rôle du chœur à trois parties au plus, pour ne pas défigurer absolument l’harmonie primitive et n’en pas altérer la noble simplicité. Cela est surtout sensible dans les passages fugués, comme le Fac ut ardeat. Aussi le chant du thème n’est jamais du ressort du ténor, mais exclusivement dévolu à l’une des parties de soprano ou de contralto, comme dans la composition originale, ou bien à celle de basse, qu’il était facile d’extraire de l’accompagnement primordial. L’arrangeur a dû être surtout embarrassé par l’Amen expressément écrit par Pergolèse pour deux voix seulement.
À propos du n° 10, Fac ut Portem, nous remarquerons encore qu’il aurait mieux valu omettre l’accompagnement du chœur ainsi que la cadence servant de conclusion, ces deux accessoires sentant par trop l’opéra moderne, et ne cadrant nullement avec le caractère de l’œuvre sacrée.
Mais si nous avons cru devoir signaler les rares écueils qu’offrait un pareil travail, nous devons aussi déclarer franchement que le compositeur moderne a fait preuve, en les doublant, d’une grande habileté. On ne saurait trop louer surtout la noble intention qui a présidé à l’entreprise de M. Lvoff ; car si une admiration éclairée et une ardente sympathie pour un si grand chef-d’œuvre étaient seules capables de faire assumer une pareille tâche, nul doute aussi que M. Lvoff n’en eût parfaitement mesuré l’étendue et la difficulté. C’est donc une pleine justice que de constater, non seulement le talent, mais aussi le courage nécessaire pour accomplir un travail semblable, où l’artiste doit faire abnégation complète de lui-même, et s’effacer constamment pour laisser briller dans tout son jour le génie supérieur auquel il rend un hommage de prédilection.
Richard Wagner, 1840.