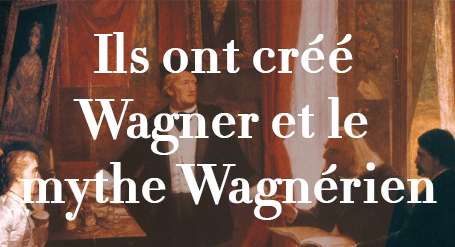
Cette section présente une série de portraits biographiques de ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à l’édification de l’œuvre wagnérienne. Des amitiés ou des inimitiés parfois surprenantes ou inattendues, des histoires d’amour passionnées avec les femmes de sa vie, parfois muses et inspiratrices de son œuvre, mais également des portraits d’artistes (chanteurs, metteurs en scène, chefs d’orchestre…) qui, de nos jours, se sont “appropriés” l’œuvre du compositeur et la font vivre différemment sur scène.

LES ARTICLES SUIVANTS SONT SUSCEPTIBLES
DE VOUS INTÉRESSER
![]() ANNÉE 1883
ANNÉE 1883
Au cours des premiers jours de 1883, Richard Wagner apprend l’invention du phonographe, cette nouvelle l’indigne tant qu’elle l’attriste. 6 février 1883 (Soir de Mardi Gras) Le Carnaval bat son plein et les Wagner sont Place Saint-Marc où ils voient passer le cortège du prince Carnaval.(Lire la suite)
![]() ÉLÉGIE WWV93
ÉLÉGIE WWV93
Cette œuvre fragmentaire (feuille d’album) en la bémol majeur semble avoir été écrite par Wagner en 1869. Cette page fut longtemps considérée comme une œuvre tardive (cf. les dernières notes qu’il traça à Venise avant sa mort en 1883). Wagner la joua dit-on la veille de sa mort.(Lire la suite)
![]() TRISTAN ET ISOLDE
TRISTAN ET ISOLDE
Septième opéra de Richard Wagner, Tristan et Isolde (WWV 90) est le quatrième de la période dite de maturité du compositeur et le premier créé sous le patronage du roi Louis II de Bavière. Il s’agit également du seul ouvrage résultant d’une commande dans la carrière du compositeur : le 9 mars 1857,(Lire la suite)
PÄTZ Johanna Rosine
(née le 19 septembre 1774 - décédée le 9 janvier 1848)
La mère de Richard était née à Weissenfels, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Leipzig, le 19 septembre 1774[1]. Elle était le sixième enfant (et le quatrième de ceux restés en vie) du boulanger ou meunier Johann-Gottlob Pätz et de sa première femme, Dorothea Erdmuthe, née Iglisch, fille d’un tanneur. Cette dernière mourut alors que Johanna avait quatorze ans. Son père se remaria le 28 octobre 1788 (et contracta d’ailleurs un troisième mariage en 1795). Johanna entoura son arbre généalogique d’un certain mystère, bien que le maître boulanger l’ait reconnue comme sa fille légitime. Elle indiqua à ses enfants que son nom de jeune fille était Perthes. Ils apprirent qu’il se disait en réalité Petz. Richard lui-même hésitait entre trois orthographes : Pätz, Petz ou Beetz[2]. Était-ce pour cacher la différence de condition sociale existant entre sa famille et celle de son époux ? Elle déclarait avoir été élevée non par ses parents, mais dans l’un des meilleurs pensionnats de Leipzig. Cette éducation inhabituelle à l’époque pour une fille d’artisan aurait été rendu possible par la sollicitude d’un protecteur de haut rang, « grand ami de son père. Cet ami […] était un prince de Weimar qui avait rendu bien des services à sa famille[3] » nous dit Wagner dans Ma Vie. Son éducation aurait été interrompue par la mort soudaine de cet ami. Quelques biographes[4], en particulier Houston-Stewart Chamberlain (l’époux d’Eva, seconde fille de Richard), ont conclu que Johanna Rosine aurait pu être la fille naturelle du prince Friedrich Ferdinand Constantin de Saxe-Weimar (1758-1793), l’unique frère du Grand-Duc Karl August (1757-l828), prince régnant et bienfaiteur de Goethe. Chamberlain, afin d’orienter la présomption de paternité sur la personnalité du prince Constantin, n’hésita pas à rajeunir de quatre années la mère de Wagner et put affirmer sans scrupule que la lignée du maître de Bayreuth remontait jusqu’à l’aube du Moyen-Age. Il est prouvé depuis de manière définitive, en partie grâce aux travaux d’Otto Strobel, l’archiviste de Bayreuth et conservateur du musée Richard Wagner dans les années 1930, que la paternité du prince de Weimar est exclue : il n’avait que quinze ans à la naissance de Johanna Rosine et vivait sous une étroite surveillance à Weimar, ville qu’il n’a jamais quittée ces années-là… Comment l’attention se porta-t-elle donc sur le prince Constantin ?
En 1981, avec son talent de romancier, Martin Gregor-Dellin raconte dans sa biographie : « Peut-être qu’à quinze ans la jeune Johanna apportait aux poètes leur petit pain du matin à l’auberge. Il est vraisemblable que Schiller, Körner et Humboldt séjournaient à Weissenfels les années précédentes, sans doute depuis 1789.[…] On ne peut pas exclure que l’un d’eux ait remarqué, au théâtre amateur de Weissenfels, le talent de comédienne de la gracieuse et jolie Johanna Rosine. Il est possible qu’il en fit part au prince Constantin de Weimar, qui était compétent pour tout ce qui concernait le théâtre de son état. Si le prince Constantin a fait élever la petite Johanna à Leipzig, ville ouverte au théâtre, cela pourrait également expliquer que cette éducation ait été interrompue à sa mort en 1793 [victime d’une épidémie dans un camp militaire][5] ». Explication troublante, car Johanna Rosine semble n’avoir eu aucune instruction ultérieure…, elle quitta l’école en 1789. Ce que son fils confirme évoquant une instruction et une éducation très insuffisante ; et de fait, son allemand était épouvantable… Et si, Johanna n’était ni la fille, ni la protégée du prince de Weimar, mais sa maîtresse !
C’est ce que démontre brillamment Gregor-Dellin, en se basant sur de nombreux documents d’archives du trésorier du Grand-Duc, faisant état des pensions octroyées aux favorites ainsi qu’à ses maîtresses issues de la petite bourgeoisie et de leurs enfants illégitimes, dans un article publié en 1985 (postérieur donc à sa biographie…), intitulé : Résultats de recherches récentes sur Wagner (le mystère de la mère)[6]. Il s’avère que le prince, devenu général de division de cavalerie dans l’armée du prince-électeur de Saxe, résida assez longuement, au cours de l’année 1790, et à deux reprises à Weissenfels, dont l’une (de juin à septembre) non loin de la boulangerie Pätz. C’est à ce moment que commença la liaison entre le prince et la fille du boulanger. Voici ce que nous dit le biographe allemand : « Constantin installa sa chère Johanna Rosine à Leipzig, avec le consentement de celle-ci, et non sans avoir probablement légèrement modifié son nom de famille ; cependant il la plaça, non pas dans une institution distinguée[7], mais chez une certaine dame Sophie Friederike Hesse. Johanna Rosine recevait en outre de l’argent pour ses toilettes et ses parures, et si Constantin lui fit donner des leçons de diction, d’écriture et de maintien, ce n’était certes pas à des fins plus nobles ou en vue d’une carrière d’actrice, mais simplement pour avoir une maîtresse digne de son rang. Elle ne fut pas non plus gratifiée d’une indemnité élevée […], puisque la liaison demeura sans conséquence[8]. » Après le départ du prince Constantin pour la guerre, suivi de sa mort, en 1793, la jeune Johanna fut abandonnée à son destin. Gregor-Dellin poursuit : « Le conseil secret, dont faisait partie Goethe, rendit en 1793 la décision suivante : la fille du boulanger Bezin, de Weissenfels, actuellement en pension chez une certaine dame Hessin à Leipzig, reçoit pour la dernière fois les cinquante Reichtalers échus à la Saint-Michel et est abandonnée à son sort[9]». Ce dernier portait le nom de Carl Friedrich Wagner, qu’elle épousa le 2 juin 1798. C’est cette succession d’événements qui explique que Johanna soit restée énigmatique, comme Wagner le note dans Ma Vie, au sujet de son nom, de son âge et de ses origines. Dans son autobiographie, il n’évoque à aucun moment ses grands-parents maternels. Il semble que Johanna Rosine ait rompu toute relation avec sa famille à Weissenfelset qu’elle n’ait jamais donné à ses enfants l’occasion de fréquenter sa ville natale ; là-même où elle n’était qu’une fille de boulanger entretenue…
L’intrusion de la mort au sein du cercle familial marqua les premiers mois de l’existence de Richard. Son père succomba à l’âge de 43 ans du typhus exanthématique. L’épidémie s’était déclarée au lendemain des combats de la sanglante bataille des Nations qui se déroula à Leipzig du 16 au 19 octobre 1813. Les hôpitaux de la ville ne pouvaient accueillir tous les blessés, qui se pressaient ainsi dans les églises et les écoles. Beaucoup de cadavres n’avaient pu être enterrés et les eaux de l’Elster étaient chargées de cadavres d’hommes et de chevaux. Inévitablement, la malnutrition, la promiscuité et l’hygiène défectueuse favorisèrent la survenue d’une épidémie de typhus. Le 4 novembre, on comptait dans cette ville plus de 20.000 morts. Hoffmann, qui était à Dresde lorsque l’épidémie se déclara, en nota les symptômes dans son journal « maux de tête, vertiges, engourdissement, mort, tout ceci en l’espace de quelques heures[10]. » Friedrich Wagner, affaibli par le surmenage imposé par le service policier lié aux désordres de la guerre, fut atteint par la maladie et mourut le 23 novembre 1813. Il ne laissait rien à son plus jeune fils, alors âgé de six mois, pas même un portrait… L’enfant ne le connaîtra qu’au travers du miroir déformant du discours familial. Johanna fit paraître dans le Leipziger Zeitung une notice nécrologique en précisant qu’il avait été « victime de son devoir… trop tôt disparu pour moi et mes huit enfants à charge[11]».
A la mort de son chef, la famille Wagner, arrachée à une sécurité bourgeoise, fut menacée d’une dispersion totale. Johanna Rosine avait trente-neuf ans. En une époque aussi troublée, elle était seule ou presque, sans ressource (en dehors de la maigre pension versée par l’administration), avec la charge d’élever trois fils et quatre filles (en 1813, Ottilie avait deux ans, Klara six, Luise huit, Julius neuf, Rosalie dix et Albert quatorze ans). Des enfants du couple, un fils Gustav, né en 1801, était mort à l’âge de sept mois ; une fille, Theresia, ne survécut pas à sa quatrième année, emportée par une épidémie le l9 janvier 1814. Johanna ne put compter sur le soutien de son beau-frère, Adolf, vivant retiré du monde ou de sa belle-sœur, Friedericke. Ludwig Geyer se porta aussitôt au secours de la veuve de son ami. Il ne put d’abord s’occuper de la famille que par l’entremise d’une aide financière. Le retour de la paix en Allemagne, la promotion au rang d’acteur de Cour à Dresde permirent à Geyer d’accueillir Johanna et ses enfants. Après de brèves fiançailles, ils se marièrent le 28 août 1814, à Pötewitz, près de Weissenfels. Richard, âgé de 14 mois, avait de nouveau un père et un foyer sûr, cette fois à Dresde. Le 26 février 1815 naissait Cäcilie, fille légitime de Geyer et Johanna.
[…]_______
« Ma mère – une femme ! » [1]
Les ramifications psychologiques de sa relation avec sa mère ne sont pas moins complexes. A l’époque où elle s’inscrivit dans la mémoire de Wagner – elle était déjà âgée quand il naquit -, des maux de tête la contraignaient à porter constamment un bonnet ; la toile de Ludwig Geyer l’immortalisa sous cet aspect. Wagner confie dans son autobiographie : « Je n’ai pu garder l’image d’une mère jeune et gracieuse. Les soucis qui l’agitaient au milieu d’une nombreuse famille (dont j’étais le septième membre vivant), les difficultés qu’elle éprouvait à nous procurer le nécessaire et à sacrifier à un certain décorum malgré des moyens très restreints, ne lui laissaient guère le loisir de manifester ces épanchements de tendresse qui sont le propre d’une mère. C’est à peine si je me rappelle avoir reçu d’elle une caresse : en revanche, il était courant qu’elle manifestât un caractère vif, presque emporté et irascible[2] » . Par ailleurs, en plus de lui refuser l’attachement œdipien que le jeune enfant réclamait, sa mère lui interdit également le monde du théâtre : […] Ma mère se préoccupa de ne pas laisser grandir en moi une inclination éventuelle pour le théâtre. […] Elle me menaçait presque de sa malédiction si je faisais mine de m’intéresser au théâtre[3]. » Ces traits négatifs et l’absence de fibre maternelle sont à rapprocher d’une lettre que Wagner écrivit en septembre 1842 à Cäcilie ; il y est question du manque de principes et des caprices de sa mère, de sa versatilité, de son penchant à la falsification des faits et à la complaisance pour les ragots, de son avarice et de son égoïsme » [4]… Mais, il ne faudrait pas oublier de préciser que l’âge semble avoir perturbé profondément le caractère de sa mère. Johanna passera la fin de sa vie à l’abri des soucis matériels, grâce à ses filles et à leurs riches mariages. Elle décédera le 9 janvier 1848, à l’âge de soixante-quatorze ans. « Elle avait passé les dernières années de sa vie, autrefois si active et si instable, dans la sérénité que procure le confort et, sur la fin dans un état d’inconscience paisible[5] » nous dit Wagner dans son autobiographie. Il ajoute en évoquant les funérailles de sa mère : « Je me hâtai de me rendre à Leipzig pour son enterrement et j’eus la joie de pouvoir contempler une dernière fois et avec une profonde émotion le visage serein et paisible de la morte. [.. .] Nous la déposâmes dans la tombe par un matin glacial. La motte de terre gelée que je pris, suivant l’usage, pour la jeter sur le cercueil, tomba sur le couvercle avec un bruit violent qui m’effraya. […] Pendant le court trajet de Leipzig à Dresde, j’eus nettement conscience de l’isolement complet où je me trouvais. La mort de ma mère avait rompu les liens naturels entre frères et sœurs absorbés par leurs intérêts personnels[6]. »
La relation de Richard avec sa mère, probablement très forte, fut en réalité beaucoup plus complexe et marquée d’une extrême ambivalence. En témoigne une lettre célèbre, écrite à Karlsbad le 25 juillet 1835, qu’il lui adressa alors qu’elle était âgée de soixante et un ans : « Tu es la seule, ma très chère mère, à qui je pense avec l’amour le plus fervent et l’émotion la plus profonde », puis il renchérit avec un excès suspect : « Je fais sans doute partie de ces gens qui ne savent pas toujours parler selon leur cœur dans l’instant, sinon tu aurais eu bien souvent la révélation d’un côté de ma nature beaucoup plus tendre. Mais les sentiments demeurent les mêmes, et vois-tu, Maman, maintenant que je suis loin de toi, je me sens envahi de reconnaissance pour l’amour magnifique que tu prodigues à ton enfant, et que tu lui as manifesté récemment une fois de plus avec tant de chaleur et d’affection ; c’est si fort que je voudrais t’écrire et le dire avec toute la tendresse d’un amoureux envers sa bien-aimée. Que dis-je, c’est bien plus que cela, l’amour d’une mère n’est-il pas en effet bien plus immaculé que tout autre ? » La lettre culmine dans cette phrase, où il semble vouloir s’assurer de ses propres sentiments : « Ma chère, très chère mère, quel misérable je ferais si jamais mon sentiment venait à se refroidir à ton égard ! [7] »
extrait de l’article Les parents de Richard Wagner par Pascal BOUTELDJA,
in WAGNERIANA ACTA 2010 @ CRW Lyon
[1] Certaines sources donnent de manière erronée la date de 1774.
[2] D’autres orthographes existent : Bertz, Betz ou encore Berthis
[3] « Richard Wagner, Ma Vie, p. 19.
[4] « Voir :«The prince Constantin question », in : Ernest Newman, The Life of Richard Wagner. II. 1848-1860, pp.613-619.
[5] Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner. Paris, Fayard, 1981, p.40.
[6] Martin Gregor-Dellin, Résultats de recherches récentes sur Wagner. Bayreuther Festspiele Programm,Parsifal, 1985, pp. 81-90.
[7] La mère de Wagner n’indiqua jamais à ses enfants le nom de «l’institution» de Leipzig, où elle aurait été élevée…, et pour cause !
[8] Martin Gregor-Dellin, Résultats de recherches récentes sur Wagner, p.87.
[9] Ibid, p. 87.
[9] Joachim Kôhler, Richard Wagner. The Last of the Titans. London, Yale University Press, 2004, p.9.
[10] Mary Burell Richard Wagner. His Life and Works from 1813 to 1834, p. 16.
[1]« Meine Mutter – ein Menschenweib ! » (Siegfried, Acte II, scène 2)
[2] Richard Wagner, Ma Vie, pp. 19-20
[3] Richard Wagner, Ma Vie, pp. 19-20
[4] Sämtliche Briefe. Band II, pp. 155-160
[5] Richard Wagner, Ma Vie, p. 236
[6] Richard Wagner, Ma Vie, pp. 209-213
[7] Sämtliche Briefe. Band I., p. 148
Vous souhaitez apporter des informations complémentaires et ainsi enrichir cet article, contactez-nous !