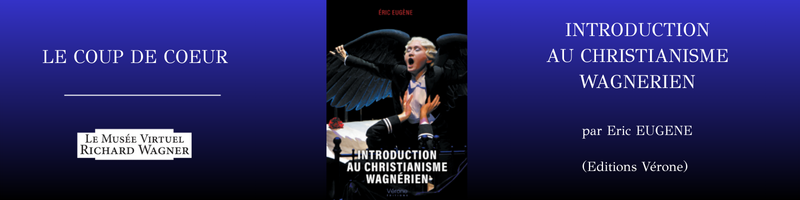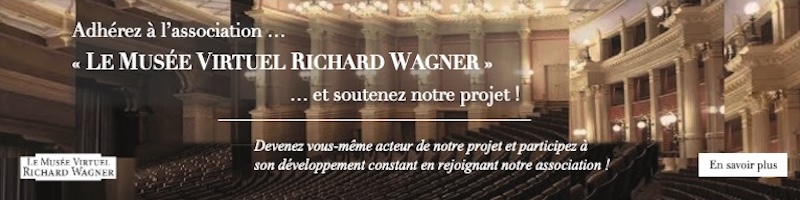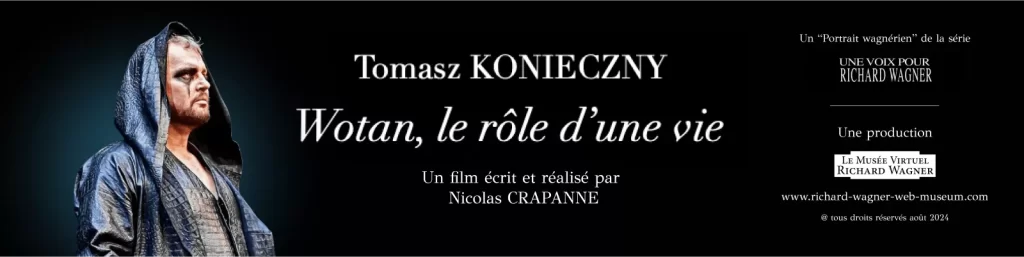« Il faut évoquer les sectes religieuses du temps de la Réforme, leurs disputes, les opuscules qu’elles lançaient, pour avoir une idée de la folie furieuse qui s’était emparée des cerveaux humains, hantés par la lettre imprimée. Et l’on peut admettre que c’est seulement le magnifique Choral de Luther qui a sauvé la pensée saine de la Réforme : car il agit sur l’âme et guérit ainsi les esprits de l’obsession de la lettre1 R. Wagner, Beethoven, in Gesammelte Schriften und Dichtungen, t. IX, Leipzig, Fristsch, 3e éd. 1897, p. 116. En français, Écrits sur la musique, trad. J.-L. Crémieux-Brilhac, Paris, Gallimard, 2013, p. 163. . »
« Il faut évoquer les sectes religieuses du temps de la Réforme, leurs disputes, les opuscules qu’elles lançaient, pour avoir une idée de la folie furieuse qui s’était emparée des cerveaux humains, hantés par la lettre imprimée. Et l’on peut admettre que c’est seulement le magnifique Choral de Luther qui a sauvé la pensée saine de la Réforme : car il agit sur l’âme et guérit ainsi les esprits de l’obsession de la lettre1 R. Wagner, Beethoven, in Gesammelte Schriften und Dichtungen, t. IX, Leipzig, Fristsch, 3e éd. 1897, p. 116. En français, Écrits sur la musique, trad. J.-L. Crémieux-Brilhac, Paris, Gallimard, 2013, p. 163. . »
En écrivant ces lignes, Wagner pensait aux controverses entre les Anabaptistes, les Schwärmer (‘enthousiastes’), les antinomistes et autres Spiritualistes qui avaient marqués les débuts de la Réforme. Certes, Wagner omettait de dire que Luther était partie prenante dans presque toutes ces disputes, en revanche il mettait le doigt sur une des réalisations les plus originales de la Réforme à savoir le cantique en langue vernaculaire. Luther n’était pas l’inventeur du genre2Voir Patrice Veit, notice aux Cantiques et préfaces aux recueils de cantiques et de musique (1523-1545), in Martin Luther, Œuvres, tome 2, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 2017, p. 1084-1095., mais son initiative fut originale dans la mesure où elle orienta profondément le chant d’église pour l’avenir. Le Réformateur cherchait à s’affranchir du monopole des clercs dans la liturgie et à ouvrir la Parole de Dieu au plus grand nombre. C’est vers la fin de l’année 1523 que Luther confia à Spalatin3Georg Burkhardt dit Spalatin (1484-1545), conseiller du duc de Saxe Frédéric III le Sage. son intention de créer des cantiques pour le peuple en transposant des psaumes pour le chant avec deux fonctions précises. La première était de faire participer l’assistance à la liturgie, la seconde d’aider à garder en mémoire la Parole et le message évangélique. Dès la fin de 1523 quelques chants furent composés et diffusés et la série allait se poursuivre jusqu’en 1543. Au total ce furent 36 chants et la Litanie allemande4 Rétablie par Luther en 1529, avec l’invocation aux seules trois personnes de la Trinité. qui furent écrits et composés par Luther.
Parmi cet ensemble, il convient de s’intéresser plus particulièrement à un cantique de 1541 sur le salut par le baptême intitulé Christ notre Seigneur vint au Jourdain (Christ, unser Herr, zum Jordan kam)5J.-S. Bach en fit une cantate BWV 684 (1724).. À la lecture du cantique on ne peut qu’être saisi par sa ressemblance avec le chœur d’entrée des Maîtres chanteurs de Nuremberg dont le premier vers est : « Vers toi le Sauveur est venu (Da zu dir der Heiland kam)6Les Maîtres chanteurs de Nuremberg (Die Meistersinger von Nürnberg), trad. jean d’Arièges, Paris, Aubier- Flammarion, 1978, p. 42-43.. » Les deux chorals semblent, en effet, très proches l’un de l’autre, tant par le motif théologique que par son développement. La comparaison est ainsi frappante entre la première des sept strophes du cantique de Luther (en premier) et le choral de Wagner (en second).
Christ notre Seigneur vint au Jourdain
conformément à la volonté de son Père ;
de saint Jean il reçut le baptême,
pour accomplir son œuvre et son ministère.
Il voulut pour nous instituer un bain,
afin de nous laver du péché
et de noyer la mort amère
par son propre sang et ses propres plaies.
Cela signifiait une vie nouvelle.
Vers toi le Sauveur est venu,
et a voulu recevoir de tes mains le baptême
s’offrant à la mort en faisant le sacrifice de sa vie,
et nous donnant l’ordre dont dépend notre salut
de nous sanctifier par ton baptême,
pour être digne de son sacrifice,
noble Jean-Baptiste, précurseur du Christ,
accueille-nous avec bienveillance
aux rives du Jourdain7Trad. Patrice Veit, op. cit., p. 763 et Jean d’Ariègès, op. cit., p. 43 et 45..
Ce qui apparaît d’emblée à la lecture de ces deux chorals, c’est la similitude du message théologique. En effet, il est ici question principalement de l’histoire du salut8Concept des théologies juive et chrétienne qui met en évidence l’action de Dieu au cours de l’histoire humaine. et de l’œuvre salvifique du Christ par sa mort. Pour Luther, le péché de l’homme est lavé par le baptême et noyé par « la mort amère (bittern Tod) » de Jésus9Luther fait ici référence à Paul dans l’épître aux Romains (Rm 6, 1-11). Le baptême est l’acte par lequel le baptisé participe à la mort du Christ en croix.. Wagner reprend le même thème puisque, recevant le baptême, le Christ « s’est offert à la mort en faisant le sacrifice de sa vie (weihte sich dem Opfertod) » pour « notre salut (Heil) ». Cette mort ignominieuse a le même effet de procurer aux hommes « une vie nouvelle » en les « lavant du péché (zu waschens uns von Sünden) » selon Luther, et de « nous sanctifier (uns weihn) » selon Wagner. Quant aux moyens du salut, ils sont également équivalents : il s’agit du « propre sang et des propres plaies (sein selbst Blut und Wunden)10Qui a inspiré le Choral de Paul Gerhardt (1607-1676) : « O Haupt voll Blut und Wunden ». », signes visibles du sacrifice chez Luther, et du « sacrifice (Opfer) » proprement dit chez Wagner
Si le thème des deux chorals est identique, ils se rapprochent également par leur illustration. C’est Jésus qui humblement « vint au Jourdain (zum Jordan kam) » écrit Luther, de même « le Sauveur est venu (…) aux rives du Jourdain (der Heiland kam (…) am Fluss jordan) » pour Wagner. Quant au ministre du baptême, il s’agit de « saint Jean » (Luther) et de « Jean Baptiste » (Wagner). C’est Jésus qui « reçut le baptême (die Taufe nahm) » (Luther) et « re(çut) de tes mains11Celles de Jean le Baptiste. le baptême (deine Taufe nahm) » (Wagner). Enfin, si le Jourdain (Jordan) est évoqué en début de la strophe chez Luther, il clôt le choral chez Wagner.
Wagner, comme tous les petits Allemands luthériens du début du XIXesiècle, avait fait l’apprentissage de sa religion avec le Petit catéchisme de Luther dont les six principaux chapitres, commentés chaque jour par le chef de famille, étaient répartis sur les six jours ouvrables de la semaine. Il connaissait les cantiques composés par Luther et utilisait régulièrement ses Geistliche Lieder dont l’édition figurait en bonne place dans sa bibliothèque de Wahnfried12Il s’agit de l’édition de Philipp Wackernagel, Stuttgart, Samuel Gottlieb Liesching, 1848.. La connaissance qu’il pouvait avoir des cantiques de Luther était de tradition en Allemagne à cette époque. Wagner reconnaissait aussi à Luther l’immense mérite d’avoir traduit par le chant le message évangélique, tout comme, il y a un siècle, le grand théologien luthérien qu’était Paul Tillich (1886-1965) estimait qu’une œuvre d’art est en mesure d’annoncer l’Évangile aussi bien, et peut-être mieux, que le discours dogmatique13Paul Tillich, « Église et culture », in La dimension religieuse de la culture. Écrits du premier enseignement (1919- 1926), Paris, Genève, Québec, Cerf/Labor et Fides/Presses de l’Université de Laval, 1990, p. 113.. Le choral d’entrée des Maîtres est donc un hommage appuyé au Réformateur. Wagner n’a copié en rien le texte de Luther, mais il l’a reproduit en tout.
EE