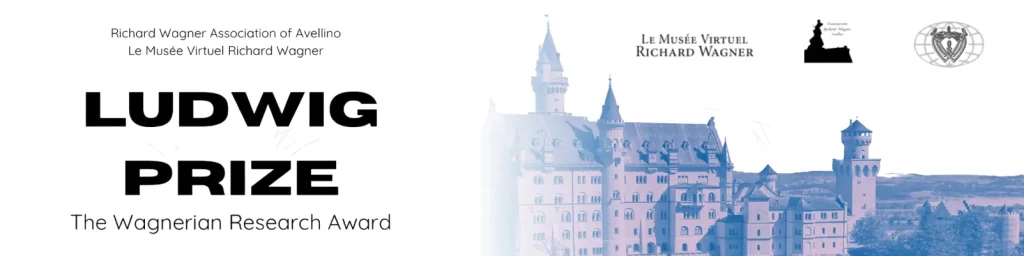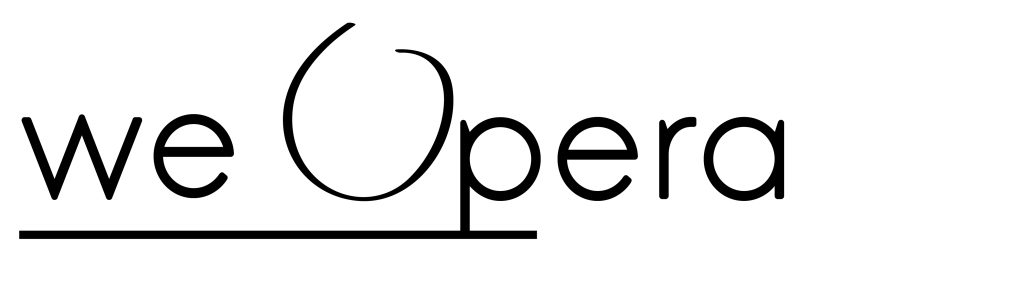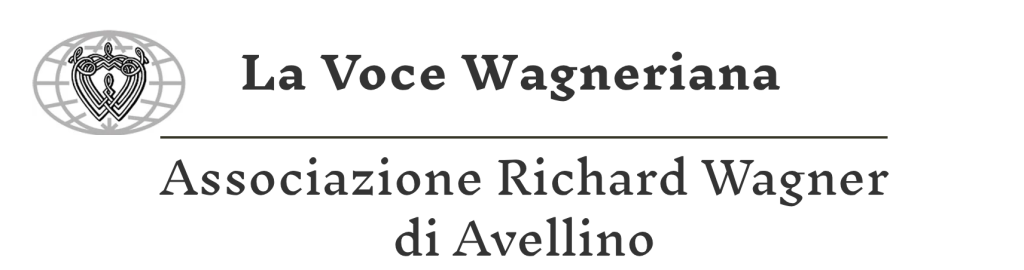Rappels biographiques

Camille Saint-Saëns naît à Paris. Il commence le piano avec sa grand-tante, puis avec le compositeur et pédagogue Camille-Marie Stamaty (1811-1870). Ce dernier le recommande à Pierre Maleden, compositeur, qui lui enseigne la théorie et la composition. Camille se révèle être un enfant prodige : il donne son premier concert à 10 ans le 6 mai 1846 et fait sensation avec le troisième concerto de Ludwig van Beethoven, et le concerto n o 15 K.450 de Mozart. Il écrit et joue même sa propre cadence pour le concerto de Mozart.
Il entre en 1848, à 13 ans, au Conservatoire, où il étudie l’orgue avec François Benoist (1794-1878), la composition avec Jacques Fromental Halévy (1799-1862) et reçoit aussi les conseils de Charles Gounod (1818-1893). Il sort du Conservatoire avec le prix d’orgue en 1851. Mais la même année, il échoue au Concours du prix de Rome. En 1857 il succède à Lefébure-Wély aux grandes orgues Cavaillé-Coll de l’église de la Madeleine à Paris, et reçoit la visite de plusieurs musiciens, dont Liszt, qui est très impressionné par ses improvisations. Liszt décrira ainsi Saint-Saëns comme « le premier organiste du monde ». Saint-Saëns a alors vingt-deux ans. Il reste à ce poste durant vingt années.
Durant toutes ces années l’activité du compositeur est intense : il contribue aux nouvelles éditions d’œuvres de Gluck, Mozart, Beethoven, mais aussi Liszt. Il défend les œuvres de Schumann et d’un Wagner pourtant peu apprécié au Conservatoire de Paris.
De 1861 à 1865 il obtient un poste de professeur de piano à l’École Niedermeyer, fondée en 1853 dans le IX e arrondissement de Paris. Là-bas il enseigne notamment à Gabriel Fauré et André Messager. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71, Saint-Saëns s’engage dans le 4e bataillon de la Garde nationale 5 . C’est durant cette période qu’il apprend la mort de l’un de ses amis, Henri Regnault, peintre orientaliste et chanteur, décédé lors de la bataille de Buzenval le 19 janvier 1871. Il lui dédie sa Marche héroïque, op.34, composée pendant la guerre. Après l’insurrection communarde de mars 1871, Saint-Saëns est inquiété en partie à cause de son poste d’organiste de l’Eglise de la Madeleine, mais aussi en raison de son attachement aux causes républicaines.
Il part donc en Angleterre rejoindre ses amis Charles Gounod et Pauline Viardot et arrive au moment de l’ouverture de l’Exposition universelle de Londres de 1871. Il profite de son voyage pour étudier les partitions de Haendel à la bibliothèque du palais de Buckingham. C’est seulement après la fin des troubles politiques que Saint-Saëns retourne en France et fonde alors avec Romain Bussine, le 25 février 1871, la Société nationale de musique. Le but de celle-ci est de favoriser la diffusion des œuvres écrites par les compositeurs français contemporains, jusqu’alors fortement défavorisés dans les sociétés de concerts français au profit d’œuvres de compositeurs allemands. Parmi les fondateurs de cette association on trouve aussi César Franck, Édouard Lalo et Gabriel Fauré. On retrouve là l’un des traits de caractère importants de la fin du XIXe se manifestant chez Saint-Saëns : le patriotisme.
À l’instar de ses contemporains, y compris de nombreux artistes et intellectuels, le patriotisme de Saint-Saëns n’allait pas sans un sentiment de profonde défiance à l’égard de l’étranger, et tout particulièrement des Allemands, ce qui ne l’empêche pourtant pas de retourner en Allemagne, notamment à Bayreuth en 1876.

À partir des années 1870, et ce jusqu’à la fin de sa vie en 1921, Saint-Saëns prend régulièrement la parole dans des tribunes journalistiques, divulguant ainsi sa pensée sur la musique et les musiciens. Sur le plan artistique, Saint-Saëns est plus heureux que dans sa vie personnelle (son mariage est un échec et ses deux enfants meurent en bas âge).
Il fait jouer en 1878 à ses propres frais plusieurs œuvres de Liszt, notamment les poèmes symphoniques, forme qui l’inspire également puisqu’il est le premier compositeur français à en composer. Dans les années 1870 ce ne sont pas moins de quatre poèmes symphoniques que crée Saint-Saëns : Le Rouet d’Omphale (1871), Phaéton (1873), La Danse macabre (1874), La Jeunesse d’Hercule (1877).
Il joue à Windsor le 8 juillet 1880 devant la reine Victoria, qui note dans son journal :
« J’ai entendu un M. Saint-Saëns qui joue merveilleusement de l’orgue, à la Chapelle, et une Mme de Caters Lablache au chant. Il a également joué quelques-unes de ses compositions au piano, et il joue et compose magnifiquement. »
L’année 1888 marque un tournant dans la vie de Saint-Saëns : il perd sa mère, dont il était très proche. Cette disparition l’affecte profondément. Dès lors sa vie change : il voyage énormément, dans 27 pays où il effectue de 1857 à 1921 environ 179 séjours 20 . L’Algérie et l’Égypte sont des destinations privilégiées (il y voyage respectivement à 20 et 16 reprises), qui l’influencent dans ses orientations musicales : le concerto pour piano n°5 est nommé « l’Égyptien ». Il se produit également en Europe, Extrême-Orient, Amérique du Sud (Brésil, Uruguay et Argentine) et Afrique du Nord.
Puis le compositeur revient en France et s’installe à Dieppe, où un musée en son honneur est fondé de son vivant en 1890. La même année il publie un recueil de poèmes intitulé Rimes familières, où strophes, sonnets et poésies diverses se mêlent.
À partir de 1895 Camille Saint-Saëns entreprend avec Charles Bordes et Vincent d’Indy l’édition des œuvres complètes de Rameau chez Durand. Les publications s’échelonnent de 1895 à 1918, mais l’entreprise reste inachevée et seulement 18 volumes paraissent.
En 1896, Fernand Castelbon de Beauxhostes, riche mécène amoureux de sa région, demande à Saint-Saëns de l’aider dans la récolte de fonds pour la réfection des arènes de Béziers. C’est ainsi qu’en 1898 le compositeur organise un concert pour lever des fonds : sa composition Déjanire, sur un livret de Louis Gallet, est représentée sous sa direction le dimanche 28 août à 15 h au théâtre des Arènes 22 devant 8 000 personnes : c’est un triomphe. Béziers est censé devenir le « Bayreuth français ».
En 1908, il compose la toute première musique spécialement composée pour le cinéma, celle du film L’Assassinat du duc de Guise.

Les années qui suivent sont l’occasion de nombreux voyages à travers le monde, notamment en 1915 aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie où il fréquente l’Exposition internationale de San Francisco, où il fait jouer Hail California ! Il écrit parallèlement de nombreux articles contre la musique allemande et, évidemment, contre la vogue du wagnérisme (série d’articles dans L’Écho de Paris sous le titre ironique Germanophilie).
Mais en France les goûts ont changé, et Saint-Saëns n’est plus apprécié comme il l’était au XIXe siècle. Face à la richesse de la production allemande (avec Richard Wagner, bien sûr, mais aussi Arnold Schönberg – le Pierrot lunaire est créé en 1912), mais aussi en comparaison d’autres compositeurs français (Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, Claude Debussy, L’Après-midi d’un faune), le style classique de Saint-Saëns apparaît dépassé, le témoignage d’un temps révolu. Dans les pays anglo-saxons, en revanche, il est considéré comme l’un des meilleurs compositeurs français. Sa tournée de 1915 aux États-Unis remportera ainsi un franc succès. Il a alors 80 ans.
L’année de sa mort, en 1921, à 86 ans, il donne un concert au casino de Dieppe pour les 75 ans de ses débuts de pianiste. Il rentre à Alger pour travailler quelques partitions.
Le 16 décembre il meurt à l’hôtel de l’Oasis, en prononçant, selon la légende, ces mots : « Cette fois, je crois que c’est vraiment la fin. »