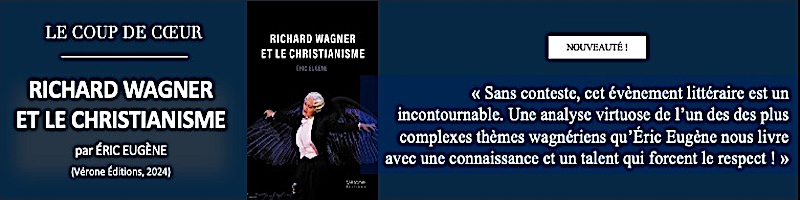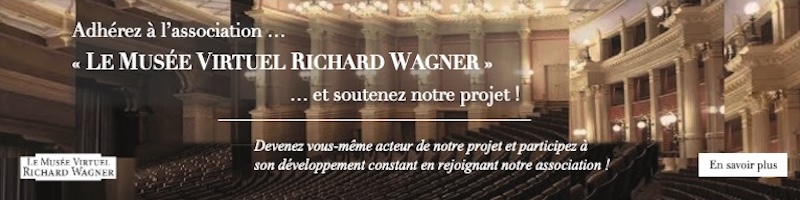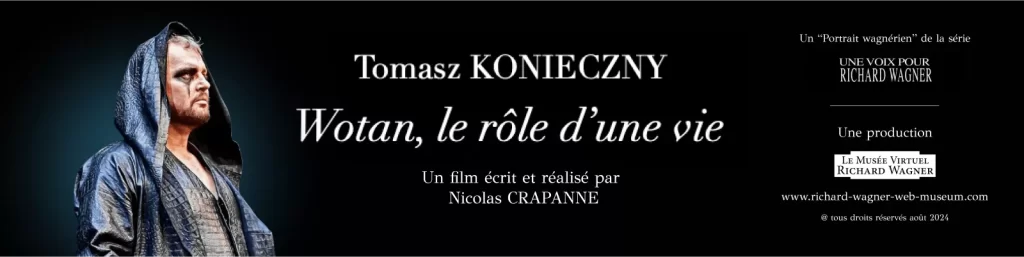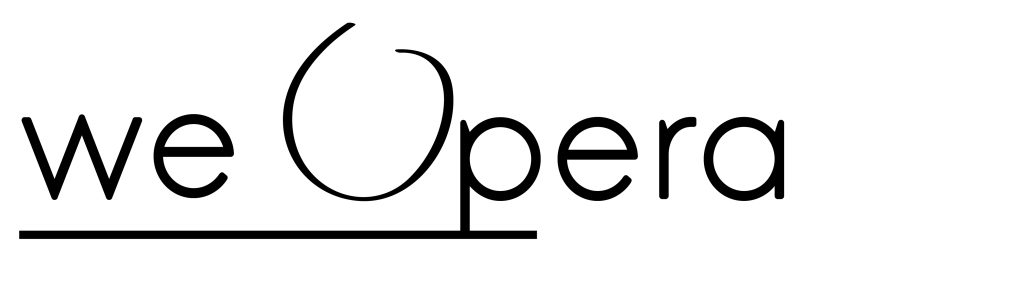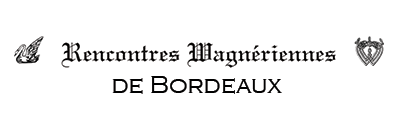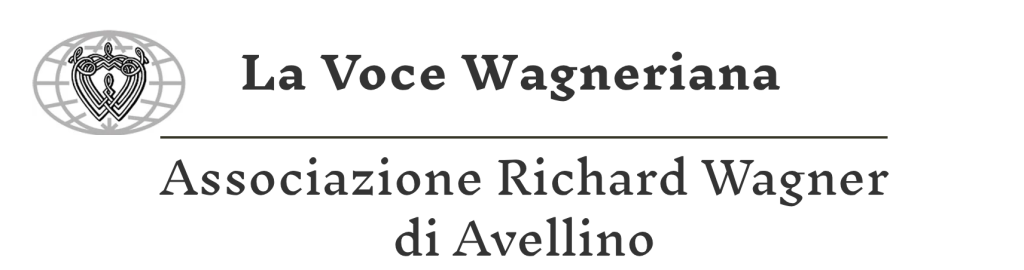Article initialement publié dans les Crónicas Wagnerianas, 2021 (Asociación Wagneriana de Galicia)
Article initialement publié dans les Crónicas Wagnerianas, 2021 (Asociación Wagneriana de Galicia)
et reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’auteure
Titre disponible en espagnol et en anglais sur le site https://www.academia.edu
Pour lire l’article dans son intégralité en anglais, cliquez ici.
Traduction en français @ Le Musée Virtuel Richard Wagner, 2025
Créée à mi-chemin entre Tristan et Isolde (1865) et L’Or du Rhin (1869), cette œuvre [Les Maîtres chanteurs de Nuremberg] se distingue nettement du reste du répertoire wagnérien par le fait qu’elle puise sa matière dans un univers réaliste, peuplé de personnages de chair et d’os, dépourvus de toute dimension magique ou mythologique, et situé dans le XVIᵉ siècle – quand bien même l’atmosphère que Wagner en dessine conserve des réminiscences du Moyen Âge finissant. Son protagoniste, Hans Sachs, a bel et bien existé, bien que la figure historique ait joui d’un rayonnement artistique dépassant largement le cadre de sa ville natale : dès l’âge de dix-sept ans, il parcourut l’Allemagne entière ; sa production écrite, d’une ampleur exceptionnelle — environ six mille œuvres —, lui valut une notoriété qui franchit les frontières de son époque, jusqu’à inspirer, en 1840, une œuvre lyrique (Hans Sachs d’Albert Lortzing), soit vingt-huit ans avant l’opéra de Wagner. Les Maîtres chanteurs sont sans doute l’ouvrage du catalogue wagnérien où se manifeste le plus intensément l’émotion humaine — trait distinctif qui, à mes yeux, l’apparente à un autre chef-d’œuvre, cette fois du XXᵉ siècle, créé un peu plus de quarante ans plus tard : Le Chevalier à la rose (Der Rosenkavalier) -, empreint lui aussi d’une émotivité lumineuse et festive, en contraste marqué avec l’univers de clair-obscur qui imprègne les œuvres wagnériennes, où la balance penche fréquemment du côté des ténèbres. Dans Les Maîtres chanteurs comme dans Le Chevalier à la rose, les antagonistes ne sont jamais que de simples vaniteux de province (Beckmesser) ou des membres arrogants d’une petite noblesse rurale (le baron Ochs, plus rustre que chevaleresque dans son attitude), dont la négativité, si manifeste qu’elle en devient inoffensive, revêt souvent un caractère comique, voire presque attendrissant. Rien de comparable à ces figures troubles qui peuplent l’univers wagnérien, souvent issues d’un ordre supérieur ou d’une essence surhumaine — pensons, par exemple, à Ortrud, Klingsor ou Alberich.
Si l’on examine ce qui sous-tend l’unique comédie de Wagner, on y découvre la représentation minutieuse d’une société bien déterminée, héritière du Bas Moyen Âge et emblématique de l’un des traits majeurs de cette période : l’essor des villes et, corrélativement, l’émergence d’une bourgeoisie urbaine, dont l’importance sociale s’incarne dans le poids des corporations. Ce fait transparaît avec éclat à l’acte III, scène II, dans le défilé solennel des différents corps de métier le matin de la Saint-Jean, où chacun revendique, avec emphase, son rôle historique dans le passé de Nuremberg. Ce même trait structurant réapparaît à la fin du deuxième acte, au cœur du tumulte provoqué par la tapageuse sérénade de Beckmesser : les affrontements de rue s’y enchaînent selon une logique rigoureusement hiérarchique, les groupes intervenant successivement dans un ordre dicté par leur position sociale — d’abord les apprentis, puis les compagnons, enfin les maîtres — révélant ainsi une société profondément cloisonnée et provinciale, dont l’harmonie apparente n’est qu’un fragile vernis dissimulant un climat sous-jacent de conflits et de petites rivalités. Dans cet univers, le chant et la poésie jouent un rôle d’intégration sociale, mais selon une conception de l’art entièrement académique — si l’on peut dire —, consciente de sa fonction représentative, voire institutionnelle, et strictement encadrée par un ensemble de règles immuables, un canon normatif d’une précision extrême dans le détail de ses prescriptions. C’est ce que David, l’apprenti cordonnier, fait valoir à Walther : il existe trois types de durées tonales, ainsi qu’une infinité de tonalités et de mélodies, susceptibles d’évoquer aussi bien des fleurs, des minéraux ou des fruits que des animaux… une telle complexité que le pauvre amoureux de Magdalene finit par regretter amèrement d’avoir choisi de s’adonner à cet art. Pourtant, comme Sachs le confie à Stolzing, cet arsenal de règles minutieusement codifiées procédait, à l’origine, d’une nécessité profonde : celle de conserver vivante et intacte l’évocation poétique d’un chant qui fut d’abord pleinement lyrique — expression pure de l’émotion, souffle vital de la jeunesse face aux lourdes responsabilités et aux préoccupations que le temps fait peser, menaçant d’étouffer ce lyrisme spontané que l’on connaissait dans les premières années de la vie. Ce carcan formel, pour contraignant et rigide qu’il soit devenu, permettait alors de restituer le plus fidèlement possible cette expérience fondatrice du printemps intérieur :
« C’étaient là de très dignes maîtres,
des esprits accablés par les luttes de la vie :
dans le désert de leurs peines,
ils façonnèrent une image
qui leur gardât le souvenir clair et solide
de l’amour de jeunesse,
un gage du printemps reconnaissable. »
Ironie singulière, si l’on songe que ce souffle de renouveau poétique apporté par Walther est aussitôt perçu comme une menace contre les règles séculaires qui régissent, depuis des générations, l’art poétique à Nuremberg. Wagner donne à voir la résistance des maîtres chanteurs à l’irruption de ce jeune noble comme l’allégorie critique d’un affrontement entre deux conceptions de l’art : l’une, académique et codifiée ; l’autre, libre, affranchie des normes officielles. Stolzing incarne même une vision fondamentalement antagoniste de cette civilisation urbaine et bourgeoise propre à Nuremberg — comme le formule sans détour Beckmesser, en le qualifiant de « mauvaise herbe aristocratique et arriviste » (Neu Junkerunkraut – tut nicht gut). Issu de la noblesse, Walther porte en lui tout ce que cette communauté rejette : le monde féodal et rural, qu’il renonce à prolonger — Pogner servant de médiateur dans la vente de ses terres — pour s’intégrer à un ordre nouveau, mû par la conscience du rôle fondamental que jouent ici la poésie et le chant. Notre Walther, descendant de l’un des plus éminents minnesänger, Walther von der Vogelweide — personnage historique que Wagner fait brièvement apparaître dans Tannhäuser —, se sait porteur d’un héritage qu’il lui appartient de poursuivre. Ce legs spirituel de la lyrique courtoise entre en conflit avec une poésie bourgeoise figée, et refait surface de manière impromptue lorsqu’il rencontre Eva, la fille de Pogner, dont il tombe éperdument amoureux. La poésie devient alors existence, elle transgresse les frontières de l’art, se cristallise dans l’idéalisation de l’aimée — élevée au rang de déesse, source de vie ou de mort : « Vie ou mort ? Bénédiction ou malédiction ? Qu’on me le dise d’un mot ! » —, et dans cette sensation d’être transporté ailleurs, comme régénéré dans une existence nouvelle : « Mon cœur est neuf, mon esprit est neuf, tout ce que je commence est neuf ! » Une expérience qui n’est pas sans rappeler celle d’Octavian dans Le Chevalier à la rose, tant dans sa découverte de l’amour passionnel et de la maturité auprès de la Maréchale, que dans le bouleversement soudain provoqué, comme chez Walther, par la fascination imprévue que lui inspire Sophie, la promise du baron Ochs — au point d’en perdre tout contrôle sur lui-même. Notons encore qu’Eva et Sophie, toutes deux riches héritières issues de la bourgeoisie, incarnent, comme on l’a déjà suggéré, cette forme d’absorption de l’ancienne noblesse dans la bourgeoisie triomphante, dont l’influence se reflète dans l’attitude même de ces jeunes femmes. Dès les premières scènes, Eva se révèle comme une jeune femme solidement ancrée dans le réel, faisant preuve d’une habile duplicité lorsqu’elle cherche à tirer de Sachs des informations sur l’entretien à venir entre Stolzing et les maîtres chanteurs. Le personnage straussien, en revanche, adopte une posture toute de fragilité et de vulnérabilité — dont elle mesure parfaitement l’effet —, ce que l’on perçoit immédiatement tant Octavian se trouve aussitôt désarmé par sa présence. Pourtant, ainsi qu’elle le confiera elle-même, bien avant la cérémonie de remise de la rose d’argent, Sophie s’était déjà vivement intéressée au jeune comte Rofrano : elle avait pris soin d’examiner son arbre généalogique et rassemblé quantité de détails à son sujet, y compris son surnom de « Quinquin » — connu de ses amies nobles, comme le laisse échapper malicieusement la fille de Faninal. Qui sait si elle n’envisageait pas déjà, en secret, un « recours sentimental » susceptible de compenser ce mariage arrangé par son père avec un homme aussi fruste — malgré son rang — qu’avancé en âge ? Toutes deux, Eva et Sophie, filles de la bourgeoisie, laissent ainsi transparaître une touche d’opportunisme espiègle, une forme discrète de stratégie picaresque que l’on chercherait en vain chez des figures issues de la noblesse comme Stolzing, Octavian ou la Maréchale.
En définitive, arrêtons-nous à présent sur les deux figures que l’on peut, à juste titre, considérer comme véritablement centrales dans chacune des deux œuvres. Commençons par Hans Sachs. Son rôle s’avère déterminant en ce qu’il rend possible la convergence des mondes évoquée plus haut. À bien des égards, ce poète-cordonnier évoque la Maréchale — en dépit de leurs appartenances sociales fort dissemblables. Pour ma part, je dirais qu’il s’agit là des deux personnages lyriques qui me touchent le plus profondément, tant leur capacité d’empathie et leur finesse de compréhension les rapprochent — à l’instar de Parsifal, on pourrait dire d’eux aussi : durch Mitleid wissend, « instruits par la compassion », tant leur sagesse repose avant tout sur une lucidité née de la bienveillance. Tous deux se tiennent prêts à renoncer à l’amour, guidés en cela par une conscience aiguë des choses telles qu’elles sont. La Maréchale Marie-Thérèse, tout au long de son discours, ne cesse de rappeler l’inéluctable passage du temps, qu’elle accueille avec une sérénité lucide : elle sait qu’elle n’est plus jeune, et qu’Octavian finira par se tourner vers une femme plus belle. Sachs, de son côté, est parfaitement conscient de l’écart d’âge qui le sépare d’Eva, qu’il aime depuis qu’elle est enfant. Il pousse même l’analogie jusqu’à se comparer au roi Marke — l’époux mûr et trompé d’Isolde —, figure tragique d’une autre œuvre wagnérienne. Ce qui unit véritablement ces deux personnages, c’est qu’ils agissent l’un et l’autre comme figures de passage, comme facilitateurs de destin, rendant possible l’accomplissement amoureux de deux jeunes gens, tout en incarnant, ce faisant, l’idéal d’intégration sociale précédemment évoqué. Marie-Thérèse aide Octavian et Sophie avec grâce et naturel. Elle ne se considère pas comme une victime du sort, mais l’affronte avec calme, en marchant à ses côtés. Elle choisit de les soutenir, notamment parce qu’elle reconnaît en Sophie une version plus jeune d’elle-même — la petite Resi —, à l’âge où elle fut, elle aussi, donnée en mariage à un homme beaucoup plus âgé, dans un arrangement dicté par la convenance. La Maréchale, toutefois, ne recourt pas aux stratagèmes bienveillants de Hans Sachs, qui agit selon une stratégie subtile, déployée sur plusieurs fronts. C’est lui qui orchestre le tumulte de la veille de la Saint-Jean, encourageant Beckmesser à chanter toujours plus fort afin d’empêcher la fuite d’Eva et Walther, et d’éviter ainsi la perte de leur avenir. C’est encore lui qui guide Walther dans l’apprentissage du chant, lui enseignant comment interpréter un lied selon les règles établies, afin de remporter le prix. D’une certaine manière, c’est bien Hans Sachs qui, aux côtés de Walther, remporte ce prix, comme le souligne symboliquement Eva lorsqu’elle dépose sur ses tempes la même couronne que celle du vainqueur Stolzing. Sachs, à l’instar du jeune chevalier, sait ce qu’est au fond la poésie :
Mein Freund! Das grad’ ist Dichters Werk,
dass er sein Träumen deut’ und merk’.
Glaubt mir, des Menschen wahrster Wahn
wird ihm im Traume aufgetan :
Autrement dit, l’œuvre propre du poète consiste à donner sens et mémoire à ses rêves. Car, croyez-moi, c’est dans le rêve que se révèle à l’homme sa plus intime vérité — fût-elle folie. Une conception peut-être en décalage avec une société trop arrimée au quotidien, où l’on valorise un art figé, vidé de son pouvoir de révélation. Qui sait si Sachs, tout comme la Maréchale de Strauss, ne recèle pas en lui une véritable âme chevaleresque, malgré les ruses qu’il emploie pour empêcher Beckmesser de remporter le concours — comme le reconnaissent, à demi-mot, les maîtres chanteurs eux-mêmes :
Ei Sachs, ihr seid gar fein !
(Hé Sachs, vous êtes bien habile !)
LAG