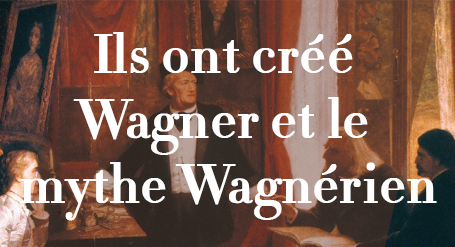
Cette section présente une série de portraits biographiques de ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à l’édification de l’œuvre wagnérienne. Des amitiés ou des inimitiés parfois surprenantes ou inattendues, des histoires d’amour passionnées avec les femmes de sa vie, parfois muses et inspiratrices de son œuvre, mais également des portraits d’artistes (chanteurs, metteurs en scène, chefs d’orchestre…) qui, de nos jours, se sont “appropriés” l’œuvre du compositeur et la font vivre différemment sur scène.
KALERGIS Maria (née Nesselrode)
(née le 7 août 1822 – décédée le 22 mai 1874)
Comtesse polonaise, pianiste et mécène auprès des arts
Maria Kalergis, née Gräfin Maria von Nesselrode-Ehreshoven le 7 août 1822 à Varsovie et décédée le 22 mai 1874 à Varsovie, comtesse, pianiste et mécène polonaise.
 À l’âge de dix-sept ans, Maria Nesselrode épouse Jan Kalergis, un riche propriétaire, qui était beaucoup plus âgé et qui se montrait jaloux. Bien qu’ils aient une fille, Marie, née en 1840 à Saint-Pétersbourg, moins d’un an après leur mariage, ils décidèrent de se séparer. Malgré plusieurs tentatives pour surmonter leur aversion l’un envers l’autre, ils continueront à vivre séparément, sans divorcer, jusqu’à la mort de Jan. Il assure cependant à Maria une vie prospère.
À l’âge de dix-sept ans, Maria Nesselrode épouse Jan Kalergis, un riche propriétaire, qui était beaucoup plus âgé et qui se montrait jaloux. Bien qu’ils aient une fille, Marie, née en 1840 à Saint-Pétersbourg, moins d’un an après leur mariage, ils décidèrent de se séparer. Malgré plusieurs tentatives pour surmonter leur aversion l’un envers l’autre, ils continueront à vivre séparément, sans divorcer, jusqu’à la mort de Jan. Il assure cependant à Maria une vie prospère.
Maria a peut-être été influencée par les expériences de son enfance. Un an après sa naissance, son père, Fryderyk Karol Nesselrode (d’origine allemande) et son épouse Tekla Nałęcz-Górska (d’origine polonaise), s’étaient séparés en raison de différences de personnalité. Dès sa sixième année, Maria est élevée à Saint-Pétersbourg chez son oncle paternel, Karl Robert Nesselrode, diplomate russe d’origine allemande qui assure pendant quarante ans (1816-1856) le poste de ministre des Affaires étrangères du tsar et qui veillait ce que Maria reçoive une excellente éducation.
Elle a peut-être hérité son talent musical de ses parents et elle suit pendant un certain temps les leçons de Chopin, qui loua son talent. Elle apprend le polonais avec sa mère et parle également le français (alors langue des salons polonais), l’allemand, l’anglais, l’italien et le russe.
À partir de 1847, elle habite à Paris, puis à partir de 1857 à Varsovie. Liszt, Richard Wagner, Musset, Moniuszko, Gautier, Heine (qui lui a dédié son poème « L’éléphant blanc ») et Chopin étaient au nombre de ses invités. De retour à Varsovie, elle devient mécène des arts et participe à des concerts de collecte de fonds et à des représentations théâtrales. Ses ressources étaient toujours disponibles pour ceux qui en avaient besoin.
Un jour que la princesse de Bismarck lui demandait si elle croyait à l’infaillibilité du pape, Mme de Mouchanoff répondit par cette profession de foi :
« Je crois à trois infaillibilités : en religion, à celle du pape ; en politique, à celle de Bismarck; en art, à celle de Wagner. »
Ernest Seillière écrit en 1910 dans la Revue des Deux Mondes un article sur « l’inspiratrice de la symphonie en blanc » de Gautier et évoque ses relations avec Richard Wagner. En voici un extrait :
« Au surplus, son influence sur l’évolution de la musique vers le milieu du XIXe siècle n’a pas été négligeable, car elle fut intimement liée avec Liszt, Wagner, Rubinstein et Mme Viardot ; elle applaudit aux débuts de M. Saint-Saëns et se fit l’apôtre passionnée du wagnérisme dans sa patrie polonaise. Elle se donnait elle-même, en manière de plaisanterie, le titre de plénipotentiaire wagnérienne pour les pays slaves et le maître de Bayreuth lui a dédié un de ses opuscules théoriques les plus significatifs : le Judaïsme dans la musique. Non qu’elle fût aveuglément antisémite, tout au contraire, car son esprit pénétrant lui interdisait l’injustice et la prévention. Elle écrit même un jour de Varsovie à sa fille qu’elle ne voit et n’approuve que les Juifs dans cette ville. Eux seuls, en effet, s’intéressent aux bonnes choses, font la charité de leur propre argent, goûtent la musique et soutiennent les artistes. « Si nous restions entre Slaves, conclut-elle dans une énergique boutade, on verrait un tas de fainéants pauvres se manger les uns les autres ! »
 Madame Kalergis n’avait pas été pourtant une wagnérienne militante de la première heure. Son initiation ne s’accomplit que par étapes successives et son goût, formé à l’école classique, hésita quelque temps avant de la porter décidément sur la voie nouvelle. Au lendemain de l’échec célèbre que subit à Paris l’opéra de Tannhäuser, elle juge que l’auteur a eu tort de laisser mutiler son œuvre, mais aussi d’avoir conçu le premier acte si démesurément long. Elle souhaite que son infortune l’éclaire sur les dangers de son propre génie, qui le rend trop dédaigneux des goûts du public. Bien plus, commentant vers la même date la partition de Tristan et Isolde, elle estime que l’œuvre est « tout bonnement impossible : » c’est, dit-elle, « une abstraction curieuse à l’étude et offrant des beautés dont on pourrait dégager une pensée saine, mais qui sera, comme œuvre dramatique, repoussée par tous les publics de l’univers ! » Six années passent cependant, et, après avoir consacré une de ses soirées à l’audition de ce même Tristan, elle aura simplement cette exclamation désormais sans réserves : « Quel chef-d’œuvre ! »
Madame Kalergis n’avait pas été pourtant une wagnérienne militante de la première heure. Son initiation ne s’accomplit que par étapes successives et son goût, formé à l’école classique, hésita quelque temps avant de la porter décidément sur la voie nouvelle. Au lendemain de l’échec célèbre que subit à Paris l’opéra de Tannhäuser, elle juge que l’auteur a eu tort de laisser mutiler son œuvre, mais aussi d’avoir conçu le premier acte si démesurément long. Elle souhaite que son infortune l’éclaire sur les dangers de son propre génie, qui le rend trop dédaigneux des goûts du public. Bien plus, commentant vers la même date la partition de Tristan et Isolde, elle estime que l’œuvre est « tout bonnement impossible : » c’est, dit-elle, « une abstraction curieuse à l’étude et offrant des beautés dont on pourrait dégager une pensée saine, mais qui sera, comme œuvre dramatique, repoussée par tous les publics de l’univers ! » Six années passent cependant, et, après avoir consacré une de ses soirées à l’audition de ce même Tristan, elle aura simplement cette exclamation désormais sans réserves : « Quel chef-d’œuvre ! »
En 1869, elle allait visiter, dans leur retraite de Triebschen, Richard Wagner et Mme Cosima de Bülow, alors sur le point de régulariser une situation qui était à ce moment fort délicate, et elle adressait à sa fille ce joli tableau d’intérieur : « Ne vous indignez pas contre moi, mais j’aime Mme de Bülow autant que par le passé, avec une nuance d’attendrissement en plus. Elle subit une situation qu’elle avait voulu éviter et où l’ont fatalement amenée l’égoïste passion de Wagner, la grandeur d’âme de M. de Bülow et les persécutions, les infamies du monde grand et petit, si acharné contre tout ce qui le domine… Rien de plus grave que leur intérieur ! Wagner, en houppelande de velours noir, avec le bonnet de magister, des lunettes sur le nez : elle, avec sa jeune et jolie taille, a l’air de sa fille, lit sa pensée dans ses yeux et l’achève comme si leur âme était une en deux personnes. Elle pleure beaucoup, élève ses enfants à merveille et travaille jour et nuit à la gloire de celui qui résume à ses yeux toutes les perfections. »
La visiteuse dut aussi rencontrer à Triebschen le jeune Nietzsche, récemment installé dans sa chaire académique, car elle parle de lui peu après comme du « charmant professeur de Bâle, » ce qui laisse supposer que l’Eliacin du wagnérisme lui avait été présenté. Ses relations avec Wagner restèrent des plus amicales jusqu’à sa mort : elle écrit encore en 1872 qu’elle va chercher ses instructions chez l’empereur de la musique et que la comtesse Schleinitz l’ayant supplantée dans les bonnes grâces du maître, elle entend reconquérir près de lui sa situation privilégiée d’autrefois. Elle ne renonce pas en effet sans protestation à la première place dans le cœur de ceux qu’elle admire et qu’elle aime. N’a-t-elle pas un jour avoué à son vieil ami Liszt qu’elle éprouvait à son égard « un sentiment de jalousie souffrante » qui paralysait vis-à-vis de lui toute sa spontanéité naturelle.
 Le wagnérisme de la comtesse Mouchanoff fait aussi l’objet d’un long passage dans les articles que Jacques-Gabriel Prod’homme publia en trois parutions dans Le Ménestrel des 1er, 8 et 15 août 1930 sous le titre UNE GRANDE DAME COSMOPOLITE ET DILETTANTE La Comtesse Mouchanoff. La première partie de son dernier article évoque les activités musicales de la comtesse de 1868 à 1870 :
Le wagnérisme de la comtesse Mouchanoff fait aussi l’objet d’un long passage dans les articles que Jacques-Gabriel Prod’homme publia en trois parutions dans Le Ménestrel des 1er, 8 et 15 août 1930 sous le titre UNE GRANDE DAME COSMOPOLITE ET DILETTANTE La Comtesse Mouchanoff. La première partie de son dernier article évoque les activités musicales de la comtesse de 1868 à 1870 :
» En 1868, M. de Mouchanoff ayant été nommé président du théâtre de Varsovie, c’est une distraction pour sa femme, que la maladie oblige à plus de stabilité. Sa bonté pour le personnel du théâtre la fait surnommer la » mère des artistes « . La musique la reprend plus que jamais. » La musique, c’est la poésie de ma vie, : écrit-elle à sa fille, des bains de Rehme, en août 1869. Que ne m’y suis-je sérieusement consacrée au lieu de pleurer des malheurs imaginaires ou passagers ! Le beau est une moindre forme du bien et peut y conduire ceux qui sont trop faibles ou trop fourvoyés pour suivre les voies spirituelles. » A Dresde, une représentation admirable de Lohengrin, « à plus belle à laquelle elle ait assisté de sa vie », l’a fait pleurer comme une malheureuse… « Als Wagnerianerin, je ne manque pas un opéra de Mozart où j’applaudis fort, chose très remarquée de l’orchestre. Depuis la fameuse brochure (1), je suis devenue un personnage musical. En somme, l’amour de la musique remplit ma vie ». Les Maîtres Chanteurs sont un « chef-d’oeuvre incomparable, qui place Wagner à côté de Shakespeare et : d’Eschyle ».
De Munich, en septembre 1869, une page intéressante sur le « chapitre Wagner »
« Ne vous indignez pas contre moi, écrit Mme de Mouchanoff à sa fille, mais j’aime Mme de Bülow autant que par le passé, avec une nuance d’attendrissement en plus. Elle subit une situation qu’elle avait voulue et où l’ont fatalement amenée l’égoïste passion de Wagner, la grandeur d’âme de M. de Bülow et les persécutions, les infamies du monde grand et petit, si acharné contre tout ce qui le domine. Elle ne veut pas changer de religion, espère se marier dans deux mois chez le beau-père de M. Schuré (pasteur protestant d’Alsace) et rentrer à Triebschen pour y vivre et mourir. Leur retraite est profonde, Wagner ne reçoit que ses parents et ses dévoués, parle avec une noble indépendance de la possibilité d’une rupture avec le roi, préférant sauver son oeuvre et perdre sa fortune. Celle-ci consiste dans ses 6000 florins de pension et le revenu des opéras, éditions et représentations. Rien de plus grave que leur intérieur. Wagner en houppelande de velours noir, avec le bonnet de Magister, des lunettes sur le nez ; elle, mit ihrer jungfräulichen Gestalt[i] a l’air de sa fille, lit sa pensée dans ses yeux et l’achève comme si leur âme était une en deux personnes. Elle pleure beaucoup, élève ses enfants à merveille et travaille jour et nuit à la gloire de celui qui résume à ses yeux toutes les perfections. Wagner l’a autorisée à me lire l’esquisse de Parsifal, l’ouvrage qu’il réserve pour la fin de sa vie, si elle est assez longue. Aucune poésie, aucune littérature n’aura jamais rien de semblable. C’est trop grand, trop angélique, trop chrétien pour l’appeler opéra. Sublime de profondeur symbolique, de clarté et de mouvement dramatique. Je vous le raconterai. Cosima pleurait en le lisant, moi en l’écoutant. Quand nous avons fini, Wagner a dit : « N’est-ce pas que cela vous étonne qu’un homme accusé d’être un Casanova, » pense à de pareilles choses ? » Les Mendès, M. de Villiers de l’Isle-Adam et Servais sont venus à Triebschen en même temps que moi. J’ai assisté à la réception de Mlle Holmes, escortée deRichter, d’un juif wagnérien, M. Glaser, et de son père. Wagner était sehr kühl au commencement, il a trouvé sa manière de chanter Isolde affreuse, mais a fait un sincère éloge de ses compositions. La petite Holmes était pâle et tremblante, plus rien de son aplomb, de sa peinture ni de ses toilettes. Une modeste robe noire et des révérences jusqu’à terre. Wagner supporte à peine les Mendès. Cependant il nous a chanté la fin de Siegfried, un duo d’amour titanique et tout neuf qui s’élance dans une espèce de Jodeln passionné. Nul mieux que lui ne donne l’idée de sa musique. Mais s’il n’établit pas une tradition, ce génie, le plus grand que l’Allemagne ait eu, restera obscur pour la postérité ».
Du même séjour à Munich, qui se prolongea jusque vers la fin de l’année, date le beau portrait de la comtesse par Lenbach. « C’est un grand artiste qui n’admet ni les robes décolletées, ni les manches courtes. Avec cela très modeste et spirituellement vrai. Ses portraits jusqu’aux genoux coûtent 500 florins. Quelle misère ! Et les connaisseurs disent qu’ils vaudront 5.000 d’ici dix ans… » Lenbach représenta Mme de Mouchanoff de face, le visage presque seul éclairé sur le fond sombre qu’il devait adopter pour presque tous ses portraits. Le visage, toujours régulier, marque une grande douceur, peut-être un peu de lassitude, qu’accentuent encore les yeux légèrement clignotants, ces yeux de myope dont parle Sir Frederik St. John. Un grand air de noblessemet de simplicité s’exprime dans ce portrait d’une femme de quarante-cinq ans qui n’a plus que peu d’années à vivre.
[…]
Le pèlerinage wagnérien continue : après une visite à Eisenach et à la Wartbourg, « lieu poétique entre tous, consacré par les souvenirs les plus chers aux Allemands », Mme de Mouchanoff, en compagnie de Liszt, de Mme de Schleinitz, arrive à Munich pour les représentations du Rheingold et de la Walküre. « Quel bonheur de vivre en même temps que le plus grand génie du monde germanique et de pouvoir s’édifier à ses chefs-d’oeuvre ! Nous sommes tous réunis ici, comme à l’époque du Rheingold.Vous seule manquez, écrit, vers le milieu de juillet, Mme de Mouchanoff à sa fille. La bande de musiciens enthousiastes a défilé hier devant moi : le comte Usedom , Werthern , Bassenheim, Saint-Saëns, Lassen, les Servais et tutti quanti. » Or, à ce moment même où les wagnériens sont réunis à Munich, dans une manifestation importante, arrivent les nouvelles de la déclaration de guerre. Sans transition, Mme de Mouchanoff, que l’événement intéressera prodigieusement – on s’en doute, – écrit : « Mais quelles terrifiantes nouvelles politiques. Une guerre sur le Rhin serait pour moi la fin de toute joie. Saint-Saëns disait hier : «Sommes-nous heureux d’être au monde pour entendre le Rheingold et la Walküre ! » Faut-il qu’ils soient assez insensés et coupables ceux qui, pour de misérables questions de vanité nationale, fouleront aux pieds la moisson du ciel et celle du génie ! […] »
Maria Kalergis a eu une influence appréciable sur le développement de la culture musicale, en contribuant à la fondation de l’Institut de musique de Varsovie (aujourd’hui le conservatoire de Varsovie) et en fondant avec Moniuszko la Société de musique de Varsovie, aujourd’hui le Philharmonique de Varsovie. En 1857–1871, elle se produit fréquemment en tant que pianiste.
 Peu de temps après la mort de son mari en 1863, elle épousa Siergiej Muchanow, son cadet de dix ans. Il l’accompagna pendant sa maladie (un cancer dans la partie abdominale) et l’a soignée avec dévouement pendant ses derniers jours. C’est probablement à ce moment-là que, sentant sa fin prochaine, Maria détruisit sa correspondance. Ses lettres à sa fille, à son gendre et à ses amis ont toutefois survécu et ont permis de reconstituer de nombreux faits sur sa vie et constituent une source précieuse de connaissances sur cette période. Elle a été enterrée au cimetière Powązki à Varsovie.
Peu de temps après la mort de son mari en 1863, elle épousa Siergiej Muchanow, son cadet de dix ans. Il l’accompagna pendant sa maladie (un cancer dans la partie abdominale) et l’a soignée avec dévouement pendant ses derniers jours. C’est probablement à ce moment-là que, sentant sa fin prochaine, Maria détruisit sa correspondance. Ses lettres à sa fille, à son gendre et à ses amis ont toutefois survécu et ont permis de reconstituer de nombreux faits sur sa vie et constituent une source précieuse de connaissances sur cette période. Elle a été enterrée au cimetière Powązki à Varsovie.
À sa mort, Liszt écrivit une élégie sur Maria Kalergis (Elégie N°1, S. 196 pour piano).
LR /CPL
________
1- Avec sa taille de jeune fille
Vous souhaitez apporter des informations complémentaires et ainsi enrichir cet article, contactez-nous !
