 Comme partout, à la fin du XIXè siècle, l’œuvre de Wagner est acceptée et partiellement admirée à Vienne. Cette reconnaissance n’alla pas sans peine. Songeons aux efforts du compositeur lui-même.
Comme partout, à la fin du XIXè siècle, l’œuvre de Wagner est acceptée et partiellement admirée à Vienne. Cette reconnaissance n’alla pas sans peine. Songeons aux efforts du compositeur lui-même.
En 1862, il s’apprête à fonder son existence sur un consentement accordé à la légère par l’intendant de l’opéra, mettre en scène Tristan et Isolde. Pour ce faire, Wagner s’installe à Vienne. Mais tout va de travers, sa musique n’est pas comprise, les chanteurs ne sont pas disponibles. Une circonstance aurait dû l’aider : le docteur Josef Standhartner, qui lui donne souvent l’hospitalité, organise dans son appartement une lecture des Maîtres Chanteurs.
Il a invité le célèbre critique musical Hanslick ; or celui-ci croit se reconnaître dans le personnage de Beckmesser, d’où des critiques de plus en plus blessantes. Pourtant, à un concert organisé le 26 décembre 1862, au Theater an der Wien, une ovation accueille l’arrivée du maître au pupitre et l’Impératrice Elisabeth, présente dans la salle, applaudit des extraits des Maîtres Chanteurs et du Ring. Un deuxième concert a lieu le jour de l’an, et n’attire pas grand monde ; le troisième est mieux fréquenté mais l’entreprise se solde par un déficit. Entre-temps, les travaux de préparation pour Tristan n’avancent pas. Wagner se rend à Moscou, à Saint-Pétersbourg, où il espère quelques profits des concerts qu’il dirige. De retour à Vienne, il loue un appartement à Penzing, près de Schönbrunn, qu’il aménage luxueusement.
Il part pour Pest et la Tchécoslovaquie pour y diriger, mais le rapport du voyage n’éteint pas du tout ses dettes. A la fin de novembre 1863, Cosima et lui se sont avoué leur amour, ce qui n’empêche pas des envies suicidaires au printemps de 1864. En effet, tout va mal, le projet de Tristan est définitivement abandonné et les dettes de Wagner se montent à 12.000 florins (l’équivalent de 100 000 euros). Le 23 mars, il s’enfuit littéralement de Vienne pour échapper à la prison pour dettes, se rend à Munich, chez ses amis Wille à Mariafeld, enfin à Stuttgart. Il est sans domicile fixe et attend un miracle. Le miracle se produira le 3 mai sous la forme de la visite d’un envoyé de Louis II.
Que de déboires donc à Vienne ! Pourtant son œuvre est présente et le sera de plus en plus dans la décennie qui va suivre. Ainsi Johann Strauss, depuis 1848, année où il joua la marche de Tannhäuser dans une grande réunion estudiantine, avait coutume de mettre au programme de ses concerts des extraits d’opéra de Wagner ; il fut suivi en cela par son frère Josef.
 En 1872, un concert dirigé par Wagner en personne dans la grande salle du Musikverein au profit de la construction du Festspielhaus de Bayreuth rapporte la somme considérable de 16.000 florins. A l’occasion de l’exposition universelle de 1873, un visiteur d’origine souabe, un ingénieur, Max Eyth note dans son journal le 7 mai : « Le soir, pour remplir encore mieux ce jour qui n’était pas vide, j’allai à l’opéra voir Lohengrin. Quelle splendeur ! »
En 1872, un concert dirigé par Wagner en personne dans la grande salle du Musikverein au profit de la construction du Festspielhaus de Bayreuth rapporte la somme considérable de 16.000 florins. A l’occasion de l’exposition universelle de 1873, un visiteur d’origine souabe, un ingénieur, Max Eyth note dans son journal le 7 mai : « Le soir, pour remplir encore mieux ce jour qui n’était pas vide, j’allai à l’opéra voir Lohengrin. Quelle splendeur ! »
C’est en 1875 que les succès se multiplient. Stefan Zweig se souvient, dans Le monde d’acier, que son père comme tous les Viennois de sa classe et de son âge, se passionnait pour l’opéra et assista, cette année-là, avec enthousiasme, à la représentation de Lohengrin sous la direction du Maître, comme plus tard aux représentations de Richard Strauss. A. Willebrand se rappelle dans ses Mémoires, la fête extraordinaire donnée en mars 1875 en l’honneur du compositeur. Elle fut organisée par Hans Makart, le peintre le plus représentatif des années 70 et le « maître des plaisirs » de la bonne société viennoise, avec tout le luxe et la pompe qui caractérisait ses productions. En 1876, Wagner renouvela l’expérience de la direction avec le même succès. Et pendant les trois dernières décennies du siècle, ses œuvres sont régulièrement programmées à l’Opéra de la cour.
Il est vrai aussi que les critiques ne clésarment pas. Le prouve, par exemple, cet extrait d’un compte-rendu de la représentation des Maîtres-Chanteurs, le 27 février 1870 : « Au milieu du deuxième acte, alors que, ça et là, des sifflets isolés s’étaient osés à de vigoureux applaudissements, le charivari se déchaîna. À partir de la fameuse sérénade de Beckmesser, un infernal concert de sifllements et de grognements inarticulés auquel répondaient, de l’autre côté, des applaudissements redoublés, recouvrit complètement les chanteurs et l’orchestre jusqu’à la conclusion poétique complètement perdue ce soir-là. A un cheveu près, la bagarre qui se déroulait sur scène se serait transportée dans la salle. »
C’est du camp libéral qu’émane la plus violente critique dont les critères ne sont pas uniquement de nature musicale et esthétique, bien plutôt politique. La prise de position antisémite de Wagner – qui voyait une vengeance du judaïsme dans les attaques pas toujours objectives dirigées contre lui – indispose les libéraux, stimule à la fois protestations et approbations dans le camp adverse.
Un autre compte-rendu en témoigne, de Ludwig Speidel dans le journal viennois Fremdenblatt du 15 octobre 1876 après la première représentation de L’Or du Rhin :
« Le fleuve allemand n’a rien de commun avec cette honteuse singerie dramatico-musicale, et s’il devait trouver un véritable plaisir à l’or trompeur du Nibelung enfin, cela suffirait à le rayer de la liste des pays occidentaux amis des arts ! »
La même année, 1876, après la création du Ring au premier festival de Bayreuth, Eduard Hanslick souligne l’analogie qu’il découvre entre la peinture de Makart, la poésie de Hamerling et la musique de Wagner, et formule ainsi sa pensée :
« C’est par son charme sensuellement enivrant que cette musique, telle une excitation nerveuse, avait sur le grand public, particulièrement sur le public féminin. »
 Le personnage, Hanslick, mérite qu’on lui consacre quelques mots. Il fut à Vienne le critique musical qui faisait la pluie et le beau temps et sa longévité (1825-1904) lui permit d’exercer une réelle influence sur le goût musical. Sa compétence, d’ailleurs, est admise et il enseigna l’esthétique et l’histoire de la musique à l’Université de Vienne de 1856 à 1895. Wagner, il l’avait apprécié jusqu’à Tannhäuser, mais sa théorie de la musique pure, excluant toute fonction d’expression, l’éloigna du compositeur comme plus tard de Bruckner et de Tchaïkovsky et en fit le champion de Brahms et de Verdi. Après avoir entendu les Maître Chanteurs, il mène la cabale et écrit dans le journal de la bourgeoisie libérale Die Neue Freie Presse :
Le personnage, Hanslick, mérite qu’on lui consacre quelques mots. Il fut à Vienne le critique musical qui faisait la pluie et le beau temps et sa longévité (1825-1904) lui permit d’exercer une réelle influence sur le goût musical. Sa compétence, d’ailleurs, est admise et il enseigna l’esthétique et l’histoire de la musique à l’Université de Vienne de 1856 à 1895. Wagner, il l’avait apprécié jusqu’à Tannhäuser, mais sa théorie de la musique pure, excluant toute fonction d’expression, l’éloigna du compositeur comme plus tard de Bruckner et de Tchaïkovsky et en fit le champion de Brahms et de Verdi. Après avoir entendu les Maître Chanteurs, il mène la cabale et écrit dans le journal de la bourgeoisie libérale Die Neue Freie Presse :
« Seul un cannibale qui s’est brûlé la bouche avec un morceau de viande humaine peut composer une œuvre pareille. »
On peut s’interroger sur la pertinence de la comparaison… Et en 1883, à l”occasion de la représentation de Parsifal, il se permettait encore ce commentaire : « Malgré les efforts de cent associations Wagner pour saluer dans la mystique chrétienne le sauvetage de l’art futur, le temps présent (. . .) peut continuer à vivre et à agir sans se soucier de l’ineptie barbare d’une mythologie nordique à demi comprise que l’on veut nous imposer comme nouvel évangile [il reprend là les propos de Scherer au sujet du Nibelungenríng]. De même, cet évangile artistique, tout nouveau, celui de la mystique chrétienne, devrait rester isolé, malgré sa brillante incarnation en Parsifal. »
En face de ces adversaires acharnés, il existe heureusement, dans la Vienne d’alors, des soutiens fervents, en tête desquels il faut placer le chef d’orchestre Hans Richter, qui dirige l’Orchestre Philharmonique depuis 1875. Et on peut retenir de la dernière citation de Hanslick la mention des « cent associations Wagner ». En effet, elles se sont multipliées, à Vienne et en province. Ainsi l’une d’elles, dans la capitale de la Carinthie, Klagenfurt, est digne d’une mention : elle est dirigée par le musicien Edwin Komau qui a pour élève, en 1895, un certain Anton Webern. Komau éduque ses protégés dans le culte de Bach et des « modernes » Wagner et Richard Strauss. Autre marque de reconnaissance sans réserve : en 1903, Gustav Mahler, directeur de l’Opéra, confie la mise en scène de Tristan et Isolde à Alfred Roller, un des fondateurs de la Sécession et ami de Klimt. Roller imagine un système scénique reposant plutôt sur l’éclairage que sur l’implantation de décors, anticipant de façon saisissante la démarche ultérieure de Wieland Wagner. Roller collabore avec Mahler pour une vingtaine d’œuvres.
Ainsi, malgré la hargne persistante de Hanslick et consorts, Wagner, à la fin du XIXè siècle, fait partie des maîtres déjà « classiques », les « modernes » étant plutôt Richard Strauss, Anton Bruckner et Gustav Mahler qui, tous trois, ne peuvent renier un héritage wagnérien.
Est-ce à dire que la vie culturelle viennoise est, à cette époque, un long fleuve tranquille ?
Assurément pas. Pour le démontrer, j’emprunte à Dominique Jameux sa formule et une partie de ses développements : 1897, les trois coups de la modernité.
 Premier coup : en avril, a lieu l’enterrement de Brahms, devenu malgré son origine nordique une silhouette familière à tous les Viennois. Il va rejoindre au Zentralfriedhof Gluck, Beethoven, Schubert. Pendant plus d’un quart de siècle, les Viennois ont apprécié sa personne, son mode de vie, sa musique empreints d’une sorte d’intimité, de sensibilité, de Gemütlichkeit (bien-être) propre au Biedermeier où, croyait-on en 1897, il faisait bon vivre. Il fut un temps directeur de la Société des amis de la musique et le Musikverein, bâti en 1870 non loin du Ring semble fait pour abriter sa musique. Avec la mort de Brahms, un monde disparaît.
Premier coup : en avril, a lieu l’enterrement de Brahms, devenu malgré son origine nordique une silhouette familière à tous les Viennois. Il va rejoindre au Zentralfriedhof Gluck, Beethoven, Schubert. Pendant plus d’un quart de siècle, les Viennois ont apprécié sa personne, son mode de vie, sa musique empreints d’une sorte d’intimité, de sensibilité, de Gemütlichkeit (bien-être) propre au Biedermeier où, croyait-on en 1897, il faisait bon vivre. Il fut un temps directeur de la Société des amis de la musique et le Musikverein, bâti en 1870 non loin du Ring semble fait pour abriter sa musique. Avec la mort de Brahms, un monde disparaît.
Deuxième coup en octobre de la même année : Gustav Mahler, jusque-là premier Kapellmeister de l’Opéra, devient directeur en titre. Il le restera jusqu’en 1907 et marquera l’illustre maison de son empreinte : d’abord plus en tant que chef d’orchestre et réformateur des mœurs qui y régnaient que comme compositeur. Il veut venir à bout de la Schlamperei (laisser-aller) qui avait peu à peu terni la réputation de l’Opéra : il faut renouveler la mise en scène et les décors (ce sera la tâche de Roller), rétablir les oeuvres dans leur intégrité, c’est-à-dire sans coupures, et dans leur langue originale, imposer le clavecin pour le recitativo secco, supprimer la claque, restreindre les intrigues. Il sera un modèle de directeur sur trois plans : musical, interprétatif et administratif.
 Troisième événement, toujours en avril 1897 qui marque la vie culturelle : le directeur de la Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens (association des artistes plasticiens de Vienne) reçoit une lettre du peintre Gustav Klimt. L’association de 383 membres en question a été fondée en 1861 et tous les ans organise une exposition de ses artistes qui est un « must » de la vie viennoise. Elle est conservatrice mais sans exagération et Klimt en est un membre éminent. Or sa lettre annonce qu`un certain nombre d’artistes, dont lui-même, va faire sécession, organiser sa propre exposition. Ceux-ci veulent un art plus libre, moins soumis à l’Histoire, plus jeune en un mot, et le proclament dans le titre de la revue qu’ils fondent Ver Sacrum (printemps sacré).
Troisième événement, toujours en avril 1897 qui marque la vie culturelle : le directeur de la Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens (association des artistes plasticiens de Vienne) reçoit une lettre du peintre Gustav Klimt. L’association de 383 membres en question a été fondée en 1861 et tous les ans organise une exposition de ses artistes qui est un « must » de la vie viennoise. Elle est conservatrice mais sans exagération et Klimt en est un membre éminent. Or sa lettre annonce qu`un certain nombre d’artistes, dont lui-même, va faire sécession, organiser sa propre exposition. Ceux-ci veulent un art plus libre, moins soumis à l’Histoire, plus jeune en un mot, et le proclament dans le titre de la revue qu’ils fondent Ver Sacrum (printemps sacré).
Cette Vereinigung bildender Künstler Österreichs sera communément appelée Sezession et se séparera bientôt de la Genossenschaft préexistante. Les artistes sont Kolo Moser, Carl Moll, Josef Hoffmann, Alfred Roller. A la première exposition, le 26 mars 1898, l’empereur François Joseph est présent et la ville de Vienne attribue à l’association un terrain pour y construire un bâtiment représentatif. L’architecte Olbrich s’y emploie et inscrit au-dessus de l’entrée la devise célèbre : « Jeder Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit » (a chaque époque son art, à l’art sa liberté). Le groupe ne vivra de cette forme offcielle que jusqu’en 1905, mais il aura joué un rôle déterminant pour mettre la peinture viennoise à l’heure de la peinture européenne, symbolisme et Art Nouveau.
D’autres événements marquent l’année 1897 : la construction de la Grande Roue du Prater, comparable à la Tour Eiffel pour son poids de symbole d’une ville et aussi métaphore du mouvement perpétuel du temps. Ou bien le début de l’autoanalyse de S. Freud qui lui permettra de publier en 1900 L’interprétation des rêves. Ou encore la ratification par l’empereur François Joseph de l’élection de Karl Lueger comme maire de Vienne, effective deux ans plus tôt, mais non acceptée par le souverain. Enfin c’est en été 1897 que se tient à Bâle le premier congrès sioniste sous la présidence du fondateur du mouvement, le Viennois Theodor Herzl.
Et Wagner dans tout cela ? Dans cette effervescence, il a sa place : on le joue à l’Opéra ou dans ses réductions pour le piano, on se rend à Bayreuth. Avant de nous attarder sur le témoignage d’Arthur Schnitzler, il nous faut considérer deux manifestations, de son influence moins évidentes, moins connues du public mélomane car elles sont l’émanation de sa pensée autant ou plus que de sa musique.
 D’abord, selon l’historien américain Carl E. Schorske, le premier vecteur notoire d’une influence wagnérienne dans la vie culturelle viennoise est un urbaniste, Camillo Sitte (1843-1903), malgré son prénom, bien viennois. Son père Franz Sitte était lui-même architecte et restaurateur de cathédrales ; il défendait avec conviction une conception artisanale, médiévale, de l’art de construire, au service d’une société préindustrielle pourtant moribonde ; très hostile à l’essor industriel marquant les années de libéralisme triomphant (1860-1890), il rejetait le professionnalisme universitaire et la tutelle de l’Etat. Son fils Camilo fut imprégné de ces conceptions passéistes mais accepta cependant de fonder et de diriger à Vienne l’Ecole nationale des Arts et Métiers, en 1883 (StaatsGewerbeschule), en laquelle il voyait le moyen, justement, de préserver un enseignement artisanal sous la houlette de l’Etat. En 1889, Camillo Sitte publia un ouvrage résumant ses vues et ses espoirs d’une architecture au service de la cité : Der Stãdtzkau avec pour sous-titre : « La construction urbaine selon ses principes artistiques. » L’homme moderne devait réussir à recréer par une analyse esthétique ce qu’avait réalisé dans le passé la pratique de la vie artisanale. C’est en s’appuyant sur certaines vues théoriques de Wagner que Sitte échafaude ses théories urbanistiques.
D’abord, selon l’historien américain Carl E. Schorske, le premier vecteur notoire d’une influence wagnérienne dans la vie culturelle viennoise est un urbaniste, Camillo Sitte (1843-1903), malgré son prénom, bien viennois. Son père Franz Sitte était lui-même architecte et restaurateur de cathédrales ; il défendait avec conviction une conception artisanale, médiévale, de l’art de construire, au service d’une société préindustrielle pourtant moribonde ; très hostile à l’essor industriel marquant les années de libéralisme triomphant (1860-1890), il rejetait le professionnalisme universitaire et la tutelle de l’Etat. Son fils Camilo fut imprégné de ces conceptions passéistes mais accepta cependant de fonder et de diriger à Vienne l’Ecole nationale des Arts et Métiers, en 1883 (StaatsGewerbeschule), en laquelle il voyait le moyen, justement, de préserver un enseignement artisanal sous la houlette de l’Etat. En 1889, Camillo Sitte publia un ouvrage résumant ses vues et ses espoirs d’une architecture au service de la cité : Der Stãdtzkau avec pour sous-titre : « La construction urbaine selon ses principes artistiques. » L’homme moderne devait réussir à recréer par une analyse esthétique ce qu’avait réalisé dans le passé la pratique de la vie artisanale. C’est en s’appuyant sur certaines vues théoriques de Wagner que Sitte échafaude ses théories urbanistiques.
Il était lui-même bon violoncelliste amateur et avait pour meilleur ami Hans Richter, le chef d’orchestre tout dévoué à l’œuvre de Wagner. A partir de 1871, le nationalisme exprimé par le compositeur dans certains de ses écrits gagna l’adhésion de maints jeunes intellectuels viennois. Et la crise boursière de 1873 ne manqua pas de conférer un attrait particulier à la glorification des corporations médiévales, en opposition à la société capitaliste moderne. Sitte fut attiré par ce courant et demeura sa vie durant un wagnérien inconditionnel. Il était un fidèle du festival de Bayreuth ; grâce à son ami Richter et à Josef Hoffmann, auteur des décors, un familier de Semper, le célèbre concepteur des plans du théâtre de Bayreuth. Lorsqu’en 1876, son premier fils vint au monde, Sitte le prénomma Siegfried, et dans son appartement de fonction de l’École des Arts et Métiers, il fit décorer le plafond de scènes tirées de L’Anneau du Nibelung.
En 1875, il prononça une allocution au Wagner-Verein de Vienne où il exposa qu’il avait trouvé chez le compositeur le cadre intellectuel nécessaire à la défense des valeurs artisanales contre le matérialisme moderne. A un niveau philosophique, il fallait trouver un mythe unificateur pour contrecarrer l’éclatement de l’existence propre à la condition de l’homme moderne.
La frénésie historisante qui, dans les années 60, avait présidé à la construction de la Ringstrasse viennoise n’était qu’un leurre, tout juste bon à faire revivre des fantômes. Il fallait susciter un nouvel idéal exposé de manière concrète, qui se situerait « à côté et au dessus du monde réel » pour réunifier les valeurs humaines dans la vision d’un avenir cohérent. Pour Sitte, Wagner est le génie qui a défini cette mission à l’artiste, cette tâche rédemptrice. L’artiste doit recréer le monde que les aventuriers sans scrupule du commerce et de la science ont détruit. Il doit redonner au Volk un mythe vital. Wagner a doublement ouvert la voie aux yeux de Sitte : comme inventeur du Gesamtkunstwerk et comme créateur d’un héros mythique de salut national.
Comme Siegfried, par sa force innocente et par sa volonté, ressoude les fragments de l’épée paternelle, l’artiste moderne doit faire surgir de son œuvre la force de vaincre l’éclatement individualiste. Certes le Volk est conservateur et même philistin mais il est capable de répondre à l’appel du génie et de reconnaître les valeurs les plus hautes. Ainsi, les bourgeois des Maîtres Chanteurs sont à l’image d’un peuple en pleine maturité. Cependant, trop soumis aux forces destructrices, le peuple a besoin d’artistes salvateurs, tel Siegfried, bâtissant l’avenir.
 Sitte consacra sa vie à promouvoir l’idéal wagnérien dans sa conception de l’urbanisme. Il voulait réorganiser l’environnement construit par l’homme sur une base artistique, c’est-à-dire très fortement communautaire. L’urbaniste, comme le compositeur pour Wagner, doit régénérer la culture. Dans l’optique de Sitte, la ville ne doit pas être le simple produit mécanique de la bureaucratie mais une œuvre d’art qui ait une âme, un pur produit de l’art populaire. Hélas, beaucoup de mal est déjà fait et l’urbaniste ne peut guère concevoir une ville dans son entier. Mais il faut au moins créer une place ; ce que l’opéra est à Wagner, la place l’est à Sitte, une œuvre d’art pour le futur. Elle doit intégrer les différents arts dans un Gesamtkunstwerk visuel. Elle doit être, dans la froide cité moderne, pittoresque et psychologiquement réconfortante. Bien sûr, notre urbaniste ne se fait pas d’illusions, il faut composer avec les nécessités de l’époque, la fluidité de la circulation, la mobilité rapide : pour accomplir son œuvre, l’artiste n’a besoin que de quelques rues principales et de places. Il abandonne volontiers le reste à la circulation et aux besoins matériels de la vie de tous les jours. « Que l’essentiel des habitations soit consacré au travail et que la ville y apparaisse en tenue de travail ! Mais les quelques rues et places importantes doivent porter leurs plus riches atours, pour la joie et la fierté des habitants, pour éveiller un sentiment physique d’appartenance (Heimatgefühl) et inspirer de nobles pensées et de grands sentiments à la jeunesse. Il en allait ainsi dans les villes anciennes. »
Sitte consacra sa vie à promouvoir l’idéal wagnérien dans sa conception de l’urbanisme. Il voulait réorganiser l’environnement construit par l’homme sur une base artistique, c’est-à-dire très fortement communautaire. L’urbaniste, comme le compositeur pour Wagner, doit régénérer la culture. Dans l’optique de Sitte, la ville ne doit pas être le simple produit mécanique de la bureaucratie mais une œuvre d’art qui ait une âme, un pur produit de l’art populaire. Hélas, beaucoup de mal est déjà fait et l’urbaniste ne peut guère concevoir une ville dans son entier. Mais il faut au moins créer une place ; ce que l’opéra est à Wagner, la place l’est à Sitte, une œuvre d’art pour le futur. Elle doit intégrer les différents arts dans un Gesamtkunstwerk visuel. Elle doit être, dans la froide cité moderne, pittoresque et psychologiquement réconfortante. Bien sûr, notre urbaniste ne se fait pas d’illusions, il faut composer avec les nécessités de l’époque, la fluidité de la circulation, la mobilité rapide : pour accomplir son œuvre, l’artiste n’a besoin que de quelques rues principales et de places. Il abandonne volontiers le reste à la circulation et aux besoins matériels de la vie de tous les jours. « Que l’essentiel des habitations soit consacré au travail et que la ville y apparaisse en tenue de travail ! Mais les quelques rues et places importantes doivent porter leurs plus riches atours, pour la joie et la fierté des habitants, pour éveiller un sentiment physique d’appartenance (Heimatgefühl) et inspirer de nobles pensées et de grands sentiments à la jeunesse. Il en allait ainsi dans les villes anciennes. »
Malheureusement pour lui, les propositions de Sitte pour humaniser la Ringstrasse arrivèrent trop tard. Il ne put créer les places de ses rêves ni réaliser un autre projet qui lui tenait à cœur. En bon enfant du XIXè siècle, il considérait le musée comme un élément majeur de transmission de la culture, un outil pédagogique et aussi la réalisation d’un rêve créateur. Son musée, Sitte le voyait comme une grande tour, baptisée la Tour du Hollandais (est-ce une allusion au héros du Vaisseau Fantôme ?) et il la construirait loin de la ville sur une plage déserte.
 Tout cela est resté une utopie. Bientôt surgit une nouvelle génération d’urbanistes qui imposa une autre doctrine, celle de Otto Wagner, de Adolf Loos et des architectes réunis autour du mouvement de la Sécession, dont la doctrine était « Artis sola domina necessitas », le contraire de l’idéal de Camillo Sitte… Il est intéressant tout de même de savoir que l’ouvrage de Sitte connut le succès, fut réédité 5 fois entre 1889 et 1922. Il resta peu connu en France. Sans Marcel Poëte, théoricien de l’urbanisme, Sitte serait ignoré. Après la guerre, le point de vue de l’urbaniste donna lieu à des polémiques et des contresens, on le considéra comme passéiste et il s’attira les violentes critiques de Le Corbusier. Cependant, il ne m’a pas paru inutile d’attirer l’attention sur cette influence – peut-être inattendue – de la pensée wagnérienne sur la vie culturelle viennoise.
Tout cela est resté une utopie. Bientôt surgit une nouvelle génération d’urbanistes qui imposa une autre doctrine, celle de Otto Wagner, de Adolf Loos et des architectes réunis autour du mouvement de la Sécession, dont la doctrine était « Artis sola domina necessitas », le contraire de l’idéal de Camillo Sitte… Il est intéressant tout de même de savoir que l’ouvrage de Sitte connut le succès, fut réédité 5 fois entre 1889 et 1922. Il resta peu connu en France. Sans Marcel Poëte, théoricien de l’urbanisme, Sitte serait ignoré. Après la guerre, le point de vue de l’urbaniste donna lieu à des polémiques et des contresens, on le considéra comme passéiste et il s’attira les violentes critiques de Le Corbusier. Cependant, il ne m’a pas paru inutile d’attirer l’attention sur cette influence – peut-être inattendue – de la pensée wagnérienne sur la vie culturelle viennoise.
L’autre manifestation de cette influence est tout aussi inhabituelle car elle échappe également à la sphère de la musique.
Au préalable, quelques précisions d’ordre politique sont nécessaires. La dernière décennie du XIXe siècle voit le déclin de l’époque libérale qui avait pris son essor vers 1860. On pourrait appeler ce laps de temps les trente glorieuses de la moyenne et grande bourgeoisie viennoise, soucieuse de remédier, par des réformes, au régime quasi féodal de l’aristocratie autrichienne. Beaucoup de progrès d’ordre politique et social furent réalisés, accompagnant une envolée économique remarquable de l’industrie et du commerce. Mais ces préoccupations matérielles n’empêchaient pas la société libérale de tenir la culture en très haute estime. Et dans cette société bourgeoise, un élément moteur était représenté par les juifs, essentiellement cette catégorie de juifs assimilés dont le judaïsme n’était plus qu’un « pieux souvenir de famille », formule excellente de l’un d’eux, l’helléniste Theodor Gomperz.
Mais rien n’est stable dans la vie politique et l’énorme krach boursier de 1873, qui ruina de nombreuses familles bourgeoises, arrache l’empire austro-hongrois à l’euphorie du bien-être. Bientôt apparurent de nouveaux concepts politiques. Dès 1882, Georg von Schönerer (1842-1921) réunit dans son parti les nationalistes allemands extrémistes au nom d’une idéologie pangermaniste et raciste, l’une des forces dissolvantes de la vie politique, minée par le problème des nationalités. Autre meneur, autre tactique, celle de Karl Lueger (1844-1910) qui sut transformer l’idéal de la vieille droite – le catholicisme politique autrichien- en une idéologie de gauche, le christianisme social. Il sut conquérir la petite bourgeoisie viennoise et créa un grand parti (Christlich Soziale) qui s’implanta solidement à la campagne. Petit à petit, il développa un antisémitisme feutré quand il s’agit de récupérer les troupes de Schönerer pour gagner des voix aux élections municipales. Il réussit ainsi à être élu maire de Vienne en 1895, élection qui ne fut entérinée par l’empereur que deux ans plus tard, car François Joseph ne pouvait sentir ce démagogue, le beau Charles comme l’appelait affectueusement le peuple de Vienne. Il fut d’ailleurs pour la ville un très bon maire. Cependant, l’antisémitisme devint prépondérant dans ses convictions politiques, non pas un antisémitisme doctrinal, mais bien plutôt opportuniste, en fonction de ses besoins. Ne lui prête-t-on pas la formule : « Qui est juif ou pas, c’est moi qui le décide ». Le troisième mouvement d’idées qui, au tournant du siècle, acheva de ruiner le libéralisme autrichien est le sionisme, œuvre de Theodor Herzl (1860-1904). Mais cela n’intéresse pas notre propos. Notons pour finir que ces trois ténors de la vie politique autrichienne étaient issus du libéralisme par leurs attaches familiales.
Cependant, dans les années 90, en utilisant tantôt les urnes, tantôt les manifestations de masse et l’émeute, les mouvements anti-libéraux paralysèrent l’Etat et expulsèrent les libéraux des charges acquises trente ans plus tôt.
Une de ces manifestations fut liée à la mort de Wagner en 1883. Depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout depuis 1815, les étudiants d’une université déterminée se réunissaient à l’intérieur d’une Burschenschaft (corporation). A partir de 1850, ces Burschenschaften constituent une entité dans les associations étudiantes (Verbindungen). Certaines se distinguent par des attributs de couleurs différentes : ruban porté en bandoulière, casquette à visière, d’où le nom répandu de Couleur Student. Toutes sortes de rites leur sont propres, associés à tout un vocabulaire : Wichs, Kornment, Kommers, Kommersbuch, etc.
Dans certaines de ces corporations, on se bat au fleuret et lorsqu’un duel se passe avec des armes non mouchetées, a lieu alors une Mensur, qui honore le valeureux d’un beau Schmiss sur la joue ou le front. Ces groupes d’étudiants portent volontiers des noms à consonance latine, évoquant une région allemande, Prussia, Teutonia, Silesia, etc.
A Vienne existait la Burschenschaft Albia, à laquelle adhère en 1880 un jeune homme plein d’avenir, Theodor Herzl, à l’époque très attiré par le nationalisme allemand. Mais la tonalité antisémite de la corporation le dégoûta rapidement. Le sommet fut atteint lorsqu’en 1883, Albia se joignit aux autres associations d’étudiants pour organiser, en l’honneur de la mort du compositeur allemand un Kommers de deuil solennel (Trauerkommers). Kommers, du latin « commercium », signifie réunion, très souvent sous la forme de beuverie à base de bière. Un personnage de la scène littéraire autrichienne y prit une part active, Hermann Baht, écrivain d’un certain mérite, surtout lanceur d’idées et de modes dans le domaine de la culture.
 L’Allgemeine Zeitung du 6 mars 1883 rapporte : « Le Kommers de deuil organisé par les étudiants allemands dans la salle Sophie s’est développé en une imposante manifestation deutsch-national (suit la liste des personnalités, le député Schönerer en tête). »L’étudiant Kaan et le professeur Blume soulignèrent la signification de Wagner pour l’art chrétien allemand. D’autres orateurs, dont l’étudiant Bahr, tiennent des propos éminemment pangermanistes. Ce dernier discours provoque l’intervention de la police à laquelle met fin avec énergie le député Schönerer. Conformément au programme, le Kommers (. . .) se termine par un Salamander de deuil (action qui consiste à frapper en cadence sur la table avec sa chope de bière). Les participants s’éloignent lentement aux sons de la Wacht am Rhein. L’événement eut un énorme retentissement dans l’opinion, et la presse le commenta en long et en large.
L’Allgemeine Zeitung du 6 mars 1883 rapporte : « Le Kommers de deuil organisé par les étudiants allemands dans la salle Sophie s’est développé en une imposante manifestation deutsch-national (suit la liste des personnalités, le député Schönerer en tête). »L’étudiant Kaan et le professeur Blume soulignèrent la signification de Wagner pour l’art chrétien allemand. D’autres orateurs, dont l’étudiant Bahr, tiennent des propos éminemment pangermanistes. Ce dernier discours provoque l’intervention de la police à laquelle met fin avec énergie le député Schönerer. Conformément au programme, le Kommers (. . .) se termine par un Salamander de deuil (action qui consiste à frapper en cadence sur la table avec sa chope de bière). Les participants s’éloignent lentement aux sons de la Wacht am Rhein. L’événement eut un énorme retentissement dans l’opinion, et la presse le commenta en long et en large.
Le journal Die Presse se demande d’abord si les étudiants n’ont pas perdu la tête à se laisser mener par un agitateur tel que Schönerer et poursuit : « Est-ce que ce sont vraiment des étudiants allemands qui renient le beau pays où ils sont nés, pour lequel leurs pères ont répandu leur sang ; est-ce que ce sont vraiment des étudiants allemands qui ébranlent le premier dogme du libéralisme, l’égalité de droits confessionnels de tous les citoyens ; encore une fois, est-ce que ce sont des étudiants allemands qui tournent en dérision les conquêtes de l’esprit humain, la recherche de la lumière et de la vérité, et s’enthousiasment pour la marque jaune du moyen âge ? », etc… L’organe libéral par excellence, Die Neue Frei Presse relate aussi l’événement et s’étend sur le scandale provoqué par Schönerer, refusant d’obtempérer aux ordres de se taire du représentant de la loi. Au milieu des hourras pour Schönerer et des hurlements, le fonctionnaire de police menace de dissoudre l’assemblée, il permet cependant de pratiquer le fameux Salamander.
Hermann Baht raconte l’aventure à son père, dans une lettre, à sa manière bien sûr. Il parle de dérision, de calomnies, de dénonciations, annonce que les Burschenschaften vont être dissoutes et que lui-même ainsi que deux autres participants vont être soumis par le Sénat de l’Université à un processus disciplinaire. Il poursuit : « Ce qu’il y a de méritoire dans mon discours (. . .), c’est que j’y ai caractérisé Wagner comme homme politique et surtout comme homme politique pangermaniste. Le passage le plus lourd de portée est celui où je nomme l’Autriche « une Kundry ployée sous l’expiation et attendant ardemment le sauveur. » Puis, là où je rappelle que R. Wagner ne prétexta pas un mesquin attachement à la cour de Saxe mais participa ouvertement à la Révolution, pour « la cause la plus sainte, la république pangermaniste. » Ensuite l’invitation que je formulai à prêter le serment de ne pas reposer tant que l’héritage sacré de R. Wagner, la pensée pangermaniste, ne serait pas accomplie. » Theodor Herzl envoya dès le 7 mars 1883 sa lettre de démission à la corporation Albia qui s’était associée au « Kommers », en insistant sur l’antisémitisme de la démonstration. De ces documents, il ressort que la musique wagnérienne était totalement absente de la manifestation, qui ne fut rien d ‘autre qu’une entreprise de récupération politique.
 Pour une appréhension plus musicale des relations entre Wagner et Vienne a la fin du XIXè siècle, je propose comme témoin Arthur Schnitzler (1862-1931). Cet écrivain, romancier, auteur de nouvelles, dramaturge, jouit en France d’une certaine notoriété, hélas parfois liée à l’une de ses œuvres, d’ailleurs remarquable, La Ronde. Mise à part la très belle transposition de Max Ophüls, cette pièce de théâtre en dix sketchs fut bien malmenée par ses prétendus admirateurs ; soit portée à l’écran, soit jouée sur scène dans une optique souvent pervertie et unilatérale, elle valut à son auteur la réputation d’un spécialiste de l’érotisme fin de siècle, voire d’un pornographe. Le livre paru en 1903 au Wiener Verlag fut interdit de vente peu après en Allemagne et la création au théâtre à Berlin et à Vienne en 1920 donna lieu à des scandales bien orchestrés.
Pour une appréhension plus musicale des relations entre Wagner et Vienne a la fin du XIXè siècle, je propose comme témoin Arthur Schnitzler (1862-1931). Cet écrivain, romancier, auteur de nouvelles, dramaturge, jouit en France d’une certaine notoriété, hélas parfois liée à l’une de ses œuvres, d’ailleurs remarquable, La Ronde. Mise à part la très belle transposition de Max Ophüls, cette pièce de théâtre en dix sketchs fut bien malmenée par ses prétendus admirateurs ; soit portée à l’écran, soit jouée sur scène dans une optique souvent pervertie et unilatérale, elle valut à son auteur la réputation d’un spécialiste de l’érotisme fin de siècle, voire d’un pornographe. Le livre paru en 1903 au Wiener Verlag fut interdit de vente peu après en Allemagne et la création au théâtre à Berlin et à Vienne en 1920 donna lieu à des scandales bien orchestrés.
Mais Schnitzler n’est pas que l’auteur de La Ronde ; il connut, avant et après la première guerre mondiale, une très grande popularité dans les pays de langue allemande ; les premières de ses drames étaient des événements aussi bien sur les scènes berlinoises que viennoises et la sortie de ses romans et recueils de nouvelles édités par la célèbre maison d’édition S. Fischer à Berlin lui valurent louanges et revenus appréciables.
Mais dans les années 30 du XXe siècle le couperet tomba, puisque Schnitzler était juif, un de ces juifs totalement assimilés, la quintessence du Viennois issu de la grande bourgeoisie, fils d’un professeur de médecine à la réputation européenne, lui-même médecin à l’origine. Hormis quelques thèmes empruntés à l’Histoire, il concentra son attention d’écrivain sur la société qui l’entourait avec une telle acuité psychologique que Freud lui assure dans une lettre, le considérer comme son double ! Trop proches l’un de l’autre dans leur vision pessimiste de l’humanité, les deux hommes ne se fréquentèrent pas intimement, s’évitèrent, pourrait-on dire. La gloire vint relativement vite pour Schnitzler, mais telle une arme à double tranchant ; en effet, au début de sa carrière, il créa deux personnages qui marquèrent une fois pour toutes, là encore de façon restrictive, toute sa production littéraire : Anatol, le séducteur élégant, cultivé, irrésistible mais incapable de fidélité et de véritable souffrance et das süsse Magd, la jeune fille de milieu modeste, parfois légère, heureuse de vivre, sincère en amour même si c’est d’une sincérité à répétition, parfois jusqu’à en mourir. Ces deux silhouettes qui réapparaissent en nombre d’oeuvres en toutes sortes de modulations, ont collé à l’écrivain comme une étiquette, occultant le développement de sa pensée sur les plans sociologique, politique et éthique, toujours exprimée par des personnages convaincants où la vraisemblance accompagne la plus subtile complexité psychologique, dans une prose à la fois journalière et raflinée, aux confins parfois de la poésie, une prose tour à tour spirituelle et apte à restituer les états d’âme les plus contradictoires.
De son vivant, A. Schnitzler fut couvert d’honneurs et de prix littéraires, plusieurs de ses œuvres furent portées à l’écran, il inventa ou rendit populaires des techniques d’écriture – le monologue intérieur, la pièce faite de sketchs, les cycles d’œuvres en un acte – mais il fut en butte à la censure officielle et å une critique mesquine et enragée.
Un exemple : lorsqu’en 1901, il publia la nouvelle Lieutenant Gustl, le haut commandement de l’armée de réserve lui retira sa charge d’officier. Enfin, dès l’âge de trente ans, il commença à souflrir de surdité et d’acouphènes. Or cet écrivain adorait la musique et la pratiquait avec talent. Pour s’en convaincre, il n’est que de feuilleter le récit de sa vie, depuis sa naissance jusqu’à la vingt-septième année de son âge environ, travail entrepris avec un certain recul, en 1915, et qu’il n’a pas poussé plus loin : Jugend in Wien. Après une brève généalogie, il évoque son enfance, ses amours enfantines et, avec une surprenante honnêteté, sa jeunesse d’apprenti médecin et de collectionneur amoureux.
En effet, entre Anatol et Schnitzler se déroule un jeu de miroir et l’on ne saurait dire lequel est le plus vrai, de l’image ou du reflet.
Il rappelle que son grand-père fut un excellent pianiste, comme sa mère avec laquelle il pratiquait souvent à quatre mains, la mention revient à tout moment dans son journal. Avec un ami du lycée, Richard Horn qui compose à la manière de Schumann, tous deux fréquentent les concerts de l’Orchestre Philharmonique, du quatuor Hellmesberger, il jouit à la maison des leçons de piano d’un bon professeur. Ce que Schnitzler préfère, c’est l’improvisation, ce qu’il appelle phantasieren, où son goût pour la création musicale s’exprime sans la contrainte d’une étude et d’une méthode. Car il est paresseux et comprend vite que, dans le domaine musical, il ne dépassera jamais le seuil du dilettantisme. Quand il passe en revue ses professeurs de lycée, il s’attarde auprès du professeur d’histoire Ludwig Blume, à la réputation de Lebernann (viveur) qui s’endort volontiers sur sa chaire.
N’empêche que, politiquement, c’est un nationaliste convaincu : « Son enthousiasme pour Richard Wagner qu’il tenait non seulement pour le plus grand musicien allemand, mais aussi pour le plus grand poète allemand, nous l’attribuions, sans doute à juste titre, à ses convictions politiques plutôt qu’esthétiques, et son aversion pour le judaïsme était aussi plus enracinée dans sa mentalité que dans sa sensibilité. » Schnitzler continue, étudiant en médecine, å pratiquer le piano, et exécute par exemple le « mit meiner Mama », l’Ouverture pour Faust de Wagner. Arrive le moment de faire ses stages hospitaliers ; il commence, en médecine interne, chez le professeur Standhanner qui jouissait dans la société viennoise, en sa qualité d’ami de la musique et d’enthousiaste wagnérien d’un renom presque aussi grand que son renom de médecin. »
Nous sommes au milieu des années 80 : Wagner fait partie de la vie musicale viennoise. Et Schnitzler s’emploie à faire partager son intérêt pour ce compositeur à une de ses amies de cœur :
Lettre à Olga Waissnix du 13 octobre 1886 :
« Hier j’ai entendu les Maîtres-Chanteurs à l’opéra et je baignais dans une mer de son harmonieux. On peut dire ce qu’on veut au plan de la théorie, sur la musique de Wagner, on ne peut qu’être entraîné et complètement absorbé par la passion et la douceur de ces harmonies. . .»
Sa correspondante lui répond le 18 octobre qu’elle se remet avec zèle au piano, travaillant tout particulièrement les transcriptions d’opéras de Wagner.
A une autre amie, avec laquelle les relations sont moins éthérées, Marie Glümer, il écrit le 27 octobre 1890 :
« Mon trésor, je suis allé écouter ce soir les Maîtres-Chanteurs dans l’espoir que la musique me délivrerait de ma terrible excitation. Pendant le 1er acte, je me sentis vraiment mieux. Mais à la fin du deuxième, je me rendis compte que je n’avais fait que fixer la scène, sans voir ni entendre. ]e n’avais qu’une image devant les yeux : toi, en chemise de nuit, sur scène dans le rôle d’Alma. » (Dans une pièce de Hermann Sudermann, Die Eire).
Il revoit les Maîtres Chanteurs en mai 1894 et sa flamme d’alors, la célèbre actrice Adèle Sandrock, lui reproche de ne pas s’être assez souvent retourné vers elle pendant la représentation. A son ami Hofmannsthal, il raconte le 1er septembre 1895 qu’il a vu ce jour même les Maîtres Chanteurs et auparavant Tristan, ajoutant ce commentaire qui donne une idée des fluctuations du jugement dans l’appréhension des œuvres artistiques :
« Je trouve qu’on lui (à l’opéra Tristan und Isolde) fait un grand tort en s’imaginant pouvoir ou même devoir donner l’œuvre sans coupures. »
Avec un autre ami, Beer-Hofmann, le 12 juin 1897, il met au point un voyage commun à Bayreuth : « Il faut vous décider vite. On donnera Parsifal les 27, 28 et 30 juillet, dates qui me conviennent. La place, 12 florins.»
Puis il précise qu’il y sera le 30 juillet. Quelques jours plus tard (22 juin 1897), un détail de la lettre qu’il envoie à Marie Reinhard, sa maîtresse en titre, prouve qu’il se prépare à sa visite à Bayreuth, en lisant et lui proposant une biographie de Wagner. (Il peut s’agir de celle de Houston Stewart Chamberlain parue en 1896 ou du début de celle de Carl Friedrich Glasenapp, en 6 volumes, dont la parution débuta en 1894).
Encore un extrait de lettre, cette fois à Hermann Bahr, le 5 décembre 1904 : « Puisque nous parlons des fêtes pieuses, je te signale que j’ai reçu en cadeau pour la St Nicolas un extrait de Tristan mais que je le joue encore comme un Père Fouettard (Krampus). »
La musique de Wagner a accompagné ce mélomane qu’était Schnitzler comme quelque chose d’évident, ainsi que beaucoup d’autres mélomanes de son milieu et de son éducation.
Une dernière preuve moins prosaïque, plus élaborée, nous vient du roman Der Weg ins Freie (Vienne au crépuscule) publié en 1908, roman de portée sociologique et politique car quelques facettes du judaïsme et toutes celles de l’antisémitisme y sont représentées, ainsi que la lente décomposition de la société libérale, roman de réflexion sur la création artistique oscillant entre dilettantisme et exigence suprême, roman d’amour et d’égocentrisme.
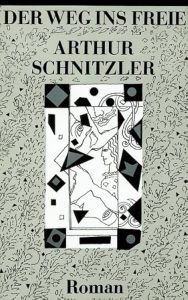 Le héros, Georg von Wergenthin a 27 ans ; il est mince, blond, cultivé, aristocrate, aryen, il jouit d’une fortune suffisante pour vivre à sa guise, très sociable, un « Lebemann » sans cynisme, soumis à ses sentiments et à ses pulsions. Mais en plus, il est musicien, se prépare – mollement- au métier de chef d’orchestre et compose sans méthode de travail rigoureuse, au gré de son inspiration. Il a une liaison durable – un an ! – avec Anna Rosner, elle-même musicienne, possédant une voix de qualité mais pas assez robuste pour une carrière de cantatrice. Elle donne des leçons de musique. Ils vont aller voir Carmen à l’opéra, il emportera la partition comme il vient de le faire pour Lohengrin, et s’entraînera à diriger. « Bien sûr, dans le fond de la loge, tu ne peux pas t’imaginer tout ce qu’on apprend ainsi. » Le jeune aristocrate se rapproche un peu de la famille petite-bourgeoise de sa maîtresse. « Il y eut un soir où Georges resta à dîner dans le cercle familial, puis, le cigare aux lèvres, il improvisa au piano à partir des thèmes des Maîtres-Chanteurs et de Lohengrin, ce qui lui valut de vifs applaudissements. Avec effroi, il se rendit compte, en rentrant chez lui, qu’il s’était senti à son aise comme dans un nouveau foyer. » Anna est bientôt enceinte, le couple quitte Vienne, et, avant de se réfugier en Italie, les jeunes gens séjournent un peu à Munich ; ils visitent les musées, flânent au Jardin anglais, ont leurs places à l’Opéra où ils entendent Figaro, les Maîtres Chanteurs, Tristan et « ils avaient l’impression que les sons bien-aimés tissaient autour d’eux un voile sonore et translucide qui les séparait du reste du monde. » Les mois passent, vient l’accouchement, qui tourne à la tragédie. Georges attend dans l’angoisse : « Il sortit sur le balcon. Sur la table, la partition de Tristan était ouverte. Georges y jeta un ooup d’œil. C’était le prélude du troisième acte. Les sons retentissaient en lui. Les vagues se brisaient sourdement sur les rochers, et, dans un triste lointain, s’élevait la douloureuse mélodie du cor anglais. Par delà les feuilles imprimées, il contempla l”éclat d’argent du jour. Partout le soleil, sur les toits, les jardins, les collines et les forêts. Le ciel s’étalait bleu foncé et la senteur des moissons montait des profondeurs. » Au soir du troisième jour, naît un enfant étranglé par le cordon ombilical. Quand il vient rendre visite à la jeune femme, le lendemain, celle-ci s’enquiert s’il a un peu travaillé à ses compositions. Comment aurait-il pu, en ces circonstances !
Le héros, Georg von Wergenthin a 27 ans ; il est mince, blond, cultivé, aristocrate, aryen, il jouit d’une fortune suffisante pour vivre à sa guise, très sociable, un « Lebemann » sans cynisme, soumis à ses sentiments et à ses pulsions. Mais en plus, il est musicien, se prépare – mollement- au métier de chef d’orchestre et compose sans méthode de travail rigoureuse, au gré de son inspiration. Il a une liaison durable – un an ! – avec Anna Rosner, elle-même musicienne, possédant une voix de qualité mais pas assez robuste pour une carrière de cantatrice. Elle donne des leçons de musique. Ils vont aller voir Carmen à l’opéra, il emportera la partition comme il vient de le faire pour Lohengrin, et s’entraînera à diriger. « Bien sûr, dans le fond de la loge, tu ne peux pas t’imaginer tout ce qu’on apprend ainsi. » Le jeune aristocrate se rapproche un peu de la famille petite-bourgeoise de sa maîtresse. « Il y eut un soir où Georges resta à dîner dans le cercle familial, puis, le cigare aux lèvres, il improvisa au piano à partir des thèmes des Maîtres-Chanteurs et de Lohengrin, ce qui lui valut de vifs applaudissements. Avec effroi, il se rendit compte, en rentrant chez lui, qu’il s’était senti à son aise comme dans un nouveau foyer. » Anna est bientôt enceinte, le couple quitte Vienne, et, avant de se réfugier en Italie, les jeunes gens séjournent un peu à Munich ; ils visitent les musées, flânent au Jardin anglais, ont leurs places à l’Opéra où ils entendent Figaro, les Maîtres Chanteurs, Tristan et « ils avaient l’impression que les sons bien-aimés tissaient autour d’eux un voile sonore et translucide qui les séparait du reste du monde. » Les mois passent, vient l’accouchement, qui tourne à la tragédie. Georges attend dans l’angoisse : « Il sortit sur le balcon. Sur la table, la partition de Tristan était ouverte. Georges y jeta un ooup d’œil. C’était le prélude du troisième acte. Les sons retentissaient en lui. Les vagues se brisaient sourdement sur les rochers, et, dans un triste lointain, s’élevait la douloureuse mélodie du cor anglais. Par delà les feuilles imprimées, il contempla l”éclat d’argent du jour. Partout le soleil, sur les toits, les jardins, les collines et les forêts. Le ciel s’étalait bleu foncé et la senteur des moissons montait des profondeurs. » Au soir du troisième jour, naît un enfant étranglé par le cordon ombilical. Quand il vient rendre visite à la jeune femme, le lendemain, celle-ci s’enquiert s’il a un peu travaillé à ses compositions. Comment aurait-il pu, en ces circonstances !
Mais, poursuit-il, « en ce qui concerne le travail, je me suis à nouveau un peu plongé dans Tristan ce matin. Je connais l’oeuvre vraiment dans le plus petit détail. Et je me sentirais capable de la diriger, s’il le fallait. » Quelques semaines s’écoulent que le jeune homme a passées dans la petite principauté de Detmold, en Allemagne du Nord, où on lui a offert un poste d’assistant de chef d’orchestre (Korepetitor).
L’intendant de l’opéra lui octroie quelques jours de congé à Vienne, lui demandant d’aller assister à la nouvelle mise en scène de Tristan et de lui en référer. Georges compte emmener à la représentation celle qu’il nomme encore sa bien-aimée. Mais Anna refuse obstinément. Il devine les reproches muets de la jeune femme, sa douloureuse déception, car jamais il ne lui a proposé d’unir leurs deux vies. Il se rend donc seul à l’opéra, de mauvaise humeur : « Mais bientôt une jouissance heureuse parcourut tout son corps. Et lorsque Brangäne posa le manteau royal sur les épaules de sa maîtresse, lorsque Kurwenal annonça l’arrivée du roi et que les matelots sur le pont lancèrent des cris de joie en direction de la terre dans l’éclat du jour naissant, Georges oublia (tout ce qu’il venait de vivre dans la journée). Et quand le rideau tomba pour la première fois, il ne se sentit nullement ramené à un univers prosaïque, au contraire, il lui semblait qu’il plongeait sa tête d’un rêve dans un autre, et que le monde réel tissé de doutes et de mesquineries s’éloignait sans force loin de lui. » À la fin du roman, dans une scène bouleversante, il fait comprendre à Anna, en lui jouant une de ses propres œuvres, que leur histoire est terminée. Il a choisi de retourner sans elle à Detmold, il a pris le chemin de la liberté.
Certes, ces allusions aux œuvres de Wagner sont anecdotiques dans un roman de 450 pages. Elles témoignent seulement de la présence de ce compositeur dans la vie culturelle de Vienne et dans les préférences musicales d’un Viennois cultivé. Et il est évident que la glorieuse et sombre histoire d’amour entre Tristan et Yseult enveloppe et transfigure, peut-être abusivement, les médiocrités et le désenchantement des amours humaines.
Pour finir, deux attestations, encore, moins littéraires.
 La première : n’oublions pas que H. St. Chamberlain s’installe à Vienna en 1899 et que c’est là qu’il acheva son ouvrage, Die Grundlage des 19. Jahrhunderts.
La première : n’oublions pas que H. St. Chamberlain s’installe à Vienna en 1899 et que c’est là qu’il acheva son ouvrage, Die Grundlage des 19. Jahrhunderts.
Pour la deuxième, il faut mentionner Christian von Ehrenfels (1859-1932) professeur de philosophie à Prague pendant trente ans. Il élabora d’abord une psychologie du comportement (Gestaltpsychologie), appelée aussi gestaltisme, puis se tourna vers la théorie des valeurs et l’éthique. Pendant deux ans, il étudia la composition auprès d’Anton Bruckner. Maître et élève partageaient le même enthousiasme pour Richard Wagner. La notion du Gesamtkunstwerk incita Ehrenfels à composer des drames avec chœurs, construits sur le fondement des tragédies antiques. Voici ce qu’il écrit dans un ouvrage où il présente ses oeuvres artistiques : « Ces poèmes dramatiques [. . .] doivent leur existence aux influences de ce puissant génie artistique qui, par un perfectionnement jusqu’alors inimaginable de l’expression musicale, a suscité de nouvelles impulsions à la création poétique et dramatique elle-même et ouvert de nouvelles voies. Wagner est le premier qui a mis le drame en tant que tel en musique, musique dramatique. Une musique qui restitue le contenu émotionnel de caractères et de situations dramatiques, nous en trouvons maintes fois dans l’opéra. Mais cette construction homogène qui exprime l’ensemble du contenu émotionnel du drame et qui visualise, dans son articulation, le sens formel musical, c’est Richard Wagner qui l’a créée en premier. Son utilisation de motifs musicaux pour construire de grandioses phrases sonores, c’est elle qui met le spectateur sensible en état de suivre et de réaliser dans son propre coeur les sensations ramifiées, hostiles entre elles, qui transforment, anéantissent, recréent à nouveau, ces sensations qui parviennent grâce au mouvement dramatique à s’incarner en allégorie. »
Pardonnons à Ehrenfels son style ampoulé, ne retenons que la conviction qui en émane : Wagner est un novateur digne de la plus grande vénération.
Bibliographie :
– Jugend in Wien – Arthur Schnitzler – Molden 1968
– L’Ecole de Vienne – Dominique Jameux – Fayard 2002
– Histoire de Vienne – Jean-Paul Bled – Fayard 1998
– Vienne, fin de siècle – Carl E. Schorske – Seuil 1983
– Richard Wagner ~ Martin Gregor Dellin – Fayard 1981
– Jugend in Wien – Catalogue de l’exposition du Musée National Schiller à Marbach – 1974
– Der Weg ins Freie ~ Arthur Schnitzler – S. Fischer Verlag 1928








