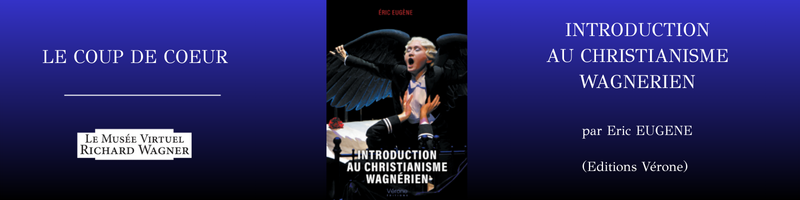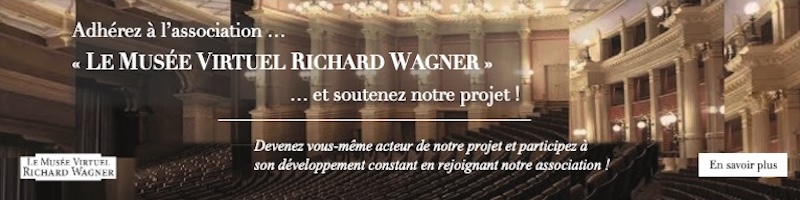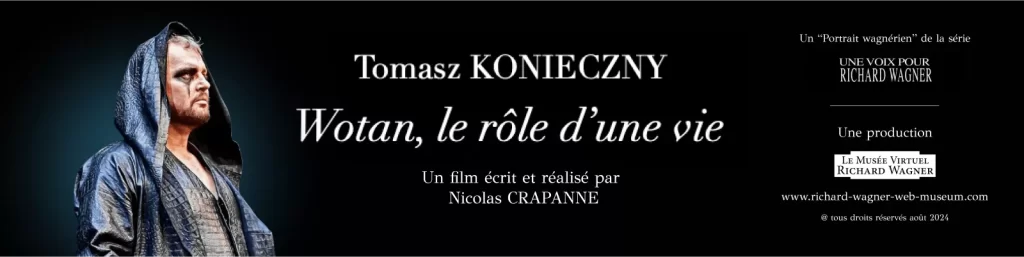Extrait de la revue Wagneriana Castellana n° 14 (nouvelle série), 2018 – Associació Wagneriana, Barcelone
Extrait de la revue Wagneriana Castellana n° 14 (nouvelle série), 2018 – Associació Wagneriana, Barcelone
Traduction en français @Le Musée Virtuel Richard Wagner, 2025.
À titre d’introduction
Au cours du XIXe siècle, nombreux furent les compositeurs à écrire des œuvres inspirées de scènes, d’ouvertures ou de leitmotive tirés des drames wagnériens, en particulier pour le piano. Un tel engouement pourrait sembler paradoxal, si l’on adopte un point de vue strictement wagnérien : il suffit de se rappeler la profonde détresse – financière autant qu’émotionnelle – que connut Wagner lorsqu’il se vit contraint, dans les années les plus sombres de sa carrière, d’endosser le rôle de copiste, de ré-orchestrateur ou d’arrangeur pour des œuvres qui n’étaient pas les siennes. Comment ne pas songer à l’amertume qu’il éprouva, en 1840, lorsqu’il dut accepter, pour alléger quelque peu sa misère, la commande d’une série d’arrangements pour piano de La Favorite de Donizetti ? Cette frange non négligeable du répertoire pianistique trouve toutefois sa légitimité dans une exigence bien réelle : celle, imposée par une bourgeoisie avide de culture, de se familiariser avec les nouveautés musicales, qu’elles soient symphoniques ou théâtrales. Il en résulta l’émergence – ou le renforcement – de plusieurs dynamiques culturelles étroitement liées. D’un côté, les soirées musicales se multiplièrent dans les salons de la haute société ; de l’autre, la fréquence et le succès de ces événements favorisèrent l’apparition d’une forme spécifique de littérature musicale, tout en accompagnant l’essor d’un phénomène social nouveau : le virtuosismo.
Dans ce contexte, le XIXe siècle voit culminer la figure multiple et fascinante de l’un des premiers hérauts du wagnérisme militant : Franz Liszt. Le musicien hongrois sut incarner, dans une harmonie singulière, les fonctions de compositeur, d’innovateur et de virtuose. En tant que créateur, il laissa plus de 1200 œuvres, dont une majorité écrite pour le piano. Sur cet instrument, il atteignit un degré de maîtrise tel que Clara Wieck – éminente pianiste et épouse de Robert Schumann – le considérait comme un artiste « sans équivalent ». C’est en effet au piano que Liszt développa l’équivalent exact de ce que Paganini avait accompli pour le violon : il transforma en profondeur la technique instrumentale, révélant un univers sonore et coloristique jusqu’alors inexploré. Comme novateur, il mit notamment en œuvre la technique de la variation chromatique, qui devait exercer une influence décisive sur Wagner lui-même, ainsi que sur Strauss.
Par ailleurs, Liszt incarna cette forme de générosité rare que seuls les véritables génies savent exercer. Sous son égide bienveillante vinrent se rassembler de jeunes talents auxquels il apporta un soutien constant : en les interprétant avec ferveur lors de multiples concerts et soirées, mais aussi en s’engageant avec détermination à faire connaître leurs œuvres. Il mit ses dons exceptionnels au service d’une cause qu’il fit sienne : transcrire pour le piano les compositions d’autrui, portant ainsi à son plus haut accomplissement la devise qui guida toute sa vie : « vivre en travaillant, mourir en combattant ».
Cette mission prit une portée toute particulière lorsqu’il s’agit de faire rayonner les drames wagnériens. Liszt devint l’un des plus ardents propagateurs de la musique de l’avenir. Wagner lui-même, lors du tout premier Festival de Bayreuth, rendit un hommage vibrant à celui qu’il appelait son « frère spirituel », interrompant son allocution inaugurale pour déclarer : « Voici celui qui a cru en moi quand nul ne me connaissait encore, et sans lequel vous n’auriez entendu une seule de mes notes. »
Dans l’œuvre pianistique de Liszt, ses quelque deux cents transcriptions d’œuvres d’autres compositeurs forment un ensemble à part entière. Bach, Weber, Scarlatti, Paganini, Schumann ou encore Beethoven – dont il transcrivit l’intégralité des neuf symphonies – figurent parmi ceux à qui il rendit ainsi hommage. Ces adaptations, qui relèvent d’une prouesse à la fois technique et interprétative, traduisent, selon les mots de Donald Francis Tovey, que « Liszt fut, de très loin, l’interprète le plus prodigieux de partitions au piano que le monde ait jamais connu ».
À cette entreprise colossale s’ajoutent de nombreuses transcriptions de pages célèbres tirées d’opéras de Verdi, Donizetti, Rossini, Mozart, ainsi que des drames de Wagner. On en dénombre quatorze au total, dont une révision de l’Ouverture de Tannhäuser et une seconde version de l’emblématique Mort d’Isolde.
Selon la biographie que Lina Ramann consacra à ce musicien cosmopolite né à Raiding (Franz Liszt als Künstler und Mensch – Franz Liszt, en tant qu’artiste et en tant qu’homme), Liszt forgea trois termes appelés à jouer un rôle décisif dans la désignation d’un corpus bien distinct au sein de son œuvre pianistique. Ces désignations finirent par s’imposer durablement dans le lexique usuel du langage musical.
À l’origine, les notions de transcription, de paraphrase et de réminiscence ne correspondent pas à un modèle unique de construction musicale ; elles autorisent au contraire une grande diversité de traitements, ce qui rendait leur définition initiale complexe. On peut néanmoins considérer que les transcriptions sont celles qui restent les plus fidèles à l’esprit de l’œuvre première : leur finalité consiste à restituer, avec le plus grand degré possible de précision et de fidélité – jusqu’aux moindres détails –, la partition originale. Cette exactitude confère à ces pièces un caractère strict, littéral et objectif. Un critique musical alla jusqu’à dire que les transcriptions de Liszt étaient, en quelque sorte, « les disques de gramophone du XIXe siècle ». Dans cette perspective, ces œuvres relèvent d’une claire volonté de diffusion des compositions originales, la virtuosité de l’interprète y étant mise au service d’une intention de reproduction fidèle, sans nécessiter l’appareil orchestral ou lyrique requis par les œuvres sources.
C’est précisément cette fidélité intrinsèque qui rend la tâche ardue : comment transposer une musique conçue pour un autre effectif dans le langage propre au piano sans en trahir la substance ? Liszt parvint à résoudre ce défi grâce à la richesse de son imagination musicale, créant pour chaque cas des solutions pianistiques singulières, ajustées à la variété des problèmes posés par l’adaptation d’une œuvre conçue pour d’autres instruments aux possibilités expressives et techniques du clavier.
À l’inverse, dans le cas des paraphrases pour piano – deuxième terme élaboré par le compositeur hongrois –, l’interprète bénéficie d’une plus grande liberté vis-à-vis de la partition de départ, autour de laquelle il déploie sa propre invention, animée d’une volonté affirmée de création. La paraphrase consiste généralement à réécrire une aria ou des scènes spécifiques issues de l’ouvrage original. Le musicien y cherche à restituer l’intensité dramatique de l’action lyrique, en y introduisant des éléments caractéristiques du virtuosisme : ornementations foisonnantes, langage harmonique ou rythmique souvent plus audacieux que dans l’œuvre d’origine. Dans cette nouvelle composition, des fragments issus de la littérature pianistique virtuose se mêlent aux citations de la partition initiale, réalisant ainsi une véritable métamorphose. C’est notamment le cas dans les paraphrases que Liszt consacra aux opéras de Mozart, Verdi ou Meyerbeer, où l’ornementation atteint un degré de complexité et de raffinement tout à fait remarquable.
À côté de ces deux formes, Liszt introduisit également la notion de réminiscence, empruntée au français réminiscence(souvenir). Dans ce type de pièces, le compositeur livre une vision personnelle de l’œuvre source – approche particulièrement éloquente dans ses réminiscences d’opéras –, qu’il investit d’un contenu psychologique et d’une charge affective propre. Par juxtaposition de motifs et de thèmes extraits de divers actes d’un même opéra, il élabore une œuvre de concert de forme généralement étendue, sorte de fresque musicale où l’émotion du souvenir transfigure le matériau dramatique originel.
Enfin, Liszt utilisa à quelques rares occasions le terme de fantaisie – on en trouve un exemple dans sa Fantaisie sur des motifs de La Sonnambula de Donizetti, S.393. Le mot fut ensuite repris plus fréquemment par d’autres compositeurs célèbres du répertoire pianistique, tels que l’Autrichien Carl Czerny ou le Suisse Sigismund Thalberg. Selon Charles Suttoni, la distinction entre paraphrase et fantaisie réside dans le fait que cette dernière « est en général moins fragmentée et s’appuie habituellement sur une seule scène ou un épisode spécifique de l’opéra ».
Certes, le lecteur pourrait estimer cette « introduction » un peu longue. Pourtant, il nous a semblé indispensable de retracer, fût-ce brièvement, le contexte musical et social dans lequel s’épanouit ce genre particulier de littérature pianistique, d’en rappeler les caractéristiques essentielles, et de saluer l’apport génial, incontesté, de Franz Liszt à cet univers aussi raffiné que singulier.
Moritz Moszkowski : esquisse biographique
Le 23 août 1854 voit naître, dans la ville prussienne alors appelée Breslau (aujourd’hui Wrocław), le compositeur, chef d’orchestre, pédagogue et pianiste Moritz Maurycy Moszkowski, issu d’une famille aisée de confession juive. C’est dans le cercle familial qu’il reçoit ses premières leçons de musique, amorçant une vocation précoce. En 1865, la famille s’installe à Dresde, où le jeune Moszkowski poursuit ses études au conservatoire. C’est à cette période que remontent ses premières tentatives de composition : à peine âgé de treize ans, il écrit un quintette pour piano.
Deux ans plus tard, en 1869, il rejoint Berlin, où il se perfectionne auprès d’Eduard Franck, pour l’interprétation pianistique, et de Friedrich Kiel, pour la composition, au sein du Conservatoire Stern. Sa formation, profondément ancrée dans la tradition musicale allemande, s’achève à la Neue Akademie der Tonkunst, haut lieu de l’enseignement musical berlinois.
En 1873, il donne à Berlin son premier récital en tant que soliste, qui rencontre un accueil enthousiaste. Ce succès marque le point de départ d’une brillante carrière de concertiste, jalonnée de tournées à travers les grandes villes européennes. Deux ans plus tard, il organise, avec son ami Philipp Scharwenka – rencontré sur les bancs de la Neue Akademie –, un concert au cours duquel il interprète son Concerto pour piano. À ses côtés, au second piano, figure nul autre que Franz Liszt, convié par amitié et admiration, dans une matinée réservée à un public trié sur le volet par le maître hongrois.
En 1875, Moszkowski est nommé professeur au Conservatoire de Berlin, fonction qu’il exercera durant un quart de siècle avec un engagement constant.
C’est à cette époque qu’il entame la publication de ses premières œuvres. Son recueil de Danses espagnoles, op. 12, remporte un succès immédiat et demeure l’une des compositions les plus populaires de son répertoire. En marge de son œuvre pour piano, Moszkowski s’illustre également au violon, pour lequel il compose un Concerto, op. 30. Le 21 avril 1892, il crée à Berlin son unique opéra, Boabdil, der letzte Maurenkönig (Boabdil, le dernier roi maure), op. 49. Conçue dans l’esthétique du grand opéra à la manière de Meyerbeer, la partition est également donnée à Prague, puis, l’année suivante, à New York, dans une version anglaise. Le livret, signé Carl Wittkowsky, n’empêche pas l’œuvre de disparaître rapidement des affiches. Aujourd’hui, seule sa musique de ballet, proche dans l’esprit des Danses espagnoles, connaît encore quelques résurgences en concert.
Durant son long séjour berlinois, Moszkowski poursuit une activité intense de compositeur et de pédagogue. Il dirige régulièrement les concerts de l’Académie et alterne, au fil de ses déplacements en Europe, les fonctions de pianiste et de chef d’orchestre.
À partir du milieu des années 1880, des troubles neurologiques affectant son bras viennent progressivement réduire ses prestations publiques. Il se consacre alors davantage à la composition et à l’enseignement. En 1884, il épouse Henriette Chaminade, sœur cadette de la célèbre pianiste et compositrice Cécile Chaminade. De cette union naîtront deux enfants, Silvia et Marcos.
En 1887, Moszkowski est convié à Londres, où il présente plusieurs de ses œuvres orchestrales. À cette occasion, il est fait membre honoraire de la prestigieuse Royal Philharmonic Society. Deux ans plus tard, en 1889, il est admis à l’Académie de Berlin. Mais l’année suivante, en 1890, sa vie personnelle bascule : son épouse s’enfuit avec le poète Ludwig Fulda, le laissant seul avec leurs enfants.
En 1897, il choisit de s’installer à Paris, où sa renommée, déjà bien établie, lui vaut un accueil favorable. Il y vit avec sa fille Silvia et y développe une activité pédagogique particulièrement soutenue : il est alors l’un des professeurs les plus recherchés. Parmi ses élèves parisiens, on compte des figures de premier plan comme Vlado Perlemutter, Thomas Beecham, Josef Hoffmann, Wanda Landowska, Gaby Casadesus, Joaquín Nin et Joaquín Turina. Il n’hésite pas non plus à soutenir de jeunes musiciens prometteurs, avec une bienveillance constante.
Mais en 1906, le décès de sa fille Silvia, emportée à l’âge de dix-sept ans, le plonge dans un chagrin profond qui affecte gravement sa santé. Cette perte intime coïncide avec un déclin progressif de sa célébrité et de son influence, conséquence d’une évolution des goûts musicaux au seuil du nouveau siècle. Bien qu’il continue de composer, ce travail devient plus sporadique, et son nom, autrefois synonyme de virtuosité et de raffinement, s’efface peu à peu au profit d’une génération montante.
La débâcle des marchés financiers qui suit la Première Guerre mondiale achève de ruiner Moszkowski. Ayant investi sa fortune dans des titres allemands, polonais et russes, il se retrouve dans une précarité extrême. Dans ses dernières années, il survit grâce à la générosité de quelques anciens élèves fidèles, notamment Josef Hoffmann et Bernhard Pollack. Ce dernier procède à une nouvelle adaptation de l’opéra Boabdil, qu’il parvient à vendre à la maison d’édition Peters, à Leipzig, obtenant pour son ancien maître la somme de 10 000 francs.
Le 21 décembre 1924, alors que Moszkowski est très affaibli, ses élèves, amis et admirateurs organisent un concert de bienfaisance en son honneur. Quinze pianos à queue sont alignés sur la scène du Carnegie Hall de New York, confiés à des interprètes de renom tels que Percy Grainger, Josef Lhévinne, Elly Ney, Wilhelm Backhaus et Harold Bauer.
Moritz Moszkowski s’éteint à Paris le 4 mars 1925.
 Les paraphrases wagnériennes de Moszkowski
Les paraphrases wagnériennes de Moszkowski
À l’instar de bien des musiciens de son temps, Moszkowski succomba à l’attrait irrésistible de l’adaptation pour piano des drames wagnériens – instrument dont il maîtrisait, à l’image de Liszt, les ressources avec une virtuosité consommée. Il signa également un grand nombre d’arrangements pour piano d’œuvres appartenant à un large éventail de compositeurs : Beethoven, Brahms, Czerny, Haendel ou encore Mozart, dont il transcrivit notamment la Symphonie Jupiter pour deux pianos. À cela s’ajoutent des transcriptions issues du répertoire lyrique, tirées entre autres des opéras Don Giovanni de Mozart, Rinaldo de Haendel ou Carmen de Bizet.
S’agissant de Wagner, le compositeur originaire de Breslau ne livra que deux œuvres. Ce nombre, certes modeste si l’on s’en tient à la quantité, se trouve pleinement compensé par la qualité artistique de ces pièces, qui justifie à elle seule leur place dans le corpus des paraphrases wagnériennes.
Ces deux partitions furent écrites à la même époque, sans numérotation d’opus dans un premier temps, avant d’être intégrées au catalogue général de l’œuvre du compositeur.
La première de ces deux pièces est une paraphrase inspirée de La Mort d’Isolde (Isoldes Tod), tirée du drame Tristan und Isolde. Composée en 1910, elle porte l’indication expressive « lento e languido ». Publiée par la maison Peters de Leipzig, elle fut dédiée à Ferruccio Busoni, lui-même pianiste et compositeur. Cette œuvre figure dans le catalogue de Moszkowski sous la référence MoszWV252.
La seconde incursion de Moszkowski dans l’univers wagnérien s’attache à ce que l’on désigne comme le deuxième des « opéras romantiques » du Maître. Intitulée Der Venusberg, cette œuvre en mi majeur, de tempo Allegro, constitue une paraphrase du célèbre épisode de la Bacchanale du Venusberg, extrait de Tannhäuser. Composée entre 1910 et 1911, elle fut, comme la précédente, éditée par Peters à Leipzig, et dédiée au pianiste russo-britannique Mark Hambourg. Elle porte dans le catalogue de Moszkowski la mention MoszWV253.
Le fragment de La Mort d’Isolde a suscité plusieurs transcriptions pour piano. Outre celle de Moszkowski, on peut citer celle, pour deux pianos, de Max Reger, et surtout la version la plus célèbre, signée Franz Liszt. Ce dernier en réalisa une première mouture en 1867, qu’il révisa par la suite ; elle est aujourd’hui répertoriée sous le numéro S447 dans le catalogue général de ses œuvres. Ce qui motiva Liszt avant tout fut le désir de faire découvrir au public le drame Tristan und Isolde : il composa dans ce but une transcription fidèle de l’aria finale du troisième acte. (Fait notable : dans l’ensemble de ses adaptations des œuvres de Wagner, Liszt privilégia la transcription pure, à une exception près – celle de sa fantaisie sur des thèmes de Rienzi intitulée Phantasiestück über Motive aus Rienzi, écrite en 1859.)
Moszkowski, quant à lui, ne choisit pas la voie de la transcription, mais celle de la paraphrase. En prenant pour point de départ le même fragment – La Mort d’Isolde –, il donne naissance à une pièce d’un lyrisme raffiné, au souffle fluide, moins dramatique, pourrait-on dire presque aérienne. Ce que sa fantaisie perd en intensité tragique, elle le gagne en grâce mélodique et en virtuosité brillante. Il s’agit là d’une relecture personnelle de la musique de Wagner, dans laquelle la dimension psychologique si poignante de l’Isolde wagnérienne se trouve volontairement atténuée, au profit d’une esthétique plus libre et plus éthérée. Comme l’a souligné le pianiste Robert Vanderschaaf, « la transcription de Moszkowski offre certains détails et couleurs absents de l’arrangement de Liszt ».
La paraphrase sur La Bacchanale du Venusberg tirée de Tannhäuser, quant à elle, révèle pleinement le tempérament virtuose qui traversa toute la carrière musicale de Moszkowski. Comme toute réduction – et plus encore lorsqu’il s’agit de transposer Wagner –, l’œuvre perd inévitablement en profondeur, en intensité expressive, en richesse de timbres et en ampleur architecturale. Mais la fantaisie ainsi née dépasse largement les vingt-six mesures de la partition originale pour s’épanouir dans une œuvre vaste, somptueuse, d’une puissante évocation, ponctuée de passages d’un éclat pianistique éblouissant.
Annexe
Nous indiquons ci-dessous quelques vidéos des œuvres citées, disponibles sur la plateforme YouTube :
• Paraphrase de La Bacchanale du Venusberg, extraite de Tannhäuser
La seconde version de l’œuvre est plus vibrante, élégante, dynamique et énergique. Elle est interprétée par le jeune pianiste et compositeur allemand Joseph Moog. La première version, quant à elle, est légèrement plus lente, moins vibrante et présente des tempi un peu plus modérés.
• Paraphrase de La mort d’Isolde
La première vidéo correspond à l’enregistrement réalisé par le pianiste allemand Severin von Eckardstein dans la salle de concert du Bimhuis à Amsterdam. La seconde présente l’interprétation qu’en donna Joseph Moog au Colony Theatre de Miami Beach, dans le cadre du Festival International de Piano de Miami (Floride).
Bien que d’autres versions de ces œuvres soient disponibles sur la même chaîne YouTube, nous estimons que celles-ci sont suffisamment représentatives pour illustrer la conception des paraphrases de Moszkowski.