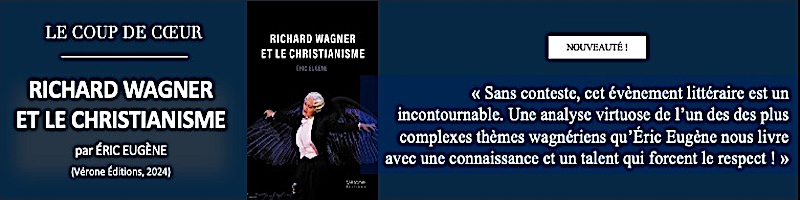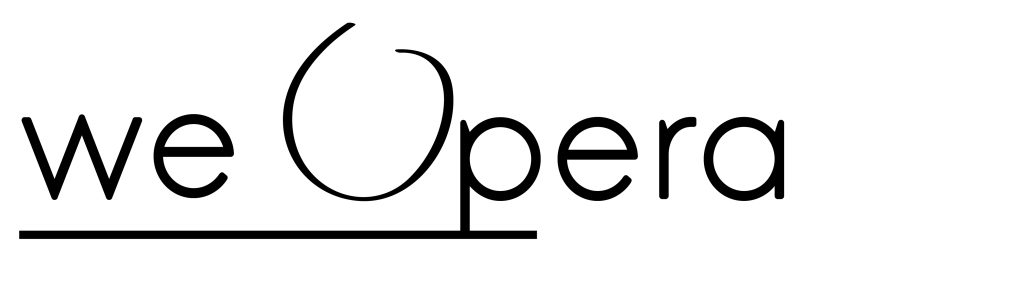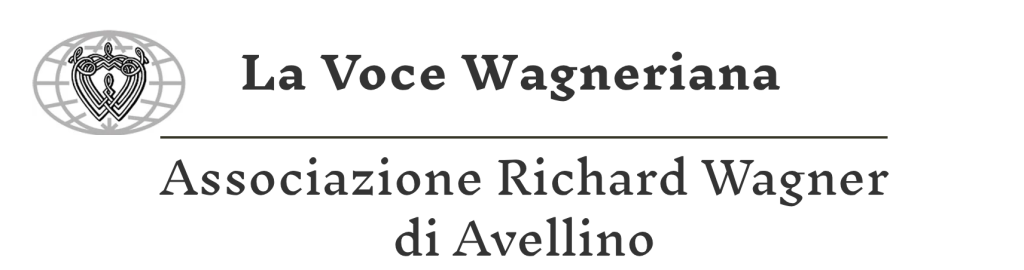Titre original : « WAGNER AND THE MAKART STYLE »
traduction @ Le Musée Virtuel Richard Wagner et reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’auteur
pour lire le texte dans son intégralité sur le site www.academia.edu, cliquer ici.
Le peintre autrichien Hans Makart décéda au début d’octobre 1884, laissant derrière lui une carrière brève mais remarquablement brillante, principalement à Vienne durant les années 1870. Quelques mois après sa disparition, le contenu de son atelier viennois fut mis aux enchères. L’inventaire, qui comptait alors 1.083 lots, incluait quelques tableaux non vendus ou inachevés, bien qu’en nombre limité. Il se composait essentiellement d’un impressionnant ensemble d’antiquités, de costumes, d’objets d’art et d’autres bibelots raffinés ayant orné le célèbre studio de Makart, situé dans une ancienne fonderie de fer sur la Gusshausstrasse, à proximité de la Karlskirche. Parmi les objets mis en vente figuraient divers tableaux anciens et contemporains (y compris quelques maîtres anciens mineurs et un Tiepolo), des dizaines de Gobelins et d’autres tapisseries, ainsi que des meubles tels que des lits, des chaises, des tables marquetées, de vieux coffres italiens et allemands, des cadres, des paravents peints, des ottomans, un piano Bösendorfer en noyer, des miroirs, soixante-trois tapis orientaux, une imposante garde-robe de costumes historiques et exotiques, des sculptures, des médailles en bronze, des armes anciennes et du matériel de chasse, des bijoux, du verre et de la porcelaine, des luths, des mandolines, des gongs chinois, des instruments à cordes africains, des samovars, des sabliers, une peau de léopard, deux paons empaillés, deux aigles (Steinadler), un pélican, un faucon, un bullmastiff, un poisson-sabre, des citrouilles et des gourdes, des coquillages, des bibelots en ivoire, des paniers égyptiens et divers « fragments ». On pouvait également y trouver des photographies et des gravures, dont un ensemble de dessins de Josef Hoffmann pour le festival de Bayreuth de 1876.[1]
Il n’est guère surprenant que Cosima Wagner ait qualifié l’atelier de Makart de « sublime débarras » après sa visite en février 1875, alors qu’elle et Richard se trouvaient à Vienne pour travailler avec des chanteurs en prévision du futur Ring de Bayreuth (voir Fig. 1)[2]
Le style Makart : la haute culture matérielle à la Belle Époque.
Le « style » que Makart avait élaboré à la fin de sa vie – un style qui allait continuer à dominer le tournant du siècle en Europe centrale – se caractérisait par l’opulence visuelle de ses peintures historiques, de ses portraits et de ses scènes théâtrales, ainsi que par ses décors muraux et de plafonds. Son studio, somptueusement aménagé, était un véritable carrefour pour les membres influents de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie. Ses œuvres étaient souvent conçues pour des espaces intérieurs spécifiques, et son influence s’étendait à une multitude de moyens visuels et décoratifs : chapeaux, robes, ornements de table, ainsi que la décoration des salles à manger et des salons. Comme le souligne avec pertinence le catalogue d’une exposition consacrée à son œuvre en 1972, Makart était en quelque sorte l’Andy Warhol de la Vienne des derniers Habsbourg.[3]
L’atelier emblématique de Makart était véritablement une usine culturelle, non seulement abritant les dernières créations de son pinceau prolifique, mais aussi illustrant comment celles-ci pouvaient s’intégrer dans un style de vie global. Cet intérieur de la Belle Époque se présentait comme une performance virtuose d’opulence et de confort, où se mêlaient harmonieusement des éléments privés et publics, antiques et contemporains, natifs et exotiques. Le critique contemporain Robert Stiassny a exprimé une admiration quelque peu nuancée pour l’ « exaltation de l’objet » (Erhebung des Gegenständlichen) de Makart et sa remarquable « sensibilité matérielle » (Stoffgefühl) peu après la mort de l’artiste. Selon lui, l’atelier était l’une des plus grandes œuvres de Makart. « Des centaines, voire des milliers d’objets » accueillent le visiteur ; « chaque époque et chaque culture semblent avoir organisé un rendez-vous cosmopolite et synchronique ». Le style de l’atelier fonctionne également comme un glossaire interprétatif de l’abondance matérielle, figurative et coloristique de ses peintures : « Tout ce chaos s’est regroupé en ensembles merveilleusement harmonisés, créant de superbes harmonies de couleur et de ligne. »[4]
Le journaliste viennois et critique d’art Carl von Vincenti livre un témoignage captivant de l’atelier, daté d’avril 1875, presque contemporain des visites de Richard et Cosima Wagner : « L’atmosphère ici est à la fois étrangement splendide et accueillante, évoquant un aperçu d’un conte de fées à la fois pittoresque et fantastique… De vieux gobelins s’étendent majestueusement sur le lambris brun de cette pièce baignée de lumière ; parmi les poutres du plafond se nichent des Sonnenbrenner, tandis qu’un chandelier somptueusement orné pend de celles-ci. Des fresques se détachent sur des fonds dorés, des peintures scintillent dans des cadres sombres, et des bibelots singuliers, tels que des urnes ventrues à fins goulots, des bronzes décoratifs, des tissus et tapis multicolores venus du Levant, de vieux coffres, des sculptures ornées, des ensembles sculptés, des feuilles tropicales, des peaux de tigre, des armures et des armes, peuplent cet espace. Tout dans ce bazar vivant et matériellement dense [stoffschweren] de splendeur picturale s’harmonise merveilleusement avec le style décoratif large et joyeusement fantastique qui fait de cet endroit l’un des plus beaux studios au monde. »
La description de Vincenti suit le fil de cette abondance visuelle jusqu’à l’espace de travail de l’artiste, un loft décoré de manière similaire surplombant la pièce principale – qu’il qualifie de « boudoir d’artiste » (Kunstboudoir) – et situe finalement le peintre lui-même dans cet habitat représentatif. L’atelier, conclut Vincenti, « est une expression éclatante de son génie décoratif, une part de sa renommée, une part de Makart lui-même. »[5]
Les résonances de l’atelier de Makart se font clairement sentir dans le salon de Richard Wagner à la Villa Wahnfried (voir Fig. 2). Bien que les traces du « style Makart » ne soient pas surprenantes autour de 1880, une tradition critique reliant les noms et les « styles » de Wagner et de Hans Makart a commencé à émerger au cours de la décennie précédente, alors que la renommée des deux artistes atteignait son apogée. Si la carrière de Makart a rapidement décliné après le tournant du siècle, l’idée d’une affinité stylistique avec le compositeur a perduré, comme en témoigne une remarque de l’essai célèbre de Thomas Mann, Les Peines et la Grandeur de Richard Wagner. Mann écrit : « En fin de compte, l’art de Wagner est un produit du même milieu historique et esthétique que ces arrangements de fleurs séchées (accompagnés de plumes de paon) de Makart qui ornaient autrefois les salons rembourrés et dorés de la bourgeoisie. »[6]
Pour Mann, Wagner incarne véritablement la culture bourgeoise de la fin du XIXe siècle, tant par son goût pour l’ostentation et l’auto-indulgence que par son éthique de travail rigoureuse. L’artisanat minutieux d’une œuvre telle que Die Meistersinger est pleinement justifié et même favorisé par la « propreté méticuleuse et l’élégance bourgeoise » qui l’entoure. Cette dialectique se manifeste encore plus vivement dans l’atelier surchargé et toujours animé de Hans Makart à Vienne. La comparaison avec Makart met en lumière l’aspect plus discutable de cette dialectique, à savoir l’ostentation plutôt que l’éthique de travail : « Il ne peut être nié que l’affection de Wagner pour l’élégance de la classe moyenne révèle une tendance à la dégénérescence, une forte inclination à adopter des caractéristiques qui n’ont plus rien à voir avec le XVIe siècle allemand, avec le statut de maître artisan et les coiffes de Dürer, mais qui représentent le XIXe siècle dans sa forme la plus vulgaire. »
En tant qu’artiste, Makart était, tout comme Wagner, un professionnel assidu. Cependant, en tant que « style », il en est venu à incarner – contrairement à Wagner – tout ce que Carl Dahlhaus qualifiait de « mauvais XIXe siècle » (une catégorie probablement dérivée de ce passage dans l’essai de Mann).[7]
Pour Thomas Mann, le « discutable » n’est pas une catégorie strictement négative, mais plutôt dynamique et productive. Dans son essai, il décrit l’œuvre de Wagner comme « splendidement discutable, ambivalente et fascinante »[8] . Mann note que « le goût de Wagner pour l’opulence, le luxe, les velours et les soies, ainsi que le somptueux éclat wilhelminien » est d’abord un trait personnel, mais qui touche profondément son être intellectuel et artistique.[9] Le « discutable » provoque et engage par nature, tout comme la tendance « vulgaire bourgeoise » de Wagner. Mann s’interroge sur la manière dont l’addiction de Wagner aux stimuli sensuels se relie à sa quête de réformer, purifier et spiritualiser l’opéra. Il questionne également son opposition véhémente à l’idée de l’art, et en particulier de l’opéra, comme « luxe ». En s’enthousiasmant pour la mélodie sans fin du style prosaïque de Wagner, Mann pose la question rhétorique : « N’était-ce pas cet élément de délice, le sensuel-pernicieux, le sensuel-consommateur, lourdement enivrant, hypnotiquement caressant, épais et richement rembourré – en un mot, cet élément suprêmement luxueux de sa musique – qui attirait les masses bourgeoises dans ses bras ? » Évoquant un poème de 1818 d’Eichendorff sur les séductions d’une vie dissipée, Fruhlingsfahrt, il demande si l’orchestre de Wagner n’est pas comme « le gouffre coloré et sonore de la mer attirante » (« der buhlenden Wogen farbig klingenden Schlund ») qui tente l’un des deux compagnons dans le poème d’Eichendorff.[10] Makart, quant à lui, était à la fois célébré et critiqué pour son utilisation séduisante de la « couleur », souvent au détriment de la ligne et de la forme, une critique fréquemment rencontrée dans la réception précoce de Wagner, mais aussi chez des compositeurs allant de Berlioz et Liszt à Mahler et aux impressionnistes français.
Les affirmations selon lesquelles certaines musiques « sonnent » comme certaines peintures « apparaissent » demeurent toujours sujettes à débat. Cependant, si Wagner « sonnait » pour ses contemporains d’une manière similaire aux tableaux de Makart, la quasi-disparition de ce dernier du canon historique de l’art moderne pourrait-elle indiquer quelque chose qui a été perdu ou réprimé dans notre perception actuelle de Wagner ? Cette disparition ou répression se manifeste-t-elle également dans l’écart apparemment incommensurable entre les styles de production modernes et le tumulte décoratif, coloré et historicisant du « style Makart » ?
Les réflexions de Mann dans son essai Les Peines et la Grandeur s’apparentent à des passages tirés de ses Réflexions d’un homme apolitique (1915–1918), où il examine la culture bourgeoise allemande qui a nourri le génie de Schopenhauer et de Wagner. Dans ce contexte, il suggère que sa comparaison pourrait avoir des racines historiques : « Je ne suis pas certain d’être l’auteur original de l’observation selon laquelle l’art de Wagner et ces arrangements floraux séchés élaborés par Makart (accompagnés de plumes de paon) partagent une origine historique et esthétique commune. »[11] Il est intéressant de noter que, dans les deux contextes, Makart est associé à un style de décoration intérieure (les fameux « bouquets Makart ») plutôt qu’à la peinture, bien que son nom soit devenu synonyme de ce dernier.[12] Bien que la mémoire du « style » ait perduré au-delà de la célébrité des peintures au début du XXe siècle, la généalogie des commentaires de Mann peut être retracée jusqu’à sa jeunesse (et même légèrement avant), lorsque la comparaison entre Wagner et Makart était, du moins brièvement, un trope critique établi.
« Le Richard Wagner de la peinture allemande »
Avant que le nom de Makart ne devienne synonyme de décor luxueux, un aspect de la qualité vigoureusement sensuelle et « contemporaine » de sa peinture frappait les spectateurs comme étant wagnérien. Déjà en 1869, juste avant de s’installer définitivement à Vienne, Makart était salué dans la Gazette des beaux-arts de Paris comme « le Richard Wagner de la peinture allemande »[13], dans une critique d’Eugène Muntz d’une exposition de 1868 au Kunstverein de Munich, qui présentait deux œuvres précoces sous forme de triptyque : Moderne Amoretten (Cupidons modernes) et Die Pest in Florenz (La Peste à Florence, également connue sous le nom de Les Sept Péchés Capitaux). La réception controversée de ces œuvres a attiré l’attention internationale sur le peintre. Peu après, en 1871, l’historien de l’art et critique allemand Wilhelm Lübke consacra un essai entier à démontrer les affinités partagées entre le compositeur controversé et le jeune peintre autrichien. La première à Munich de Die Meistersinger (1868), suivie de productions à Vienne et à Berlin au cours des deux années suivantes, avait maintenu le nom de Wagner présent dans les médias. Pendant ce temps, une paire de natures mortes de grand format par Makart, intitulée Abundantia (sous-titrée respectivement Les Dons de la Mer et Les Dons de la Terre), avait circulé dans plusieurs villes allemandes en tant qu’exposition spéciale. Lübke note que la réception mitigée de ces tableaux est comparable à celle d’ « un nouvel opéra de Richard Wagner ».[14]
Pour Lübke, l’attrait de ces deux figures pour les goûts contemporains est révélateur de la décadence de ces derniers : un appétit pour le choc, pour toute nouvelle stimulation sensorielle, et surtout, une perte d’une relation saine et appropriée à la « nature » en tant qu’arbitre ultime de la valeur esthétique. Sa comparaison entre le peintre et le musicien ne repose pas sur des sujets communs (bien que Makart exécuterait plus tard quelques sujets wagnériens, comme nous le verrons, ceux-ci ne constituaient pas la base d’un parallèle perçu avec les œuvres de Wagner), mais sur un sens du « style » ou un caractère esthétique fondamental. « En regardant ces toutes dernières œuvres » (les tableaux d’Abundantia), écrit-il, « l’affinité particulière avec Richard Wagner nous a frappés plus fortement que jamais – non seulement par l’effet extérieur des œuvres, mais aussi par leur nature artistique essentielle. Makart est en effet la musique du futur en peinture [gemalte Zukunftsmusik], tout comme Wagner nous apparaît comme le Makart musical. »[15]
Une tendance moderne et décadente à travailler « contre nature » dans le style de Makart se manifeste principalement par une exagération de l’effet coloristique, accompagnée d’un mépris pour la rationalité de la ligne, du dessin et de la composition logique. Des termes tels que Farbenreiz, Farbenaccorde et Farbenflecke(« stimulation, accords et éclats de couleur ») sont fréquemment utilisés tout au long de l’essai. Lübke évoque également avec désinvolture l’expression « l’idéalisme souverain de la couleur », par laquelle un critique berlinois admiratif tentait d’élever cette caractéristique au rang de vertu esthétique.[16] L’hégémonie de la couleur demeure un leitmotiv constant dans la réception critique de l’œuvre de Makart, tant dans ses aspects positifs que négatifs, jusqu’à la fin du siècle (voir ci-dessous, « Farbenrausch : la couleur comme fétiche »). Pour Lübke, ce point est également fondamental dans le parallèle avec la musique et les drames de Wagner : « Tous ses opéras sont dominés par les mêmes effets fantastiques de timbre [Klangwirkung], le même manque de clarté dans le design, et la même incapacité à créer de véritables personnages. » Les formes corporelles dans les tableaux de Makart semblent souvent dépourvues de toute relation naturelle et logique, favorisant plutôt un tumulte orgiastique :
« Cela pourrait expliquer pourquoi ces « figures idéales » dans les opéras de Wagner, « même lorsqu’elles commettent des actes d’adultère et, comme dans les Nibelungen, un peu d’inceste en prime, ne suscitent pas l’indignation des spectateurs et des auditeurs : on n’est pas plus enclin à leur attribuer des actions crédibles [wirkliches Handeln] qu’aux personnages des peintures de Makart. »[17]
Le régime de la « couleur absolue » chez Makart trouve un écho dans l’ « orchestre souverain » chez Wagner. La couleur orchestrale privilégie une dimension visuelle, extra-musicale, dans des opéras qui se perçoivent « plus avec les yeux qu’avec les oreilles », offrant une multitude de « paysages et de groupements » picturaux, tels que « ces Venusberg, lits de rivières, arcs-en-ciel et feux magiques »[18]. Lübke conclut que le peintre et le compositeur ne fournissent à la société contemporaine que les qualités qu’elle désire : « Que veut notre société avec un art sérieux, réfléchi, simple et vrai ? Ce qu’elle recherche, c’est plutôt une forme d’art ludique, luxueusement stimulante, sensuellement chatouillante, visuellement enivrante et auditivement écrasante. »
Il semble que le Gesamtkunstwerk parfaitement moderne aurait dû être le fruit d’une collaboration entre Makart et Wagner. À la fin des années 1870, alors que la réputation de Makart était à son apogée, Wagner aurait envisagé de lui commander des designs de costumes pour la première de Parsifal à Bayreuth[19]. Cependant, cette idée ne se concrétisa jamais, bien que les décors de Paul von Joukowsky pour la production évoquent clairement le « style » qui était devenu bien codifié d’ici 1882. Les rencontres personnelles entre le compositeur et le peintre furent rares et brèves, à l’exception d’une fête costumée mémorable donnée en l’honneur de Wagner dans l’atelier de Makart en mars 1875 (voir ci-dessous, « Les Wagner chez Makart »).
Leurs personnalités étaient, à certains égards, diamétralement opposées : alors que Wagner était connu pour sa volubilité en tant qu’interlocuteur, correspondant et écrivain sur une multitude de sujets, Makart se distinguait par sa douceur, frôlant parfois la taciturnité (un grave accident survenu à l’âge de cinq ans a peut-être entraîné des troubles de la parole). Bien qu’il ne fût pas antisocial, il n’a pratiquement laissé aucune correspondance, mémoires ou autres écrits. Lorsque Lübke a d’abord proposé l’idée d’une affinité élective entre le compositeur et l’artiste, Makart était perçu comme le jeune renégat, tandis que Wagner cherchait à consolider son statut de « vieux maître » moderne, à l’image de Hans Sachs et de Die Meistersinger. Ainsi, Cosima Wagner n’a pas exprimé d’appréciation, mais plutôt du ressentiment, lorsqu’elle a remarqué avec Richard, dans un numéro de l’Augsburg Allgemeine Zeitung de mai 1871, que le critique Karl Gutzkow avait eu l’audace de comparer Die Meistersinger von Nürnberg à Madame Bovary de Flaubert et à un tableau de Makart ![20] Cette comparaison intrigante, bien que décontextualisée, rappelle la réputation provocante et moderniste que Makart partageait avec des figures telles que Wagner et Flaubert, avant que lui et son « style » ne soient relégués au rang de symboles d’une pompe bourgeoise fanée. En dépassant les arrangements floraux et le bric-à-brac exotique archaïsant, que pourrions-nous encore apprendre aujourd’hui en comparant les opéras de Wagner à « un tableau de Makart » ?
Motifs wagnériens
Le lien entre Makart et Wagner repose, comme nous l’avons observé, sur une affinité stylistique plutôt que sur des thèmes communs, contrairement à des artistes comme Fantin-Latour en France ou le contemporain de Makart, Gabriel von Max, qui était plus académiquement conventionnel. Les rares œuvres de Makart inspirées par Wagner proviennent de la fin de sa carrière ou sont des pièces mineures antérieures, sans référence explicite aux opéras de Wagner. Néanmoins, il est intéressant de les comparer aux peintures plus emblématiques qui ont défini son style vers 1870, suscitant des parallèles avec Wagner, indépendamment des thèmes abordés.[21]
Une série de scènes, principalement issues de Das Rheingold et Die Walküre, fut réalisée durant la dernière année de la vie de Makart. Sept de ces œuvres sont conservées dans des musées à Riga et à Kiev, tandis qu’une huitième, représentant les filles du Rhin recevant l’anneau à la fin de Götterdämmerung, disparut en 1945. Aucune commande connue n’existe pour ces tableaux. Il est possible que la mort de Wagner en février 1883 ait incité Makart à les créer en hommage, car ils ont été exposés pour la première fois en septembre de la même année. À ce moment-là, Makart souffrait d’une infection syphilitique avancée qui entraînerait sa propre mort un an plus tard, le 3 octobre 1884. En dehors de cette série, il a produit relativement peu d’œuvres après 1880. L’austérité de ce « cycle » de L’Anneau, réalisé principalement dans des tons sombres et morbides évoquant le crépuscule, la nuit ou des décors tempétueux, pourrait être interprétée comme un « style tardif ». Cependant, un monumental tableau intitulé Printemps et Été, créé entre 1881 et 1883 dans le cadre d’un cycle de saisons projeté, affiche toute l’abondance décorative florale qui lui est habituellement associée. La palette générale de ces œuvres contraste fortement avec la richesse colorée qui avait contribué à sa grande popularité dans la décennie précédente. Dans chaque cas, les bruns, gris, noirs et blancs qui dominent l’image servent de contrepoint à quelques détails rehaussés d’or ou de bronze : le casque de Brünnhilde, la garde de l’épée de Siegmund, les brassards de Fasolt et Hunding, un couvre-chef « oriental » pour Hunding, une large ceinture décorée autour de la jupe de Sieglinde, et une pile de bibelots archaïques stylisés représentant le trésor des Nibelungen (comme illustré dans La Bataille des Géants, La Mort de Siegmund et Brünnhilde Sauve Sieglinde ; La Mort de Siegmund est représentée à la Fig. 3).
 Malgré l’absence de sa palette signature dans ces œuvres tardives, la tendance maniériste des corps à se contorsionner et à s’entrelacer jusqu’à devenir illisibles (avec des mains et des pieds souvent hors de vue) persiste, une caractéristique pour laquelle l’artiste avait déjà été critiqué dans ses œuvres antérieures. Dans ces dernières, ce traitement fluide et apparemment évasif des corps était souvent perçu comme un signe d’un dessin déficient, compensé par la virtuosité de la couleur, du mouvement et de la décoration.
Malgré l’absence de sa palette signature dans ces œuvres tardives, la tendance maniériste des corps à se contorsionner et à s’entrelacer jusqu’à devenir illisibles (avec des mains et des pieds souvent hors de vue) persiste, une caractéristique pour laquelle l’artiste avait déjà été critiqué dans ses œuvres antérieures. Dans ces dernières, ce traitement fluide et apparemment évasif des corps était souvent perçu comme un signe d’un dessin déficient, compensé par la virtuosité de la couleur, du mouvement et de la décoration.
Les quelques images wagnériennes qui précèdent cette série tardive ont un lien tenu avec les opéras du compositeur. La Galerie Belvédère à Vienne possède un dessin partiellement détaillé, peut-être inachevé, pour une décoration de plafond dont la date reste incertaine. On y trouve des motifs du combat des géants et de l’étreinte de Siegmund et Sieglinde, mais seulement sous des formes esquissées, sombres ou voilées, ainsi que la rançon de Freia et la conversation entre Brünnhilde et les filles du Rhin (une scène qui n’est en réalité pas représentée dans le cycle de Wagner). Des déesses tutélaires féminines aux contours légèrement plus détaillés divisent les quatre quadrants du design, le tout exécuté dans des nuances de brun, de gris et de roux, avec des fonds décoratifs dorés et divers objets (trésor, armure). (Esquisse pour le plafond Der Ring des Nibelungen, Österreichische Galerie Belvedere, Vienna: www.artrenewal.org/ pages/artwork.php?artworkid=15081&size=large.)
Cette esquisse pourrait dater de la même période que la série de L’Anneau, bien qu’il ait également été suggéré qu’elle soit contemporaine des esquisses pour un célèbre décor mural de la bibliothèque du marchand viennois Nikolaus Dumba, un notable mécène et collectionneur de musique, datant du début des années 1870. L’historienne de l’art Renata Kassal-Mikula a proposé que Makart ait prévu ce design pour une salle de musique dans sa propre maison viennoise, à proximité de son atelier de la Gusshausstrasse.[22] Cependant, étant donné l’absence de preuves d’un enthousiasme personnel pour Wagner ou ses œuvres de la part de Makart, surtout lors de son installation à Vienne, cette hypothèse semble peu probable. Quoi qu’il en soit, le dessin ne fut jamais été réalisé.
Une œuvre emblématique du véritable « style Makart », tel qu’il est désormais perçu, est Le Baiser de la Valkyrie, réalisée vers 1880 (voir Fig. 4). Le schéma de couleurs, avec l’orage en arrière-plan et les éclairs blancs, évoque la série ultérieure des Nibelungen, bien que cette image présente un paysage traditionnel plus riche, incluant des ruines de temples druidiques au loin. Le guerrier rêveur ne peut pas être clairement identifié comme Siegmund de Wagner, en l’absence de Sieglinde ou de Hunding. Sa posture langoureuse et son air rêveur semblent davantage convenir à Sieglinde qu’à un héros en pleine bataille. Le tendre « baiser de la mort » de la valkyrie évoque une Brünnhilde ayant échangé ses rôles avec Wotan. Le héros androgyne repose délicatement sur une peau d’animal, qui pourrait tout aussi bien se trouver dans l’atelier de l’artiste ou dans un élégant salon de la Ringstrasse, décoré dans le « style Makart ».
Une œuvre antérieure, représentant la mort de Siegfried et datant de la fin des études de Makart à Munich (actuellement propriété du Creditansalt-Bankverein à Vienne), précède toute connaissance des drames de l’Anneau de Wagner et se distingue nettement de la série tardive des Nibelungen. Ce tableau s’inspire du Nibelungenlied, où Siegfried est tué par Hagen alors qu’il s’abreuve à une source. Un élément qui rappelle la série ultérieure est la contorsion maniériste du corps de Siegfried, dont les extrémités de la tête et des pieds sont presque invisibles. Son corps est entièrement drapé d’une robe écarlate, donnant à sa forme tordue l’apparence d’une grande flaque de sang, bien qu’aucun sang ni blessure ne soit explicitement représenté. Bien que les textures de la robe et de la chair soient quelque peu rugueuses et esquissées, le drapé rouge vif deviendra un motif signature dans l’œuvre mature de l’artiste.
Cependant, ces quelques motifs wagnériens n’ont pas eu d’impact significatif sur la réputation publique de Makart. La série tardive des Nibelungen n’a été exposée que brièvement avant d’être mise aux enchères avec le reste de la succession après la mort de l’artiste, et les œuvres antérieures, qualifiées de « wagnériennes » uniquement par association, n’ont pas reçu d’accueil public notable. Ainsi, malgré ce petit groupe de sujets inspirés par Wagner, l’affinité perçue entre sa musique et les tableaux de Makart ne repose pas sur des thèmes communs. Au contraire, elle semble découler de valeurs plus générales, telles qu’une grandiosité de design au détriment de la ligne ou du détail, une abondance décorative, une prédominance de la « couleur » sur la « forme », une atmosphère d’indulgence sensuelle, et, dans les œuvres antérieures de Makart, un élément de sexualité provocante, bien que principalement allusive.
Farbenrausch : la couleur comme fétiche
Le « rouge Makart » est rapidement devenu emblématique du style de l’artiste, représentant un élément fondamental de l’attrait visuel de sa peinture, au-delà du style décoratif qui lui sera ultérieurement associé. Les tissus et drapés rouges créaient une sorte de « mélodie orchestrale » à la manière de Wagner, unifiant de nombreuses compositions visuelles de Makart, qu’il s’agisse de scènes historiques ou de portraits. L’une de ses œuvres les plus célèbres, Venise Rends Hommage à Caterina Cornaro, largement exposée à l’apogée de sa carrière dans les années 1870, encadre la tête du sujet dans une explosion de tissus rouges, émergeant des figures de soutien telles que cardinaux, soldats et dames d’honneur, le tout sur un fond en damas moelleux, prolongé par un rideau de velours presque théâtral (Venise Rends Hommage à Caterina Cornaro, 1872–3 ; Österreichische Galerie Belvedere, Vienne : www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15075&size=large). Un portrait de la chanteuse viennoise Karoline Gomperz, réalisé en 1870, met en avant les nuances contrastées de sa blouse de style Renaissance en bordeaux profond et le rouge éclatant de sa jupe, qu’elle souligne en rassemblant les plis dans sa main gauche (Portrait de Karoline Gomperz, 1870 ; Carolino Augusteum, Salzbourg : www.royal-painting.com/htmllarge/large-19965.html).
Un portrait antérieur de ses nièces, Ida et Risse Rußsemeyer, datant de la période munichoise de Makart (1865), enveloppe encore plus intensément la figure centrale dans un écarlate vibrant, résonnant avec un morceau de satin drapé flottant dans le coin supérieur gauche de l’image. Une fois de plus, les mains et les pieds échappent au regard (voir Fig. 5).
Plus frappant encore est le regard troublant, adulte et désabusé de la figure principale, se prélassant parmi un bric-à-brac artistiquement agencé qui contribuera à définir le « style » ultérieur de Makart. La fusion incongrue de figures enfantines et de visages adultes sera un élément clé de plusieurs œuvres controversées, notamment le triptyque Moderne Amorettende 1868 (voir ci-dessous, Figs. 6 et 7). Une allégorie clairement sexualisée intitulée Les Plaisirs de la Vie (également de 1868) utilise un drapé rouge pour relier la colonne verticale formée par ses deux figures semi-nues à une nature morte légèrement chaotique au premier plan (www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15044& size=large).
La valorisation de la couleur en tant que paramètre dominant, presque autonome, a joué un rôle crucial dans la réception controversée de Makart à ses débuts. Robert Stiassny écrivait que « l’œil de l’artiste était si exclusivement tourné vers les couleurs que chaque tableau émergeait d’abord de la palette comme une frénésie de couleur [Farbenrausch], le sujet n’étant conçu qu’ultérieurement »[23]. Wilhelm Lübke, comme nous l’avons noté, a également mis en avant cette prééminence de la couleur dans sa comparaison entre Makart et Wagner. Dans son essai de 1871, il affirmait que « ce qu’est la couleur absolue chez Makart est l’orchestre souverain chez Wagner »[24]. Tout comme la fétichisation de la couleur et des textures matérielles par Makart semblait reléguer les sujets de ses œuvres à un statut secondaire, on pensait que Wagner subordonnait ses lignes vocales aux timbres et textures dominants de l’orchestre, « auquel il confie tous les rôles ».
Le peintre et le compositeur étaient tour à tour critiqués ou célébrés, en fonction des normes esthétiques de leur époque, pour leur audace à explorer les valeurs sensuelles de leurs médiums, plaçant celles-ci au-dessus des caractéristiques cognitives et structurelles fondamentales du « design » graphique ou mélodique. Cela incluait des éléments tels que des corps lisibles et une action narrative en peinture, ainsi que des hiérarchies compréhensibles de motifs, de phrases et de périodes dans la mélodie opératique. Pour Lübke, cette inversion des valeurs était essentielle à l’attrait controversé des deux artistes pour les sensibilités modernes, car ils maximisaient le stimulus sensuel au détriment de la « vérité » et de la « nature » du décor :
« Dans la « mélodie continue » de Wagner, caractérisée par une montée indistincte de tons, on peut également percevoir les harmonies coloristiques ondoyantes de Makart [Farbenakkorde], qui s’éloignent de toute vérité naturelle. L’atmosphère dans les deux cas est onirique et fantastique, créant une ivresse des sens, comme l’a justement noté un critique berlinois : une montée d’opium pour les oreilles dans un cas, et pour les yeux dans l’autre. Un élément poétique se manifeste indéniablement dans cette œuvre. Des scènes empreintes d’une ambiance féerique sont dépeintes de manière à captiver le cœur. Cependant, là où l’on recherche des figures claires, des êtres humains de chair et de sang, tout semble se dissoudre en motifs vides. »[25]
Un nécrologe de l’artiste dans le principal quotidien viennois, le Neue freie Presse, mettait en avant l’autonomie de la couleur et l’importance du costume comme caractéristiques marquantes du style de Makart et de son pouvoir d’attraction, tous deux liés à la « forte domination de l’élément pictural sur le graphique » : « Il se délectait des plaisirs de la couleur comme un ivre, et cette joie qu’il ressentait touchait également le cœur de ses spectateurs, qui tombaient en extase devant ces symphonies de couleur [Farbensymphonien], se rendant impuissants face à leur magie enivrante. »[26]
Ludwig Hevesi, un critique influent de la génération suivante, a souligné l’importance de Makart dans l’émergence de l’esthétique moderniste viennoise, désormais canonique grâce à Gustav Klimt et à son cercle. Hevesi a également mis en lumière la dynamique de la couleur et sa tendance vers une certaine autonomie. Dans un essai de 1900 intitulé Hans Makart et la Sécession, il écrit : « À travers tout son être coulait un unique flux de coloration [Farbigkeit], comme une passion visible, comme une sensation optique de plaisir. » En décrivant les effets de la « couleur Makart » (Makartfarbe), Hevesi utilise un langage presque explicitement wagnérien, qu’il convient de citer intégralement : « In ihr [der ‘Makartfarbe’] war ein unablässiges Kommen und Gehen von Flimmer, ein Flackern von Flamme, ein Knistern und Sieden und Glühen ohne Ende. »[27]
Tout en reconnaissant l’influence indéniable de Makart sur les artistes de la Sécession, Hevesi souligne également comment ce dernier a façonné les aspirations stylistiques de la bourgeoisie de son époque :
« La femme du philistin allemand adoptait les couleurs et les modes de Makart, chaque salon en Mitteleuropa aspirait à reproduire l’esthétique de son studio, et chaque cérémonie publique cherchait à imiter ses spectacles historiques. Il n’est pas exagéré de dire que Makart était le peintre le plus évocateur que l’Allemagne ait connu, ayant défini à lui seul une époque que l’on appelle l’« ère Makart ». Seule une autre figure artistique, Richard Wagner, a exercé un génie comparable, souvent qualifié de « flûtiste démoniaque » [Rattenfänger-Genie]. Richard Wagner[28]
Lors du premier festival de Bayreuth en 1876, où Makart était présent aux côtés de son collègue munichois Franz Lenbach, ami de la famille Wagner, Eduard Hanslick a exprimé une opinion similaire sur le génie résolument « moderne » partagé par ces deux artistes. En exprimant son scepticisme quant à la dépendance de L’Anneau de Wagner aux « effets » technologiques contemporains, Hanslick établit un lien entre la faiblesse perçue du véritable design et les critiques adressées à Makart :
« Wagner a tiré parti de tous les progrès modernes dans les sciences naturelles appliquées. Nous avons été émerveillés par la vaste machinerie de scène, les appareils à gaz et les dispositifs à vapeur qui animaient la scène de Bayreuth. Les Nibelungen de Wagner n’auraient pas pu être composés avant l’invention de la lumière électrique, tout comme ils ne pouvaient exister sans la harpe ou le tuba basse. Ainsi, c’est la coloration [Colorit], au sens le plus large, qui masque la faiblesse du design [Zeichnung] dans la dernière œuvre de Wagner, lui conférant un niveau d’indépendance sans précédent. L’analogie entre Wagner le musicien et Makart le peintre, ou Hamerling le poète, est évidente. L’enchantement sensuel de cette musique exerce une stimulation directe et puissante sur les nerfs de son public, en particulier sur le public féminin. » [29]
La critique de Hanslick sur le Gesamtkunstwerk de Wagner anticipe la métaphore marxiste d’Adorno concernant la « phantasmagorie » wagnérienne, tout en rappelant les origines culturelles de cette figure dans la technologie du divertissement moderne (machinerie de scène, machines à vapeur, éclairage au gaz et électrique).[30]
En tant que critique musical en chef de la presse viennoise, Hanslick était bien conscient de la réputation populaire de Makart et du discours qui l’entourait. La comparaison avec le poète autrichien Robert Hamerling provient probablement d’un de ses collègues universitaires, Karl Landsteiner, qui a publié un pamphlet intitulé Hans Makart und Robert Hamerling : Zwei Repräsentanten moderner Kunsten en 1873[31]. La critique de Wilhelm Lübke sur l’autonomie de la « couleur » et la prédominance de l’effet sensuel sur la beauté et la logique de la « forme » ou du « design » se retrouve également ici.
Malgré leur rôle dans l’opinion critique contemporaine, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de telles comparaisons entre Wagner et le jeune peintre autrichien, aucun d’eux n’ayant manifesté un intérêt véritable pour l’œuvre ou le domaine de l’autre[32]. La « stimulation » coloristique et l’horror vacui de la Belle Époque suffisent-elles à établir un lien significatif entre la musique de Wagner et la peinture de Makart, ou son « style » ? Bien que la fétichisation critique de la couleur puisse susciter un certain scepticisme aujourd’hui, il a été suggéré que les célèbres rouges de Makart ont pu subir une détérioration significative au fil du temps. La réception critique fortement divisée de Wagner et de Makart à l’apogée de la renommée du peintre, dans les années 1870 et au début des années 1880, présente un parallèle qui n’est suggéré par aucun autre artiste allemand ou autrichien de la période. Mais peut-on expliquer leur identification contemporaine par une référence plus concrète et matérielle à leurs œuvres respectives ?
Deux moments marquants de la carrière de Makart laissent entrevoir une telle possibilité. En 1868, à l’issue de son apprentissage à Munich, il se fait connaître sur la scène internationale grâce à l’exposition de deux triptyques controversés : Moderne Amoretten (Cupidons modernes ou putti) et le titre ambigu Die Pest in Florenz ou Die Sieben Todsünden (La Peste à Florence, Les Sept Péchés Capitaux). Ces œuvres coïncident avec la deuxième grande première munichoise de Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg. Les deux triptyques offrent des variations provocantes et délibérément « décadentes » sur le motif classique de la bacchanale, invitant à une comparaison avec la musique révisée du Venusberg de Wagner pour la production de Tannhäuser en 1861. Par ailleurs, la sémiotique de l’érotisme et de la mortalité qui imprègne la seconde série évoque une affinité avec le langage poétique et musical de Tristan und Isolde.
Un moment clé de Makart en lien avec les Meistersinger se manifeste une décennie plus tard, en 1879, dans l’ombre de la carrière de Wagner, à un intervalle décalé. Il conçoit alors une grande fête civile ou un défilé pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de mariage de l’empereur austro-hongrois François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth. Cet événement met en scène une fantaisie nationaliste d’un âge d’or austro-allemand, se présentant comme un véritable Gesamtkunstwerk populiste. Il glorifie l’esprit entrepreneurial de la Ringstrasse de Vienne à travers l’imagerie de l’Allemagne de la Renaissance et du baroque autrichien, incarnant ainsi le style Makart dans l’espace public.
Deux moments marquants de la carrière de Makart laissent entrevoir une telle possibilité. En 1868, à l’issue de son apprentissage à Munich, il se fait connaître sur la scène internationale grâce à l’exposition de deux triptyques controversés : Moderne Amoretten (Cupidons modernes ou putti) et le titre ambigu Die Pest in Florenz ou Die Sieben Todsünden (La Peste à Florence, Les Sept Péchés Capitaux). Ces œuvres coïncident avec la deuxième grande première munichoise de Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg. Les deux triptyques offrent des variations provocantes et délibérément « décadentes » sur le motif classique de la bacchanale, invitant à une comparaison avec la musique révisée du Venusberg de Wagner pour la production de Tannhäuser en 1861. Par ailleurs, la sémiotique de l’érotisme et de la mortalité qui imprègne la seconde série évoque une affinité avec le langage poétique et musical de Tristan und Isolde.
Le moment clé de Makart en lien avec les Meistersinger se manifeste une décennie plus tard, en 1879, dans l’ombre de la carrière de Wagner, à un intervalle décalé. Il conçoit alors une grande fête civique ou un défilé pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de mariage de l’empereur austro-hongrois François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth. Cet événement se présente comme une véritable fantaisie nationaliste d’un âge d’or austro-allemand, mise en scène comme un Gesamtkunstwerk populiste. Il glorifie l’esprit entrepreneurial de la Ringstrasse de Vienne à travers l’imagerie de l’Allemagne de la Renaissance et du baroque autrichien, incarnant ainsi le style Makart dans l’espace public.
Bacchanales modernes : Moderne Amoretten, Die Pest in Florenz et le Venusberg de Paris
Lorsque Wagner fut appelé à Munich par le patronage royal de Louis II en 1864, Hans Makart était en pleine formation auprès du respecté peintre d’histoire Karl von Piloty à l’Académie des Beaux-Arts de Munich. Tout au long des années 1860, il a travaillé et exposé aux côtés de Piloty, atteignant la célébrité avec l’exposition de ses deux triptyques, Moderne Amoretten et Die Pest in Florenz, au Kunstverein de Munich dans la seconde moitié de 1868. Comme le souligne Nikolaus Schaffer, la soudaine renommée de Makart sur la scène artistique européenne s’est manifestée de manière « moderniste », suscitant scandale et controverse tout en attirant l’attention de critiques sérieux[33]. Cette réception initiale contraste fortement avec sa réputation posthume de simple faiseur de goût bourgeois, cédant à un matérialisme philistin décadent.
Le groupe Moderne Amoretten fut exposé au début de l’été 1868, coïncidant avec la première mondiale de Die Meistersinger au Théâtre national et à la Cour de Munich. Makart a mis en avant l’originalité de sa conception non seulement par l’adjectif « moderne » dans son titre, mais aussi en présentant simultanément les trois panneaux individuels comme une sorte de « composition » ou d’« installation ». Ces œuvres comprenaient une esquisse détaillée à l’huile illustrant comment il envisageait le déploiement des trois panneaux dans un décor mural élaboré, provisoirement destiné à son propre studio à Munich, bien que le panneau décoratif orné évoque plutôt un espace domestique aisé (voir Fig. 6, et image en couleur : www.jssgallery.org/Other_Artists/Hans_Makart/ModerneAmoretten_b.html).
Le paysage de fond des Amoretten est emblématique de l’artifice décoratif qui a défini ce que l’on appelle le « style Makart », au-delà de sa propre peinture. On y observe un délicat entrelacs de troncs d’arbres, de branches et de feuilles sur un fond doré, rappelant tant la peinture dévotionnelle médiévale que la japonerie moderne. La flore, notamment dans les deux décors en tondo ajoutés au modèle pour le décor mural composite (situés sous les panneaux flanquants), présente des arrangements délicats de roseaux, de frondes et de fleurs séchées, enrichissant ainsi le style décoratif ultérieur.
Le luxe raffiné de l’ensemble de l’ambiance semble déconnecté de l’extérieur – on se souvient du désir de Tannhäuser pour le soleil, l’herbe verte et le « firmament amical » au-dessus (« des Himmels freundliche Gestirne ») après sa longue errance dans le paradis artificiel de la grotte de Vénus. Le schéma de couleurs de Makart est délibérément « en défi à la nature », comme l’a souligné Wilhelm Lübke, qui a noté que « ses compositions dans leur ensemble, tout comme les figures individuelles, transmettent la sensation de quelque chose de complètement irréel, insensé, fou »[34].
La véritable provocation des Moderne Amoretten réside dans son élément de « non-réalité » soigneusement orchestré, engendrant une dissonance cognitive moralement ambiguë dans la représentation des « cupidons » féminins. Les visages, coiffures et costumes de ces figures sont contemporains et adultes, contrastant avec leurs formes juvéniles, ce qui crée un passage troublant entre l’enfance et la maturité, ainsi qu’entre l’innocence et l’expérience. Dans le panneau de droite, deux figures échangent un baiser saphique ou une confidence intime, bien qu’il n’y ait rien d’ouvertement sexuel dans l’ensemble de la représentation. Les figures à leur gauche sont enveloppées dans un clair-obscur étrange, évoquant l’intérieur éclairé au gaz d’un théâtre ou d’une salle de danse, rappelant une autre remarque critique de Lübke : l’image de la beauté féminine selon Makart semble provenir d’« établissements tels que le Mabile, la Closerie des Lilas, les casinos de Baden-Baden et Bad Homburg, ou leurs équivalents viennois »[35].
La reine-enfant, majestueusement placée au centre de la composition, détourne le regard avec une expression mélancolique et oblique, laissant transparaître une impression de fatigue ou de chagrin plutôt que de plaisir, ce qui est plus manifeste dans la version achevée du panneau individuel (voir Fig. 7). Entre les putti masculins qui portent la litière à l’avant, se trouve une figure féminine aux cheveux blancs ou poudrés, arborant du rouge à lèvres et vêtue d’une chemise ou d’un négligé blanc qui épouse son corps. Les figures du panneau de gauche sont également habillées dans des styles de soirée modernes, l’une d’elles, à l’extrême gauche, portant un costume de domino noir qui flotte de manière éthérée devant elle.
Ce mélange singulier d’érotisme et de mélancolie, ancré dans un paysage exquisément artificiel et mis en scène sur le mur d’un intérieur domestique élégant, a captivé l’imagination esthétique de l’époque d’une manière que les critiques ont eu du mal à exprimer. À un certain niveau, cela évoquait sans doute une esthétique naissante de la décadence. Karl Landsteiner résume le ton d’opprobre fasciné suscité par les Amoretten dans son essai sur Makart et Hamerling : « Les images sont une sorte d’improvisation décorative, comme l’a justement souligné Friedrich Pecht, où non seulement toutes les règles académiques existantes, mais aussi tous les canons de la nature et de la vraisemblance sont moqués à un degré presque fabuleux. La composition présente des enfants et des jeunes filles à moitié dénudées, à moitié habillées et coiffées dans un style résolument moderne ; le contraste qui en résulte a été décrit – que ce soit à juste titre ou non, je n’ose le dire – comme une profanation de l’enfance. En comparant ces figures aux représentations audacieuses de génies ou de cupides de [Wilhelm] Kaulbach, on trouve dans les Amoretten de Makart un trait sensuel maladif, un souffle de décadence moderne et de corruption morale. Ce n’est pas que Makart ait voulu exprimer cela, mais on peut néanmoins le lire dans l’image. Peut-être crée-t-il de manière assez naïve, comme le soutiennent ses admirateurs ; pourtant, la qualité « moderne » qu’il produit, même de cette manière « naïve », est empreinte du sceau de la corruption. »[36]
On peut supposer que les critiques ne percevaient pas dans l’œuvre une dénonciation explicite de la prostitution infantile, mais plutôt un reflet d’une perte d’innocence sexuelle plus générale, qui, selon les mots de Landsteiner, « marquait » la psyché moderne.[37]
De manière similaire, le faune néo-classique rococo, apparemment innocent, qui se déhanche dans la Bacchanale du Venusberg de Wagner se transforme en « sujet désirant » résolument modernes grâce à la musique, en particulier dans la révision et le développement de 1860–1861 pour Paris. Le scénario parisien présente en effet une troupe d’Amoretten, d’abord découverts allongés « chaotiquement entremêlées dans un amas confus, comme des enfants épuisés après un jeu bruyant ». (L’« arabesque » charnue des membres enfantins est une caractéristique typique de Makart.) Lorsque le tumulte orgiastique des faunes, satyres, nymphes, bacchantes et jeunes atteint son paroxysme, le trio effrayé des « Grâces » réveille les Amoretten et leur ordonne de chasser l’équipage indiscipliné. Ces cupides, agissant comme une sorte de police érotique, apprivoisent les passions des couples et les réarrangent avec goût en arrière-plan. Tout cela constitue en réalité un rideau allégorique-balletique dissimulant l’union implicite de Tannhäuser et Vénus, qui sont ensuite montrés s’attardant dans une étreinte post-coïtale calme, divertis par des projections de métamorphoses amoureuses classiques (« Le Viol d’Europe », « Léda et le Cygne »). Pendant ce temps, le motif langoureux de Vénus de la partition originale est réinterprété par une nouvelle orchestration et un accompagnement tristanesque, incorporant le célèbre accord de Tristan, progressivement résolu vers le mi bémol majeur (Exemple 1).
Eduard Hanslick, en examinant la production viennoise de 1875 de la partition révisée, commentait que la musique originale du Venusberg était « la plus audacieuse et la plus sensuellement enivrante » jamais entendue à l’époque. En comparaison avec la nouvelle partition, cependant, elle lui semblait aussi inoffensive qu’« une réunion de famille bourgeoise un dimanche après-midi ». « Un tel flot de passion débridée, produit ici par les masses évolutives de couples minaudant et gémissant, pourrait être trop même pour le tempérament le plus libéral. C’est carrément anti-esthétique. » [38] Hanslick reconnaissait aisément l’influence de l’idiome de Tristan et Die Meistersinger, qu’il qualifie ici de « style combinatoire ultérieur de l’écriture orchestrale », dans la nouvelle version de la Bacchanale. Il était particulièrement frappé par l’expression musicale sans détour du désir sexuel appliquée à des figures humaines et mythiques-allégoriques, y compris une pantomime grossière de Léda et le Cygne : « Il aurait été tout à fait suffisant de se concentrer uniquement sur les couples humains, sans inclure à contrecœur les quatre faunes à sabots fendus dansant le cancan au premier plan. »[39]
La décadence moderne de la Bacchanale de Wagner est plus manifestement évidente que celle des Amoretten de Makart, avec son atmosphère étrangement ambivalente et hyper-esthétique. Cependant, dans chaque cas, le traitement audacieux et non conventionnel du médium spécifique (musique ou peinture) contribue de manière essentielle à l’impact provocateur de l’œuvre[40]. La réaction de Hanslick face à la sexualité ouverte de la nouvelle Bacchanale pourrait également être illustrée, en miniature, par une œuvre de Makart de quelques années plus tard, Pan et Flora (1872), où une nymphe à moitié adulte, ornée à la manière de Makart, pose timidement sa main sur le genou d’un jeune faune qui la regarde avec un sourire malicieux et complice.
Les Moderne Amoretten, tout comme Pan et Flora, suscitent une certaine déstabilisation en raison de leur coquetterie réticente et de la fausse naïveté qui semble dissimuler des sous-entendus sexuels. Les jeunes filles florales phantasmagoriques de Klingsor dans Parsifal illustrent parfaitement ce mélange d’innocence apparente et de sexualité décadente. Une autre œuvre controversée de Makart, la série La Peste à Florence, s’approche davantage d’un abandon sans vergogne, semblable à celui de la Bacchanale du Venusberg révisée. En effet, ces tableaux ont été interdits d’exposition au salon de Paris de 1869, apparemment en raison de leur impudence, accentuée par l’absence manifeste de tout contenu narratif-historique cohérent, lisible et potentiellement rédempteur. Ils ont été présentés en privé par le célèbre marchand d’art parisien Adolphe Goupil. Ce manque de sujet narratif clairement défini dans les peintures est en partie compensé par le plan allégorique suggéré par l’un des titres alternatifs de la série, Les Sept Péchés Capitaux. Les figures de l’Orgueil et du Meurtre sont discernables au début du premier panneau et à la fin du troisième, respectivement, tandis que la Luxure est brillamment mise en lumière au centre du panneau, à l’instar de la Reine du groupe des Amoretten, avec la Vanité, vêtue de rouge, se trouvant à sa droite (voir Fig. 8, le panneau central ici : www.fineart-china.com/upload1/file-admin/images/new16/Makart, Hans-668677.jpg).
L’autre titre associé à cette série, La Peste à Florence, est généralement interprété comme une allusion au cadre du Décaméron de Boccace, et certains costumes confirment un contexte de cour de la Renaissance. Cependant, le motif principal évoque une décadence troublante et autodestructrice, inspirée de la période romaine classique tardive, comme en témoigne le célèbre tableau Les Romains de la Décadence de Thomas Couture, exposé au Musée d’Orsay en 1847. Cette tradition iconographique est également suggérée par un autre titre alternatif pour les tableaux, ou peut-être une légende informelle attribuée à l’artiste : Après nous le déluge. Le thème de la décadence romaine est renforcé par l’association du nom de Makart avec celui du poète autrichien contemporain Robert Hamerling dans les premières critiques, notamment celles de Hanslick et Karl Landsteiner. L’œuvre la plus célèbre de Hamerling, un poème épique en six chants intitulé Ahasver in Rom, relie le légendaire « Juif Errant » à la cour de l’empereur Néron (le deuxième chant est d’ailleurs intitulé Bacchanal). Il est possible que Makart ait cherché à fusionner l’iconographie de la décadence romaine classique avec celle de la société corrompue des courtisans de la Renaissance, à l’image des Lucrèce Borgia ou de Le roi s’amuse de Hugo, un motif qui gagnerait en popularité à la fin du XIXe siècle.
L’évasion délibérée de tout cadre distinct ou contenu narratif a contribué à l’effet provocateur de La Peste, tout comme cela avait été le cas avec la série précédente des Amoretten. La confusion des corps, caractérisant à la fois les panneaux central et droit, crée une analogie visuelle avec la « mélodie sans fin » wagnérienne, que Wilhelm Lübke avait comparée à l’effet des Farbenakkorde de Makart[41]. La profusion de corps ou de parties de corps, principalement fragmentaires, évoque une gestuelle expressive mais échoue à se conformer à une syntaxe visuelle normative, tout comme les motifs dans la « mélodie sans fin » de Wagner résistent à se structurer en hiérarchies de phrases, de périodes ou de groupes facilement lisibles. Les corps de Makart ont également été critiqués pour n’être que « toute chair et pas d’os »[42]. Les formes tordues et les extrémités dissimulées dans les deuxième et troisième panneaux de La Peste à Florence, ainsi que l’absence de mains et de pieds qui pourraient articuler la « phraséologie » précise des formes humaines, en sont des symptômes emblématiques.
Dans une monographie de 1942 sur Makart, le peintre et scénographe moderniste Emil Pirchan a décrit cette œuvre comme présentant « des schémas sataniques inédits pour des plaisirs énervants de la chair avide, une frénésie ultime des sens, une orgie abandonnée de blasphème et d’horreur », ainsi qu’un « tumulte de couleurs [Farbenrausch] effusif et dangereusement sultry, baignant dans un éclat doré chaud à la fois les corps nus et ceux vêtus, entremêlés dans un clair-obscur inspiré de Véronèse »[43]. À l’époque où Pirchan écrivait, la trilogie La Peste à Florence avait récemment été confisquée par Mussolini dans la villa d’une famille bancaire austro-juive à Florence – Landau ou von Landau – qui possédait les tableaux depuis 1871. Mussolini les a ensuite présentés à l’un des collectionneurs les plus fervents de Makart, Adolf Hitler, pour son projet de musée du Führer à Linz. (Après nous le déluge, en effet.)
Dans ces œuvres, un geste expressif non dirigé se déploie au sein d’une composition qui s’oriente de manière provocante vers l’abstraction, plutôt que vers une représentation claire et définie. On pourrait faire une observation similaire concernant l’idiome musical et le texte dramatique de Tristan und Isolde de Wagner. Les critiques sceptiques dénonçaient, tant dans les peintures que dans la musique de Wagner, la subordination de l’action narrative à une expressivité incessante et hypertrophiée. Par ailleurs, les tableaux de la Peste, quelle que soit notre interprétation du sujet, célèbrent le même mariage d’érotisme et de morbidité qui a fait de Tristan un modèle si séduisant de décadence à la fin du siècle. Même avant que le terme ne soit officiellement reconnu comme une catégorie esthétique, les critiques percevaient déjà cette valeur comme un lien entre le style précoce de Makart et le contexte culturel de son époque. Écrivant à l’époque où le peintre accédait à la célébrité en 1869, le critique et historien Friedrich Pecht soulignait une relation réciproque avec le Zeitgeist, notant l’« influence manifeste de notre époque sur cet artiste et les capacités d’anticipation qu’il a démontrées à cet égard ». « La décadence [Verdorbenheit] dépeinte par Makart, ce sabbat de sorcières du matérialisme et des plaisirs sensuels débridés, représente les terribles caractéristiques de notre temps. »[44]Karl Landsteiner développe cette idée en affirmant : « Ses œuvres sont une expression éminente des vues modernes [Anschauungen], elles sont tellement imprégnées d’une quête d’effets chatoyants, éblouissants et sensuellement déroutants pour le plaisir d’effets, qu’elles dissimulent leur idée fondamentale derrière un kaléidoscope éclatant de couleurs, au point qu’on pourrait conclure que Makart est peut-être trop peintre. »[45]De même, Wagner avait ironiquement reconnu que Tristan était peut-être « trop de musique » pour certains de ses détracteurs[46]. En d’autres termes, ces deux artistes peuvent être perçus comme poussant les moyens expressifs de leur médium respectif vers des fins « absolues », une tendance qui sera plus tard codifiée comme un paradigme central du modernisme esthétique.
Il est difficile de déterminer si Makart a réellement assisté à la première de Tristan de Wagner à Munich, trois ans avant d’exposer ces tableaux, ou comment cela aurait pu l’influencer. Il serait tentant de penser qu’il aurait été sensible à l’atmosphère du deuxième acte de Wagner, bien que la langue musicale ait probablement pu l’aliéner. En effet, le récit passionné d’Emil Pirchan sur la série de la Peste de Makart s’accorde mieux à la musique de Wagner que les décors historiquement raffinés d’Angelo Quaglio et Heinrich Döll pour le Tristan de Munich de 1865. L’artiste viennois Moritz von Schwind, devenu à cette époque une figure incontournable de l’établissement artistique munichois, a exprimé son dégoût pour les tableaux de Makart en termes synesthésiques, en faisant référence à l’école contemporaine « Nouvelle Allemande » : « Tout est confus, sans sujet [gedankenlos], affecté, maquillé avec des touches de couleur malsaines et lascives – tout cela a quelque chose de vénérien… Je déteste sincèrement ces farces musicales [diese Konzertpossen] avec leur arrière-plan syphilitique. »[47] Schwind conclut qu’il a vu et entendu bien assez de tels « héros » modernes, qu’il s’agisse de Wagner, Liszt ou Makart[48].
Le Festzug de Vienne de 1879 : un Gesamtkunstwerk civil inspiré des grands maîtres
Suite au scandale provoqué par ses premières expositions, Makart a cherché à s’intégrer à l’establishment artistique en réalisant une série de grandes peintures historiques, telles que Venise rendant hommage à Caterina Cornaro (1873) et Charles V entrant à Anvers (1878). Ces œuvres, qui allient l’émulation académique de maîtres tels que Véronèse et Tintoret à ses éléments distinctifs de sensualité « moderne » et de sensibilité décorative, lui ont permis de se faire un nom dans le milieu artistique. Ses efforts ont été récompensés par sa nomination en tant que professeur de peinture historique à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne en décembre 1878, succédant à Anselm Feuerbach, qui avait souvent exprimé son mépris pour l’attrait populaire de Makart. La commande de concevoir un grand défilé historique pour célébrer le 25e anniversaire de mariage de l’empereur François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth en 1879 a marqué l’apogée de son succès public et social.
À cette époque, de tels défilés étaient des événements relativement courants. Ce qui a fait du défilé de 1879 une référence dans le genre, c’est le flair unique de Makart pour transformer l’antique et l’exotique en véritables décors pour la vie moderne. Bien que l’occasion soit officiellement dynastique, elle célébrait également la nouvelle Ringstrasse de Vienne et tout ce qu’elle représentait : la reprise économique après le krach boursier de 1873 et l’essor d’une bourgeoisie européenne puissante et prospère. Le rapprochement symbolique entre l’ancienne aristocratie et la classe moyenne moderne émergente, ainsi qu’un changement concomitant dans le patronage artistique, a été mis en scène dans Die Meistersinger de Wagner et a trouvé un écho dans le Festzug, qui a également conféré une dignité historique et nationale aux sources du bien-être économique bourgeois.
 Le défilé mettait en avant des activités pittoresques et traditionnelles telles que l’horticulture, la chasse, la boulangerie, la forge, la brasserie, le soufflage de verre, l’impression et la reliure. Les chars des boulangers ou des tanneurs auraient pu être directement inspirés par la scène de la Prairie du Festival dans les Meistersinger de Wagner. L’esprit d’exubérance nostalgique völkisch-national qui imprègne les décors évoque un croisement entre l’opéra de Wagner et le défilé « Printemps pour Hitler » des Producteurs. (voir Fig. 9 ; www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15053&size=large; and for the Horticulture float see: www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15056& size=large).
Le défilé mettait en avant des activités pittoresques et traditionnelles telles que l’horticulture, la chasse, la boulangerie, la forge, la brasserie, le soufflage de verre, l’impression et la reliure. Les chars des boulangers ou des tanneurs auraient pu être directement inspirés par la scène de la Prairie du Festival dans les Meistersinger de Wagner. L’esprit d’exubérance nostalgique völkisch-national qui imprègne les décors évoque un croisement entre l’opéra de Wagner et le défilé « Printemps pour Hitler » des Producteurs. (voir Fig. 9 ; www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15053&size=large; and for the Horticulture float see: www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15056& size=large).
En plus des trente-cinq esquisses détaillées à l’huile (64 x 285 cm) que Makart a préparées pour les chars, de nombreuses photographies de studio des participants capturent les costumes historiques élaborés créés pour l’occasion, inspirés par Dürer ou la Renaissance hispano-habsbourgeoise.
 La Fig. 10 montre le groupe costumé représentant l’Association des Travailleurs du Bronze et des Métaux. Parmi les figures costumées des arts et métiers, on trouve un personnage vêtu comme Gutenberg, dans une pose similaire à celle de Sachs, recevant une couronne de trois jeunes filles muses dans le design de Makart pour le char des imprimeurs, des marchands d’art et de livres. Même l’industrie moderne était représentée : les chemins de fer étaient célébrés par une allégorie baroque de la locomotive à vapeur, où une nixe d’eau est passionnément embrassée par un dieu du feu tenant une poignée d’éclairs.
La Fig. 10 montre le groupe costumé représentant l’Association des Travailleurs du Bronze et des Métaux. Parmi les figures costumées des arts et métiers, on trouve un personnage vêtu comme Gutenberg, dans une pose similaire à celle de Sachs, recevant une couronne de trois jeunes filles muses dans le design de Makart pour le char des imprimeurs, des marchands d’art et de livres. Même l’industrie moderne était représentée : les chemins de fer étaient célébrés par une allégorie baroque de la locomotive à vapeur, où une nixe d’eau est passionnément embrassée par un dieu du feu tenant une poignée d’éclairs.
Bien que ce défilé éphémère ne vise pas à devenir un mémorial durable comme Die Meistersinger, symbole du « saint art allemand », il incarne néanmoins le programme théorique de Wagner pour l’« œuvre d’art du futur », en tant qu’événement participatif et performance collective de l’identité civique et nationale. On peut également évoquer l’idée précoce du compositeur, aussi fantaisiste soit-elle, de construire un théâtre en bois pour son Anneau des Nibelungen, qui serait démoli après la première représentation, afin que cet événement demeure un souvenir pur et unique dans l’esprit des quelques privilégiés qui y auraient assisté[49].
Dans son intégration de l’histoire, du style et de l’imagination esthétique au sein de la vie moderne, le Festzug représente un accomplissement majeur pour Makart en tant qu’artiste. « On pourrait croire à son Moyen Âge, tout en percevant la modernité de la conception sous-jacente », a écrit Robert Stiassny quelques années plus tard. « Toute la richesse de son imagination semblait se déployer ici, et si l’on considère l’atelier de Makart comme l’un de ses plus grands succès, on pourrait même qualifier le Festzug de son œuvre la plus aboutie. »[50]
Les Wagner chez Makart : un post-scriptum sur la mise en scène
Étant donné le talent de Hans Makart à capturer l’harmonie entre mythologie nationale archaïque et sensualité matérielle moderne, semblable à celle des drames musicaux de Wagner, il est captivant de s’interroger sur ce qu’une collaboration entre eux aurait pu engendrer. Leur interaction la plus proche fut une approche timide faite à Makart pour concevoir des costumes pour Parsifal, comme mentionné précédemment. (Le fait qu’il ait été sollicité en tant que créateur de costumes plutôt qu’en tant que scénographe est révélateur ; la conception de décors théâtraux étant une spécialité, elle n’était pas couramment exercée par les artistes de premier plan.) Lorsque Richard et Cosima Wagner ont découvert pour la première fois le nom de Makart associé à leur œuvre en 1871, ils ont exprimé leur indignation à l’idée que Die Meistersinger puisse être lié à une compagnie aussi scandaleuse (en référence à Madame Bovary). Cependant, seulement deux ans plus tard, Cosima était enthousiasmée par les mêmes tableaux qui avaient suscité cette réaction initiale – le diptyque Abundantia – lorsqu’ils furent exposés à Bayreuth en 1873. Entre-temps, lors d’un voyage à Vienne en 1872, elle avait visité le célèbre atelier de Makart avec Richard et son amie de la haute société, la comtesse Dönhoff ; le style de Makart était en plein essor et commençait à exercer son charme[51]. Deux ans plus tard, Wagner fut l’invité d’honneur d’une soirée éblouissante organisée dans le studio viennois de Makart, le 3 mars 1875.
 L’entrée dans le journal de Cosima relatant cet événement est une liste éblouie de notables aristocratiques et culturels : des comtes et comtesses hongrois, les princes de Liechtenstein et de Metternich, « la famille Liszt », le peintre Heinrich von Angeli et sa femme, le poète-librettiste Salomon Mosenthal, ainsi que l’architecte Gottfried Semper. (Cette occasion avait été en partie organisée pour réunir Semper et Wagner, qui n’avaient pas échangé depuis que les plans pour un théâtre festival à Munich avaient été envisagés environ dix ans plus tôt.) Le quatuor Hellmesberger avait été invité à jouer Beethoven, mais le tumulte des invités costumés – sans parler du contenu même du studio – semble avoir couvert leurs efforts[52]. Parmi les invités se trouvait l’actrice Charlotte Wolter, une sorte de Sarah Bernhardt viennoise, proche de Makart et modèle occasionnelle. Apparemment, ce sont ses portraits dans des rôles de femme fatale, tels que Messaline et Cléopâtre, qui ont inspiré les Wagner à solliciter Makart pour concevoir des costumes pour Parsifal, avec Kundry en tête[53]. (La Fig. 11 présente une photographie de Wolter costumée en Messaline dans la pièce Arria und Messalina d’Adolph Wilbrandt, lors d’une séance de modélisation pour un portrait réalisé en 1875 ; voir également le portrait terminé de Charlotte Wolter en Messaline : www.wikigallery.org/wiki/painting_84833/Hans-Makart/Charlotte-Wolter-als-Messalina-Charlotte-Wolter-as-Messalina.)
L’entrée dans le journal de Cosima relatant cet événement est une liste éblouie de notables aristocratiques et culturels : des comtes et comtesses hongrois, les princes de Liechtenstein et de Metternich, « la famille Liszt », le peintre Heinrich von Angeli et sa femme, le poète-librettiste Salomon Mosenthal, ainsi que l’architecte Gottfried Semper. (Cette occasion avait été en partie organisée pour réunir Semper et Wagner, qui n’avaient pas échangé depuis que les plans pour un théâtre festival à Munich avaient été envisagés environ dix ans plus tôt.) Le quatuor Hellmesberger avait été invité à jouer Beethoven, mais le tumulte des invités costumés – sans parler du contenu même du studio – semble avoir couvert leurs efforts[52]. Parmi les invités se trouvait l’actrice Charlotte Wolter, une sorte de Sarah Bernhardt viennoise, proche de Makart et modèle occasionnelle. Apparemment, ce sont ses portraits dans des rôles de femme fatale, tels que Messaline et Cléopâtre, qui ont inspiré les Wagner à solliciter Makart pour concevoir des costumes pour Parsifal, avec Kundry en tête[53]. (La Fig. 11 présente une photographie de Wolter costumée en Messaline dans la pièce Arria und Messalina d’Adolph Wilbrandt, lors d’une séance de modélisation pour un portrait réalisé en 1875 ; voir également le portrait terminé de Charlotte Wolter en Messaline : www.wikigallery.org/wiki/painting_84833/Hans-Makart/Charlotte-Wolter-als-Messalina-Charlotte-Wolter-as-Messalina.)
 Bien sûr, la collaboration entre Wagner et Makart sur Parsifal ne s’est jamais concrétisée[54]. En dehors de deux dessins finalement abandonnés pour des rideaux peints destinés à embellir les scènes de la nouvelle Ringstrasse (un cadre inspiré de Le Songe d’une nuit d’été pour le Wiener Stadttheater et un motif de Bacchus et Ariane pour la Komische Oper), Makart ne travailla pas dans le théâtre durant sa brève et active carrière. Cependant, son style exerça une influence notable dans ce domaine. Par exemple, le décor de Paul von Joukowsky pour le « jardin magique » de Klingsor dans l’Acte 2 de Parsifal est un véritable festival de fougères, de feuilles de palmier et de fleurs en cascade, inspiré du style de Makart, qui a influencé de nombreux intérieurs bourgeois luxueux (voir Fig. 12).
Bien sûr, la collaboration entre Wagner et Makart sur Parsifal ne s’est jamais concrétisée[54]. En dehors de deux dessins finalement abandonnés pour des rideaux peints destinés à embellir les scènes de la nouvelle Ringstrasse (un cadre inspiré de Le Songe d’une nuit d’été pour le Wiener Stadttheater et un motif de Bacchus et Ariane pour la Komische Oper), Makart ne travailla pas dans le théâtre durant sa brève et active carrière. Cependant, son style exerça une influence notable dans ce domaine. Par exemple, le décor de Paul von Joukowsky pour le « jardin magique » de Klingsor dans l’Acte 2 de Parsifal est un véritable festival de fougères, de feuilles de palmier et de fleurs en cascade, inspiré du style de Makart, qui a influencé de nombreux intérieurs bourgeois luxueux (voir Fig. 12).
 Les riches tentures rouges et les robes des peintures historiques de Makart se retrouvent dans le travail de designers de décors italiens pour les scènes viennoises, comme celles de Francesco Rottanara pour le Raimundtheater ou de Carlo Brioschi pour la Hofoper. (La Fig. 13 montre un grand intérieur de style Renaissance pour Die Verschwörung des Fiesco zu Genuade Schiller, entièrement réalisé dans le style de Makart : les tentures volumineuses sont toutes en rouge.)
Les riches tentures rouges et les robes des peintures historiques de Makart se retrouvent dans le travail de designers de décors italiens pour les scènes viennoises, comme celles de Francesco Rottanara pour le Raimundtheater ou de Carlo Brioschi pour la Hofoper. (La Fig. 13 montre un grand intérieur de style Renaissance pour Die Verschwörung des Fiesco zu Genuade Schiller, entièrement réalisé dans le style de Makart : les tentures volumineuses sont toutes en rouge.)
Brioschi a conçu des décors somptueux et colorés pour les productions viennoises de Tristan et Tannhäuser à la Hofoper en 1883 et 1890, respectivement, combinant le style des décors de Munich des années 1860 de Quaglio et Döll avec des touches de Makart et les extravagances de pantomime féerique populaires de l’époque. Un mélange similaire est évident dans les productions de Bayreuth de Cosima Wagner à la fin du siècle, comme dans les décors du Venusberg de son Tannhäuser de 1891 (la Fig. 14 montre le tableau de « Léda et le Cygne » des derniers moments de la Bacchanale).
 L’appréciation de l’art visuel a indéniablement été un domaine privilégié pour Cosima tout au long de son mariage avec Richard Wagner, où elle a souvent joué le rôle de consultante en style dans divers domaines. Dès sa première rencontre avec l’œuvre de Makart, elle a partagé l’enthousiasme qu’elle suscitait chez de nombreux connaisseurs contemporains. Malgré une indignation initiale, Cosima a fini par comprendre mieux que quiconque les points communs entre les opéras de Wagner et « une peinture de Makart ».
L’appréciation de l’art visuel a indéniablement été un domaine privilégié pour Cosima tout au long de son mariage avec Richard Wagner, où elle a souvent joué le rôle de consultante en style dans divers domaines. Dès sa première rencontre avec l’œuvre de Makart, elle a partagé l’enthousiasme qu’elle suscitait chez de nombreux connaisseurs contemporains. Malgré une indignation initiale, Cosima a fini par comprendre mieux que quiconque les points communs entre les opéras de Wagner et « une peinture de Makart ».
Si le style de Makart a été si aisément intégré dans les travaux des collaborateurs et héritiers théâtraux de Wagner, sans oublier le décor du salon de Wahnfried, pourrait-il représenter un aspect essentiel du « style » de ses œuvres ? L’influence de la peinture de Makart pourrait-elle offrir un outil optico-critique pour nous aider à redécouvrir une perspective nouvelle sur le compositeur et ses drames ? Peut-on réintroduire certains éléments de manière productive dans les mises en scène de Wagner aujourd’hui ? Bien qu’il ne soit pas question ici d’engager des débats sur l’état actuel de la production wagnérienne, il est pertinent de conclure par un « oui » nuancé à ces interrogations.
Après un siècle et demi, il est facile d’oublier la nouveauté et la puissance des provocations sensuelles de Wagner, ainsi que le choc délicieux de ses surfaces vibrantes et l’étreinte luxueuse de ses textures riches et moelleuses. Comme l’a souligné Laurence Dreyfus, les publics contemporains ont tendance à négliger l’attrait sensuel, ouvertement érotique, que la musique de Wagner exerçait sur ses auditeurs à l’époque, une situation exacerbée par les tendances actuelles de la critique et de la production[55]. Parallèlement, les thèmes et les personnages de Wagner, tout comme ceux de Makart, étaient au moins génériquement familiers pour leur public ; ce qui était véritablement moderne, c’était la manière dont ces sujets étaient traités à travers un « style » propre à chaque médium. Wagner a puisé dans la mythologie nordique, la légende chrétienne médiévale et l’histoire allemande moderne précoce, les réinterprétant pour des sensibilités contemporaines – et même « futures » – tout comme Makart l’a fait avec la peinture historique de la Renaissance, l’allégorie, les portraits, la peinture dévotionnelle, ainsi que le décor baroque et rococo. Le succès des deux artistes repose en grande partie sur leur capacité à naviguer entre un « grand style » conventionnel et reconnaissable, d’une part, et les éléments distinctement modernes qu’ils y intégraient, d’autre part.
Une esthétique de production qui chercherait à réinventer cette négociation en des termes contemporains pourrait rendre davantage hommage aux couleurs et aux textures de l’imagination de Wagner, plutôt que de recourir à des costumes d’affaires froissés et à des meubles d’Office Dépôt ou d’IKEA, censés faire « résonner » Wagner à notre époque à travers le gouffre du temps[56]. Les productions modernistes et postmodernistes privilégient souvent le conceptuel au détriment du contenu sensuel des drames. Depuis l’ère de Wieland Wagner, et même avant, l’abstraction visuelle a été utilisée pour exorciser l’ombre de l’ostentation bourgeoise tardive et nationaliste, qui avait déjà mis Thomas Mann mal à l’aise en 1933. Certaines productions, comme les cycles du Ring de Joachim Herz ou de Patrice Chéreau dans les années 1970, ont choisi de mettre en avant des marqueurs de cette « ostentation » de manière critique, soulignant les parallèles entre le destin des dieux de Wagner et l’hybris chauviniste-impérialiste de la Gründerzeit allemande.
Il existe assurément des moyens de citer le style de Makart de manière créative et critique, sans tomber dans une pittoresque anachronique, comme celles dont les productions du Met d’Otto Schenk et de Günther Schneider-Siemssen ont souvent été accusées. Par exemple, dans le Rheingold du cycle du Ring de Keith Warner (2004-2006, relancé en 2012), qui s’inspire des travaux de Herz et Chéreau, la robe blanche à volants de Marie-Jeanne Lecca et la coiffure rouge titien de Fricka évoquent clairement le style makartien. La grotte de Vénus et le jardin de fleurs de Kundry sont des candidates évidentes pour ce traitement. On pourrait également envisager la chambre nuptiale de Lohengrin et Elsa, ornée de fourrures et de vases, ou la salle du concours de chant à la Wartburg comme un conservatoire de style Makart. La salle des Gibichungen pourrait être conçue comme un grand salon, agrémenté d’armures et de tapis orientaux superposés, tandis que le laboratoire de Klingsor pourrait ressembler à l’atelier de Makart. Ce style pourrait suggérer une atmosphère à la fois inquiétante, décadente et séduisante, parfaitement adaptée à de nombreux décors wagnériens. (Thomas Mann a illustré cela en faisant s’effondrer ses jumeaux Aarenhold, avatars décadents bourgeois de Siegmund et Sieglinde, sur un tapis en peau d’ours à la fin de l’histoire Wälsungenblut.[57]) Cela pourrait résonner visuellement avec la réponse de Sachs au ton « wagnérien » agréablement troublant de la musique de Walther, qui semble à la fois « si ancien » et pourtant « si nouveau ». Quel que soit l’objectif interprétatif que nous pourrions lui attribuer, le style de Makart pourrait être évoqué en contrepoint à la musique de Wagner, permettant de récupérer des caractéristiques autrefois centrales à son irrésistible fascination, des caractéristiques que nous risquons aujourd’hui d’oublier, de réprimer ou de considérer comme acquises.
Notes :
[1] Katalog des kunstlerischen Nachlasses und der Kunst-und Antiquitaten-Sammlung von Hans Makart, publié par le tuteur des enfants de Makart, A. Streit » (Vienne, 1885).
[2] Journal de Cosima Wagner, vol. 1, éd. Dieter Mack et Martin Gregor-Dellin, trad. Geoffrey Skelton, 2 vol. (New York, 1977), vol. 1, 828 (entrée du 22 février 1875) : « Visites avec R. ; au studio étonnant de Makart, un sublime débarras [Rumpelkammer]. » Selon une source, Cosima avait alors envisagé un temps d’y organiser la réception de mariage pour l’une de ses filles. Voir Emil Pirchan, Hans Makart (Vienne, 1954), 39. Deux représentations peintes du studio de Makart, réalisées durant les dernières années de sa carrière par Rudolf Alt (1885) et Eduard Charlemont (1885), peuvent être trouvées ici : www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=15170&size=large www.wikigallery.org/wiki/painting_96810/Eduard-Charlemont/Hans-Makart-in-seinem- Atelier-( Hans-Makart-in-his-Atelier)
[3] Klaus Gallwitz, ‘Nach uns die Sintflut’, essai introductif au catalogue de l’exposition Makart : Triumph einer schönen Epoche, Staatliche Kunsthalle Baden Baden, éd. Klaus Gallwitz (Baden-Baden, Stuttgart et Bad Cannstatt, 1972), 5
[4] Robert Stiassny, Hans Makart und seine bleibende Bedeutung (Leipzig, 1886), 12–14.
[5] Carl von Vincenti, ‘Hans Makart’, dans Wiener Kunst-Renaissance : Studien und Charakteristiken (Vienne, 1876), 222–224. Les « brûleurs de soleil » (Sonnenbrenner) étaient des lampes à gaz à jets multiples, amplifiées par une série de miroirs, fournissant une illumination forte et bien ventilée pour de grandes salles ou pièces. Eva Mongi-Vollmer discute du studio de Makart comme un paradigme du rôle du studio en tant qu’espace discursif étroitement identifié à la personnalité et au style de l’artiste à la fin du XIXe siècle dans Das Atelier des Malers : Die Diskurse eines Raumes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Berlin, 2004), 51–87.
[6] Thomas Mann, « Les Peines et la Grandeur de Richard Wagner », dans Thomas Mann Pro et Contra Wagner, trad. Allan Blunden (Chicago et Londres, 1985), 135. « [E]t nous savons avec certitude », ajoute Mann, pas tout à fait correctement, « qu’il avait prévu de commander à Makart de peindre quelques décors pour lui ». Makart a été approché (probablement par Cosima) pour concevoir des costumes pour le premier Parsifal, bien qu’il existe des preuves que Makart a été considéré comme un candidat pour concevoir le cycle de L’Anneau original à Bayreuth (voir note 19 ci-dessous).
[7] Cf. Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, traduction J. Bradford Robinson (Berkeley and Los Angeles, 1989) 263.
[8] Mann, Les Peines et la Grandeur de Richard Wagner, 92
[9] Ibid., 135.
[10] bid., 137.
[11] Mann, Réflexions d’un homme apolitique, dans Thomas Mann Pro et Contra Wagner, 59
[12] La corrélation entre l’apparence influente du studio de Makart et les tendances en matière de design d’intérieur domestique plus généralement peut être évaluée à partir de l’étude abondamment illustrée de Stefan Muthesius, The Poetic Home: Designing the 19th-Century Domestic Interior (Londres, 2009). La trajectoire plus large du goût à laquelle Makart a contribué de manière significative, comme le décrit Muthesius, passe d’un idéal de « retenue et simplicité » bourgeoises dans les décennies Biedermeier ou Régence au début du siècle à un affichage somptueux, quasi-aristocratique, avec de nombreuses citations d’éléments antiques et exotiques, suivant l’essor général de l’affluence de la classe moyenne. Voir, par exemple, l’introduction, Modernité, Anti-modernité, Confort et Décor depuis 1800, 15–25 (en particulier 23).
[13] Eugène Müntz, « Exposition internationale de Munich », Gazette des beaux-arts 11:2 (juillet-décembre 1869), 321. « M. Mackart [sic] est le Richard Wagner (d’autres disent l’Offenbach) de la peinture allemande. » Cette comparaison alternative avec Offenbach, aussi ironique qu’elle puisse paraître, trouve un écho dans l’essai de 1871 de Wilhelm Lübke qui établit un parallèle entre Wagner et Makart (voir note 14 ci-dessous). Müntz n’apporte pas d’autres précisions sur la comparaison avec Wagner, se contentant de mentionner les réactions critiques controversées suscitées par le jeune artiste. Ses commentaires sur les Moderne Amoretten (désignés comme « Esquisse pour la décoration d’une pièce », l’une des deux versions exposées) anticipent une variété de thèmes qui deviendront standards dans la réception de Makart. L’artiste manque de compétences appropriées dans le dessin de « grandes figures », présentant des parties du corps (« torses, bras et jambes ») dans un désordre confus ; la disposition des images variées sur les trois panneaux témoigne d’une « compréhension remarquable des lois de la décoration » ; son application saisissante des couleurs et des textures suscite un enthousiasme manifeste, bien que le résultat final soit jugé « malsain et immoral ». « Le ton du fond doré dont les figures se détachent, les teintes brunes des roseaux et des fleurs » (l’effet signature des fleurs séchées) « et les nuances alternativement rouges et blanches de la chair créent une harmonie merveilleuse, d’une richesse stupéfiante et d’un charme véritablement musical ; la composition exhale la poésie de l’automne et des feuilles mortes » (321).
[14] Hans Makart et Richard Wagner’, dans Das neue Reich 1:2 (1871), 17. Les deux artistes, remarque-t-il, parviennent à attirer l’attention du public même alors que des « événements d’importance mondiale » se déroulent (en faisant allusion à la récente guerre franco-prussienne et à la fondation du Reich allemand).
[15] Ibid., 17.
[16] Ibid., 20.
[17] Ibid., 21. « Qu’est-ce que ce ‘‘idéalisme souverain de la couleur’’ sinon un terrorisme virtuel du pinceau ? » rétorque-t-il.
[18] Ibid., 21–2.
[19] Dans son entrée de Journal du 21 avril 1878, Cosima Wagner note : « Au déjeuner, l’ami [Hans] Richter… m’apporte la bonne nouvelle que Makart souhaite réaliser les esquisses des costumes et les apporter ici à temps pour le 22 » (c’est-à-dire le 22 mai, l’anniversaire de Richard). Le Journal de Cosima Wagner, vol. 2, 64. Ni les costumes ni la visite ne se sont concrétisés, et rien d’autre n’est dit sur la commande. Nous savons que Cosima a également contacté le peintre Arnold Böcklin et l’architecte Camillo Sitte concernant d’éventuels décors pour Parsifal, ce qui suggère un intérêt relativement inhabituel à l’époque pour l’utilisation des talents d’artistes innovants plutôt que de peintres de scène professionnels. Voir Patrick Carnegy, Wagner and the Art of the Theatre (New Haven et Londres, 2006), 78–79. Une lettre de Cosima Wagner à Franz von Lenbach (26 décembre 1873) suggère que les Wagner avaient initialement pensé à approcher Makart pour des décors pour le Ring de Bayreuth original. Voir Detta et Michael Petzet, Die Richard Wagner-Bühne König Ludwigs II (Munich, 1970), 229.
[20] Journal de Cosima Wagner, vol. 1, 269 (entrée du 26 mai 1871). Le préjugé de Cosima fut rapidement abandonné lors de sa première rencontre réelle avec son œuvre. La paire de grandes allégories décoratives intitulées Abundantia (mentionnée ci-dessus) fut exposée à Bayreuth durant l’été 1873 dans le cadre d’une vaste tournée européenne. « Abundantia de Makart… me ravit véritablement ; plaisir de voir qu’un Allemand est désormais si original dans sa conception et si audacieux dans son exécution, aucune imitation d’un modèle connu à déceler » (ibid., 653 ; entrée du 3 juillet 1873). Cosima savait que cette paire de tableaux avait été conçue pour la salle à manger d’un riche magnat hongrois (« ce qui explique sa coloration serbe, turque et grecque moderne ») ; peut-être le fait qu’elle et Richard étaient sur le point d’emménager dans leur nouvelle villa « Wahnfried » n’était-il pas sans influence sur sa réaction. « Le tableau m’intéresse tellement que je rentre chez moi et persuade R. de laisser de côté ses corrections du 9e volume [de ses Gesammelte Schriften] pour venir le voir. Il partage mes sentiments. »
[21] Un essai de Katharina Lovecky dans le catalogue d’une récente exposition des œuvres de Makart au Belvédère à Vienne (9 juin – 9 octobre 2011) examine le trope critique de la comparaison entre Makart et Wagner, principalement du point de vue des tableaux tardifs des Nibelungen, ainsi que de l’iconographie wagnérienne que Makart aurait connue à travers des productions à Munich, Vienne et le premier festival de Bayreuth. Elle discute également des liens entre Makart, Wagner et l’architecte Gottfried Semper en ce qui concerne des esquisses tardives à l’huile et à l’encre pour des façades architecturales monumentales dans la collection du Belvédère. Bien que le cycle tardif des Nibelungen de Makart place les corps de ses sujets dans un cadre mythique largement abstrait, Lovecky conclut que l’opulence plus typique du style de l’artiste ne correspondait pas aux idéaux de design théâtral de Wagner (que ce soit pour des bâtiments ou des décors de scène), ce qui pourrait expliquer pourquoi les projets de collaboration pour les festivals de Bayreuth ne se sont jamais concrétisés. Lovecky, « Hans Makart : Le Wagner de la peinture ? » dans Makart : Peintre des sens, éd. Agnes Husslein-Arco et Alexander Klee (Munich, 2011), 181–95 et 197–209 (planches 74–84).
[22] Renata Kassal-Mikula dans Hans Makart, Malerfürst, catalogue de l’exposition au Historisches Museum der Stadt Wien, 14 octobre 2000 – 4 mars 2001 (Vienne, 2000), 96. »
[23] Robert Stiassny, Hans Makart und seine bleibende Bedeutung, 6.
[24] « Ce qui chez Makart est la couleur absolue, chez Wagner est l’orchestre souverain. » Lübke, Hans Makart et Richard Wagner, 21. La phrase concernant l’ « orchestre souverain » de Wagner fait allusion à la citation désinvolte de Lübke d’un critique berlinois sur l’« idéalisme souverain de la couleur » de Makart (ibid., 18, 20).
[25] Ibid., 21-22. Stiassny a ensuite écrit que « les images de Makart sont toutes chair mais sans os, tout comme ses figures sont toutes couleur sans dessin ». Stiassny, Hans Makart und seine bleibende Bedeutung, 7
[26] « Hans Makart » (nécrologie anonyme), Neue freie Presse, samedi 4 octobre 1884, 5. L’auteur utilise explicitement un langage de domination sexuelle, voire d’agression, en se référant à la subordination du dessin à la couleur comme à une Vergewaltigung. Le thème est développé avec une emphase similaire dans l’épisode suivant, où il analyse la catégorie ambiguë de « coloriste ». Le « colorisme » de Makart n’était pas une question de nuances subtiles, mais de virtuosité et d’extravagance : « il aimait la couleur pour elle-même, et elle devait être vive, pleine et bruyante » (« hell, volltönend, geräuschvoll musste sie sein »). Neue freie Presse, dimanche 5 octobre 1884, 1.
[27] « Dans [les couleurs de Makart], il y avait un mouvement constant de teintes chatoyantes, de flammes vacillantes, une qualité incessante de crépitement, de bouillonnement et de lueur. » Ludwig Hevesi, Hans Makart und die Sezession (14 juin 1900), réimprimé dans Acht Jahre Secession (Vienne, 1906) et cité ici d’après Renata Kassal-Mikula, éd., Hans Makart, Malerfürst, 16-17. En évoquant le « feu magique » des couleurs de Makart, Hevesi poursuit avec des métaphores de fluidité et de dynamisme quasi-musical : « À travers tout son univers coulait un unique et uniforme courant de coloris, comme une passion visible, comme une sensation de plaisir optique. Et tout ce qui se plongeait dans ce courant prenait une couleur, une couleur extrêmement multicolore, la couleur de Makart. En elle, il y avait un incessant va-et-vient de scintillements, un vacillement de flammes, un crépitement, un bouillonnement et une lueur sans fin. Ce monde bouillonnant et fermentant de visibilité, il le percevait selon son propre instinct, comme un instinct coloré autonome. »
[28] Kassal-Mikula, Hans Makart, Malerfürst, 17.
[29] Eduard Hanslick, Musikalische Stationen (Die moderne Oper, vol. 2) (Berlin, 1885), 249. Robert Hamerling (à l’origine Rupert Hammerling), poète et écrivain autrichien, 1830-1889. Ses œuvres incluent le poème en cinq chants (ottava rima), Venus im Exil (1858) et une collection de cinquante-cinq poèmes dans la strophe des ‘Nibelungen’, Ein Schwanenlied der Romantik (1860). Son œuvre la plus connue était un poème en six chants, Ahasver in Rom (‘Ahasverus à Rome’), décrivant, entre autres, le ‘Juif errant’ de la légende médiévale comme témoin de la Rome de Néron. Ce poème a pu servir de référence littéraire pour le triptyque insaisissable de Makart, Die Pest in Florenz (‘La Peste à Florence’), également appelé Die sieben Todsünden (‘Les Sept Péchés capitaux’) ; voir ci-dessous, ‘Bacchanales modernes’.
[30] Sur ces dimensions technologiques du théâtre de Bayreuth en tant que fait et en tant que figure interprétative, voir Gundula Kreuzer, ‘Wagner-Dampf : la vapeur dans Der Ring des Nibelungen et la production opératique’, The Opera Quarterly 27:2-3 (printemps-été 2011), 179-218.
[31] Vienna: Alfred Hölder (Beck’sche Universitats-Buchhandlung).
[32] Une riposte pro-wagnérienne à l’essai de Lübke de 1871, publié dans le nouveau Musikalisches Wochenblatt, favorable à Wagner, posait essentiellement la même question, répétant des querelles méthodologiques familières sur la comparaison d’œuvres ou d’artistes dans différents médiums, bien qu’avec peu d’efforts pour explorer le potentiel d’une telle comparaison ou ce qui, dans ce cas, aurait pu la susciter. Carl Slevogt, « Gegen W. Lübke’s ‘Hans Makart und Richard Wagner’ », Musikalisches Wochenblatt 2:39 (22 septembre 1871), 612–14. L’auteur, un avocat, économiste et homme politique thuringeois, n’était apparemment pas lié à l’artiste Max Slevogt (né en 1868).
[33] Nikolaus Schaffer, ‘Das grosse Liebesspiel: Ein Versuch über Hans Makart, unter besonderer Berücksichtigung seiner Kritiker’, in Hans Makart (1840–1884), ed. Erich Marx and Peter Laub (Salzburg, 2007), 65.
[34] Lübke, Hans Makart und Richard Wagner, 19. Il est révélateur, en ce qui concerne la réception controversée de Makart, que le critique berlinois non nommé cité par Lübke défendait précisément ces qualités « irréelles » comme quelque chose de nouveau et d’intéressant dans l’œuvre.
[35] Ibid., 18.
[36] Karl Landsteiner, Hans Makart und Robert Hamerling : Zwei Repräsentanten moderner Kunst (Vienne, 1873), 10–11. Le premier chant de l’Ahasver in Rom de Hamerling, publié en 1865 et parfois suggéré comme une source d’actualité pour la série La Peste à Florence (ou Les Sept péchés capitaux), comprend une description suggestive d’une danse exécutée par une fille sombre et mélancolique, semblable à Mignon, « à moitié manade, à moitié encore enfant ». Hamerling, Ahasver in Rom, 11e éd., (Hambourg, 1875), 25.
[37] Comme l’avance Nikolaus Schaffer : « Dans les Moderne Amoretten, Makart exprime de manière exemplaire une attitude caractéristique oscillant entre la soif de vivre et le pessimisme, bien qu’opposée à la résignation ; avec Makart, l’imagerie ne poursuit aucun programme concret, mais seulement une philosophie de la vie transformée en peinture ». Schaffer, Versuch über Makart, 95.
[38] « Une telle libération sans frein des désirs, comme elle se produit ici dans les évolutions de masse de couples amoureux grimaçants et gémissants, pourrait même aller trop loin pour le goût le plus libéral. Elle est tout simplement inesthétique. » Eduard Hanslick, ‘Hofoperntheater : ‘‘Tannhäuser’’ de Richard Wagner’, Neue freie Presse, 24 novembre 1875, 1.
[39] « Il aurait vraiment suffi des courtiers humains, parmi lesquels nous ne serions que peu enclins à compter les quatre faunes au premier plan qui dansent le cancan avec des pieds de bouc. » Ibid.
[40] Sur l’érotisme musical-sémiotique du Venusberg, voir également Laurence Dreyfus, Wagner and the Erotic Impulse (Cambridge, MA, 2010), 84–92.
[41] Lübke, Hans Makart und Richard Wagner, 17.
[42] Voir, par exemple, Stiassny, Hans Makart und seine bleibende Bedeutung, 7 : « il ne faut pas longtemps pour comprendre que toutes ses images n’ont que de la chair et pas d’os, tout comme ses figures n’ont que de la couleur et pas de dessin. » L’historien de l’art Richard Muther (peut-être en paraphrasant directement Stiassny) a fait le même commentaire dans un chapitre sur la Révolution des coloristes allemands dans son Histoire de la peinture moderne : « On entend le froissement de la soie et du satin, et le crépitement des robes coûteuses en brocart, on voit les tentures en velours s’affaisser en lourdes plis, mais les figures qui existent au milieu ne sont que des corps et non des âmes, de la chair et pas d’os, de la couleur et pas de dessin. » Muther, The History of Modern Painting, trad. Ernest Dowson, George Arthur Greene et Arthur Cecil Hillier (Londres, 1895), 492. (L’édition originale en allemand a été publiée en 3 volumes en 1893.)
[43] « Le contenu représentatif », ajoute Pirchan, « pâlit en signification face à la fanfare furieuse des couleurs, dans laquelle les formes semblent se dissoudre. » Emil Pirchan, Hans Makart: Leben, Werk und Zeit (Vienne et Leipzig, 1942), 27. La monographie de Pirchan a été réimprimée avec quelques modifications en 1954 (Vienne). Brigitte Heinzl note comment cette caractéristique de « liberté par rapport au contenu figural ou narratif » chez Makart anticipe une tendance similaire chez les peintres de la Sécession, ainsi que son intérêt pour l’intégration de sa peinture dans des espaces architecturaux de manière non conventionnelle. Heinzl, éd., Hans Makart: Zeichnungen, Entwürfe (catalogue d’exposition, Salzburg Museum Carolino Augusteum, 8 juin–23 septembre 1984 ; Museum Jahresschrift vol. 29–30), 26.
[44] Friedrich Pecht (1814–1903) cité dans Landsteiner, Hans Makart und Robert Hamerling, 12. La préface de l’essai de Landsteiner (3–6) réfléchit au phénomène de la « modernité » esthétique en général tel qu’il était perçu vers 1870.
[45] Landsteiner, Hans Makart and Robert Hamerling, 12.
[46] Wagner répondait au critique W.H. Riehl dans le court essai « Über die Benennung ‘‘Musikdrama’’ », Gesammelte Schriften und Dichtungen vol. 9 (Leipzig et Berlin, 1887), 307. Plus précisément, Wagner admet qu’au lieu du spectacle opératique ordinaire, « il ne se passe presque rien d’autre que de la musique » dans l’Acte 2 de Tristan, et que cela « semble être tellement de la musique que des personnes de la constitution de Herr Riehl perdent l’audition ».
[47] Voir les Journaux de Cosima Wagner, vol. 1, 484 (entrée du 9 mai 1872) : « R. et moi avec la comtesse Dönhoff chez Makart ; avons vu le grand tableau de Caterina Cornaro ; grand talent, mais tout est influencé par des images, pas d’impressions vivantes ! Mais un talent exceptionnel. »
[48] Cité dans Pirchan, Hans Makart, 28.
[49] La nécrologie de Makart dans la Neue freie Presse, qui souligne dans son ensemble la contribution de l’artiste à l’identité culturelle de Vienne, met en avant cet aspect du défilé de 1879 : « Ce défilé est le plus beau tableau de Makart, et Vienne, seule Vienne a vu ce tableau. Que nous reste-t-il de ce tableau ? Un souvenir lumineux, quelques gravures et impressions en couleur, rien de plus. » Neue freie Presse, dimanche 5 octobre 1884, 2.
[50] Stiassny, Hans Makart und seine bleibende Bedeutung, 25.
[51] Cosima Wagner, Journal, vol. 1, 653 (3 Juillet 1873).
[52] Cf. Ernest Newman, La Vie de Richard Wagner, vol. 4 (New York, 1946), Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner : Sa Vie, Son Œuvre, Son Siècle (Munich, 1980) et Curt von Westernhagen, Wagner : Une Biographie, trad. Mary Whittall (Cambridge, 1978). Westernhagen inclut les détails concernant la performance des Hellmesberger de la 131e de Beethoven (tirés en partie de la biographie de Cosima par Max Milenkovich-Morold, publiée en 1937).
[53] Richard et Cosima ont également assisté à Vienne à la pièce qui mettait en vedette Charlotte Wolter dans le rôle de la débauchée impératrice romaine Messalina (Arria und Messalina, de l’érudit, journaliste, romancier et dramaturge Adolf von Wilbrandt, 1837–1911). Cosima rejette typiquement la pièce en la qualifiant de ‘triste œuvre de plagiat, interprétée par des acteurs sans aucun talent’ (sans mentionner Wolter par son nom) ; ‘elle est rentrée chez elle en se sentant nauséeuse’. Journal de Cosima Wagner, vol. 1, 877 (26 novembre 1875).
[54] Arnold Böcklin, Rudolf Seitz et l’architecte Camillo Sitte ont également décliné les invitations de Cosima à participer à la conception du Parsifal de 1882. Voir Patrick Carnegy, Richard Wagner et l’Art du Théâtre (New Haven et Londres, 2006), 109–10. Les commentaires de Carnegy sur Makart reflètent une perception erronée courante de l’artiste en tant que peintre académique conventionnel : « À bien des égards, Makart, le peintre monumental viennois, aurait été un « choix naturel » et aurait sans aucun doute pu fournir ce que la plupart du public bourgeois du théâtre aurait considéré comme approprié. Mais il valait mieux qu’il ne perde pas son temps, car Wagner avait déjà tourné le dos à tout ce qui n’était pas une réalisation non monumentale de sa vision insubstantielle »’, 110
[55] Laurence Dreyfus, Wagner and the Erotic Impulse.
[56] Le Tristan und Isolde de David Hockney, créé à Los Angeles en 1987 (relancé en 1997 et 2008), pourrait indiquer cette direction, du moins en ce qui concerne la ‘couleur’ et la fantaisie ; bien qu’optant pour une ‘texture’ moderne et épurée (dégagée), il offrait des couleurs vives rappelant les illustrations de contes, semblables aux designs viennois de Brioschi de 1883. Les projections générées par vidéo et graphismes informatiques, comme dans le ‘projet’ de Tristan de Bill Viola, le cycle du Ring de Valence de 2009 (où une surabondance d’images vidéo rivalise d’attention avec la troupe de performance Fura dels Baus), ou le cycle du Ringde Robert Lepage pour le Met, bien que quelque peu malchanceux, suggèrent tous un désir d’amplifier le stimulus visuel des productions wagnériennes de nouvelles manières.
[57] Le tapis, tout comme le reste de l’ambiance domestique luxueuse de la maison Aarenhold, avait un modèle immédiat dans l’opulente demeure d’Arcisstrasse des riches beaux-parents de Mann, la famille d’Alfred Pringsheim. Comme Mann le savait bien, cet aspect devait beaucoup à la domination du ‘style Makart’ en tant que paradigme décoratif au moment où les Pringsheim ont acquis leur villa en 1889. (L’art présent dans la maison Pringsheim, cependant, était celui du plus contemporain Hans Thoma.) Voir Hanno-Walter Kruft, ‘Alfred Pringsheim, Hans Thoma, Thomas Mann : Une constellation munichoise’, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Classe philosophique et historique : Abhandlungen, vol. 107 (Munich, 1993). (Je remercie Laurence Dreyfus pour cette référence.)