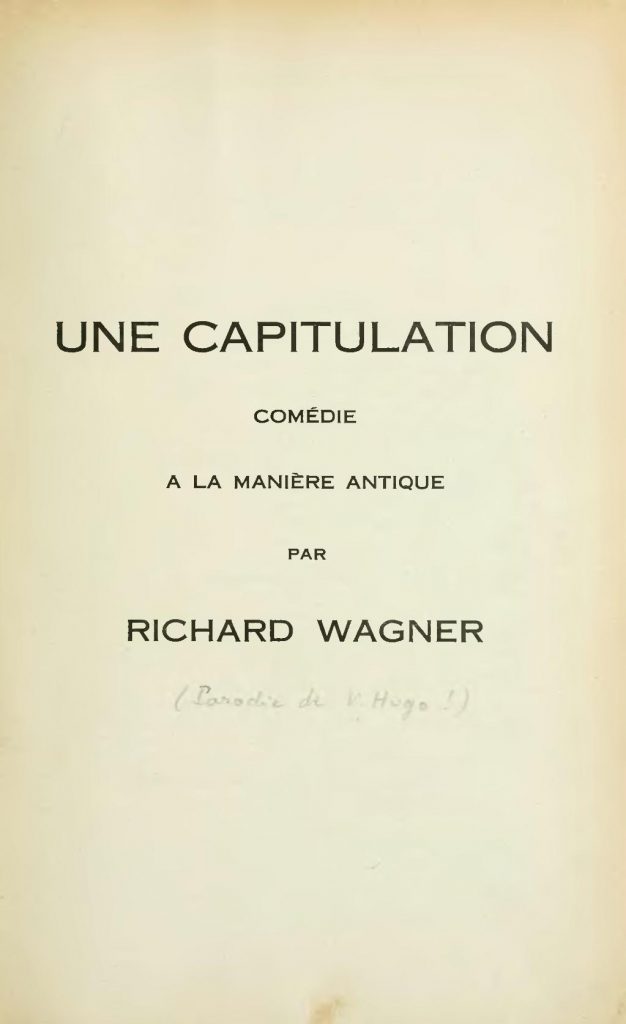Verdi et le nationalisme italien
 Tout amateur d’opéra sait que Giuseppe Verdi fut un nationaliste italien résolu et actif, précisément à l’époque où s’élaborait l’unité de l’Italie, en particulier contre la puissance autrichienne au Nord.
Tout amateur d’opéra sait que Giuseppe Verdi fut un nationaliste italien résolu et actif, précisément à l’époque où s’élaborait l’unité de l’Italie, en particulier contre la puissance autrichienne au Nord.
Fait curieux, il naît à Busseto, dans la province de Parme, qui appartenait alors à la France, après l’annexion du nord de l’Italie par Napoléon. Il fut un acteur engagé de la vie politique de son pays. Nombreuses sont les mélodies de ses opéras qui furent utilisées comme hymnes par les patriotes italiens partisans de l’unification et opposés à la présence autrichienne en Italie, ce qui lui valut de sérieux problèmes avec la censure.
Lors de la Deuxième guerre d’indépendance italienne, les Autrichiens commencèrent à évacuer la Lombardie, tout en conservant le contrôle de la région de Venise aux termes de l’armistice signé à Villafranca di Verona.
Verdi était mécontent de ce résultat :
« Où est donc l’indépendance de l’Italie, tant attendue et tant promise ?… Venise n’est-elle pas italienne ? Après tant de victoires, à quel résultat aboutissons-nous ?… De quoi rendre fou… », écrivait-il dans une lettre à Clara Maffei.
Il est bien connu que, dans sa troisième œuvre lyrique, Nabucco — qui le rendit célèbre en 1842 —, le public italien établit un parallèle entre l’histoire du peuple juif à Babylone et la situation d’oppression et de captivité que connaissait alors le pays transalpin sous la domination autrichienne, le chœur des prisonniers devenant un véritable hymne du nationalisme italien.
Il est également connu — quoique peut-être un peu moins — que le cri VIVA VERDI signifiait en réalité Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia, et qu’il servit à désigner, en son temps, le roi appelé à gouverner une Italie libre et unifiée.
Cependant, rien de tout cela n’a jamais conduit les Autrichiens à nourrir une hostilité particulière envers le nom de Verdi ou envers Nabucco ; ils acceptent parfaitement le nationalisme italien du compositeur et son opposition, alors, à l’Autriche.
Ce cas n’est nullement isolé : de nombreux musiciens romantiques ont défendu des positions nationalistes — contre la Russie, notamment, chez plusieurs auteurs polonais — sans que subsistent aujourd’hui le moindre écho politique négatif.
Mais, fait singulier, encore à l’époque actuelle, certaines œuvres et certaines lettres de Wagner relatives au nationalisme allemand, dans le contexte du processus d’unification, continuent de heurter des sensibilités françaises, comme si Wagner n’avait pas eu le même droit que Verdi d’être un ardent nationaliste — allemand, en l’occurrence — durant la guerre franco-prussienne, laquelle fut précisément le déclencheur de l’unité allemande.
Wagner et la France avant 1870
 En réalité, les relations de Wagner avec la France furent excellentes, même s’il connut à Paris des périodes de faim et de misère — précisément parce qu’il y cherchait la consécration.
En réalité, les relations de Wagner avec la France furent excellentes, même s’il connut à Paris des périodes de faim et de misère — précisément parce qu’il y cherchait la consécration.
Il compta parmi ses plus fidèles amis wagnériens des figures françaises majeures : Edouard Dujardin, Catulle Mendès, Judith Gautier, Édouard Schuré, Villiers de l’Isle-Adam, Baudelaire, pour ne citer que ces quelques noms.
Plus encore : la participation de Wagner à l’insurrection de 1848 à Dresde — certes davantage culturelle que politique, mais néanmoins active — découle directement des événements français.
La Révolution française de 1848 fut une insurrection populaire survenue à Paris en février, qui força l’abdication du roi Louis-Philippe Ier et ouvrit la voie à ce que l’on appela la Deuxième République française. Ce processus eut un retentissement considérable dans d’autres pays européens — Autriche, Hongrie, Allemagne, Italie — où éclatèrent toute une série de soulèvements populaires à la fois nationalistes et anti-absolutistes, parmi lesquels celui de Dresde, qui échoua.
Dans les faits, la IIᵉ République française — présidée par Louis-Napoléon — échoua elle aussi en 1852.
Le 7 novembre de cette même année, un nouveau plébiscite met fin à la République et instaure le Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé Napoléon III, Empereur des Français, le 2 décembre 1852, date choisie en référence à la fois au sacre de Napoléon Iᵉʳ et à la bataille d’Austerlitz.
Wagner n’eut jamais à se plaindre de Napoléon III, qui favorisa les arts. Et l’on sait que, sous les auspices de la princesse de Metternich, l’exécution de Tannhäuser fut obtenue à Paris, au Grand Théâtre Impérial, en 1861 ; et si ce fut un échec, ce ne fut certes pas la faute de Napoléon III — bien au contraire. La princesse était une proche amie et confidente d’Eugénie de Montijo, l’épouse de l’Empereur.
Il n’existait donc aucune forme d’hostilité de Wagner envers la France. Rappelons que Cosima était presque française, fille de la comtesse française d’Agoult et de Liszt.
Wagner et la guerre austro-prussienne, ou guerre des Sept Semaines
 Fait singulier : Wagner vécut une autre guerre, proche dans le temps, mais dont nous ne disposons que de très peu d’éléments quant à son influence sur les opinions du compositeur.
Fait singulier : Wagner vécut une autre guerre, proche dans le temps, mais dont nous ne disposons que de très peu d’éléments quant à son influence sur les opinions du compositeur.
Il s’agit d’un conflit survenu au sein de la Confédération germanique, entre le 14 juin et le 23 août 1866, opposant l’Empire d’Autriche à la Prusse, et dont cette dernière sortit victorieuse.
À la suite d’un conflit antérieur en 1864 (la guerre des Duchés), une situation tendue conduisit l’Autriche à déclarer la guerre au royaume de Prusse le 14 juin 1866. Dans ce conflit, la Bavière du roi Louis II se rangea aux côtés de l’Autriche.
Les troupes prussiennes remportèrent la victoire le 3 juillet à la bataille de Sadowa, grâce à la manœuvre du général Helmuth von Moltke.
Le 23 août 1866, le traité de paix de Prague mit fin au conflit et entraîna la dissolution de la Confédération germanique. La Prusse annexa Hanovre et Hesse-Cassel ; l’Autriche céda le Holstein à la Prusse, versa une indemnité de guerre et remit le Veneto au royaume d’Italie. La Prusse constitua alors la Confédération de l’Allemagne du Nord.
Cette Confédération établit des alliances avec la Bavière, le Wurtemberg et le grand-duché de Bade, qui s’engagèrent à placer leurs troupes sous le commandement du roi de Prusse en cas d’agression par un tiers contre l’un des membres.
Sur ce sujet, Wagner fut très certainement impliqué émotionnellement. En décembre 1865, il doit quitter Munich en raison des pressions exercées sur Louis II par les milieux politiques. Il se trouve donc en Suisse, à Tribschen, depuis mars 1866.
Il se retrouvait ainsi dans une situation paradoxale : “son” roi, dont il dépendait si cruellement, se trouvait opposé à la Prusse, tandis que “son” Allemagne en devenir avait besoin de la victoire prussienne, sous l’impulsion de Bismarck.
Louis II ne voulait pas la guerre, et encore moins celle-ci. Nous savons même qu’il confia à Wagner, le 15 juillet 1866, son intention d’abdiquer ; il ne passa toutefois pas à l’acte, Wagner l’en ayant dissuadé.
Cependant, nous ne disposons que de très peu d’informations sur Wagner durant cette période. Ma vie s’achève en 1864, et les Annales couvrant 1864 à 1868 ne consacrent que deux lignes à ce sujet.
Quant au Journal de Cosima, ils n’apportent aucune lumière pour cette date, puisqu’ils ne commencent qu’en 1869.
L’un des fondements du romantisme est le sentiment populaire — allemand, en l’occurrence — qui mène à un art national, un art du peuple allemand opposé aux divisions dynastiques et au jacobinisme républicain français. L’unité allemande constitue l’expression la plus haute de ce sentiment populaire qui anima profondément Wagner.
Bien que Wagner fût un ami proche de Louis II de Bavière, il ne cessa jamais de soutenir l’unité allemande sous direction prussienne, voyant en Bismarck le génie nécessaire à cette réalisation.
Rappelons que Bismarck provoquera la mise à l’écart de Louis II, qu’il qualifiera de fou, l’accusant de dilapider des fortunes dans ses châteaux et dans l’art romantique. Louis II lui répondit avec une remarquable clairvoyance qu’une seule des guerres de Bismarck avait coûté infiniment plus que l’ensemble de ses châteaux et de son mécénat artistique — et, de surcroît, sans entraîner la moindre mort.
Louis II était un roi romantique, anti-capitaliste, passionné d’art, mais politiquement peu armé face aux puissances de Vienne et de Berlin.
Wagner comprend que le grand roi Louis II a une mission : l’Art, non la politique. C’est dans l’Art que Louis II doit agir. Ainsi lit-on dans le Journal de Cosima, à la date du 22 juin 1869 :
« Richard me répète ce qu’il m’avait déjà dit à plusieurs reprises : le roi de Bavière est entièrement “démoniaque” ; il suffit d’examiner ce qu’il fait : il agit par instinct. Lorsqu’il tente de réfléchir, il se perd. Inconsciemment, son daimon lui révèle la conviction que, si notre chemin était demeuré commun, si lui avait exécuté mes projets avec une véritable audace, nous aurions été tous deux perdus irrémédiablement. Eu égard à la méchanceté et à la médiocrité des hommes, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour préserver mes œuvres dans ce monde… »
Le problème de l’unité allemande
 Comme nous l’avons vu, la Prusse avait constitué la Confédération de l’Allemagne du Nord, qui représentait une forme d’« Allemagne », mais seulement partielle : les États du Sud demeuraient indépendants (Louis II restait, par exemple, roi de Bavière), même si la Bavière, le Wurtemberg et le grand-duché de Bade avaient signé un traité de défense avec la Confédération du Nord en cas d’agression contre celle-ci.
Comme nous l’avons vu, la Prusse avait constitué la Confédération de l’Allemagne du Nord, qui représentait une forme d’« Allemagne », mais seulement partielle : les États du Sud demeuraient indépendants (Louis II restait, par exemple, roi de Bavière), même si la Bavière, le Wurtemberg et le grand-duché de Bade avaient signé un traité de défense avec la Confédération du Nord en cas d’agression contre celle-ci.
L’unité allemande n’était donc pas encore réalisée. De même qu’en Italie, l’unification était partie du Piémont mais devait encore intégrer Venise — encore autrichienne — et Rome — toujours sous souveraineté pontificale.
Pour constituer une Allemagne pleinement unie, il était indispensable que ces États du Sud rejoignent définitivement, et de leur plein gré, la Confédération de l’Allemagne du Nord.
Bismarck savait que cela ne serait possible que si la Prusse était attaquée par une puissance tierce : les États du Sud auraient alors l’obligation d’apporter leur soutien militaire, ce qui les unirait de fait.
En revanche, si la Prusse se montrait agressive la première, les États du Sud n’avaient aucune obligation d’intervenir.
Napoléon III voyait d’un mauvais œil l’ascension de la Prusse et la montée en puissance de la Confédération du Nord, mais il n’avait aucune intention de déclarer la guerre. Il se contentait de chercher, avec l’Autriche — encore irritée de sa défaite contre la Prusse — un accord de défense mutuelle en cas d’agression prussienne.
C’est alors qu’au sein de cette relative accalmie surgit un problème inattendu.
Le trône espagnol était vacant depuis 1868, à la suite d’une révolution : une insurrection militaire à composante civile survenue en septembre 1868, qui entraîna la déposition et l’exil de la reine Isabelle II de Bourbon, dont la corruption et la décadence avaient dépassé toute limite tolérable. L’idée était de fonder une nouvelle monarchie constitutionnelle.
Le général Prim dirigeait le gouvernement, et le 2 juillet 1870 il annonça qu’il proposait la couronne d’Espagne à Léopold de Hohenzollern, cousin éloigné du roi Guillaume de Prusse.
L’épouse de Napoléon III, d’origine espagnole, y était farouchement opposée, et Napoléon III davantage encore : il ne voulait pas voir deux couronnes d’origine allemande aux frontières de la France.
Ce point allait devenir le déclencheur de la guerre. Car, Léopold de Hohenzollern renonçant à la couronne, la diplomatie française exigea avec une insolence manifeste du roi de Prusse qu’il s’engage à ne jamais accepter à l’avenir un quelconque candidat allemand au trône d’Espagne. Le roi de Prusse était prêt à donner satisfaction, mais la grossièreté de l’ambassadeur français provoqua son renvoi sans audience. La presse, ensuite, fit le reste.
En Espagne, parallèlement, on institua une monarchie parlementaire : le règne d’Amédée de Savoie (1871–1873), puis une république, la Première République (1873–1874). Les deux expériences tournèrent au fiasco le plus complet, et les Bourbons revinrent sur le trône.
Guerre franco-prussienne : 19 juillet 1870 – février 1871
 Wagner se trouve alors à Tribschen, où il achève Siegfried. C’est précisément en juillet 1870 que se donnent à Munich les représentations de L’Or du Rhin et de La Walkyrie sans l’autorisation de Wagner.
Wagner se trouve alors à Tribschen, où il achève Siegfried. C’est précisément en juillet 1870 que se donnent à Munich les représentations de L’Or du Rhin et de La Walkyrie sans l’autorisation de Wagner.
Napoléon III avait des raisons de ne pas rejeter l’idée d’une guerre : il souhaitait mettre un terme au danger croissant que représentait une Allemagne toujours plus unie et plus puissante, et consolider son régime impérial après l’échec de son projet monarchique au Mexique.
Pour mesurer combien l’opinion n’était pas encore préoccupée par cette perspective, rappelons que la première mention négative de la France dans le Journal de Cosima — Wagner étant toujours à Tribschen, en Suisse — date seulement du 8 juillet 1870 (on n’était qu’à onze jours de la guerre). Avant cela, pas un mot hostile : au contraire, les journaux ne mentionnent que des visites d’amis français et l’estime portée à Napoléon III, qui avait fait représenter Tannhäuser à Paris.
Ce 8 juillet, Wagner évoque un « bruit de guerre » dû à l’idée qu’« un prince allemand devienne le prochain roi d’Espagne ». Il accuse les Français d’être irrités qu’on agisse sans les consulter. Rien de plus.
La veille, 7 juillet, il notait combien les Allemands imitaient la mode parisienne : tandis que les Françaises sont telles qu’elles sont, les Allemandes, elles, ne savent que les copier. Rien de négatif sur la France ni les Français, bien au contraire.
Le 16 juillet, Cosima juge la guerre imminente : on exige du prince de Hohenzollern non seulement qu’il renonce au trône d’Espagne, mais les méthodes brutales employées pour imposer cela amènent le roi de Prusse à refuser de recevoir l’ambassadeur de France.
Une lettre de Catulle Mendès arrive : il écrit qu’il ne peut se rendre à Tribschen dans ces circonstances.
Cosima note alors : « L’Europe va se jeter dans un bain de sang par la faute d’une bande d’imbéciles. »
Le peuple de Paris descend dans la rue en criant « À mort la Prusse ! », ce qui l’indigne profondément. Aucun mouvement équivalent n’apparaît en Allemagne à cette date.
Le 17 juillet, une lettre de Villiers de l’Isle-Adam se moquant des Prussiens met Wagner hors de lui : il refuse de le recevoir et affirme sa sympathie totale pour la Prusse. Wagner estime impossible de revoir ses amis français s’ils parlent de politique ou de guerre contre la Prusse.
Comme on le verra, les visites françaises auront tout de même lieu, mais en évitant soigneusement les sujets sensibles.
Le 18 juillet 1870, le divorce de Cosima est officiellement prononcé.
Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, persuadée de pouvoir la vaincre aisément et comptant sur l’appui de l’Autriche (humiliée par sa défaite de 1866). Ce soutien n’arrivera pas, principalement à cause de la question italienne.
Le 19 juillet, la guerre est officielle — même si l’information circulait depuis le 17. C’est bien la France qui la déclare, non la Prusse. Cosima se réjouit de voir la Bavière se ranger aux côtés de la Prusse. Elle craint en revanche que l’Autriche ne rejoigne la France, en raison de la défaite subie en 1866.
Malgré tout, Villiers, Mendès et Judith Gautier arrivent à Tribschen ; mais, écrit Cosima, « bien qu’ils soient aimables et charmants, la situation est pénible. Nous écoutons de la musique. »
Dans l’entrée du 24 juillet, les discussions s’enveniment avec les visiteurs français, qui se réjouissent de la possibilité d’une aide autrichienne à la France ; Wagner s’en indigne et « leur fait comprendre que nous serons contre les Français dans cette guerre ».
Le 28 juillet, on découvre les manœuvres françaises visant à attirer l’Autriche dans le conflit afin de reprendre la zone germanique perdue en 1866. En contrepartie, la France pourrait annexer la Belgique et envisage même de s’emparer d’une partie de la Suisse romande. Ceci a pour seul effet de pousser l’Angleterre et les Pays-Bas à refuser toute aide à la France, y compris matérielle — charbon, fournitures, etc.
Cosima est profondément préoccupée par cette situation.
Rappelons qu’en définitive, l’Autriche n’intervint pas, car elle posait comme condition un accord préalable avec les Italiens. Or, la France maintenait des troupes à Rome pour protéger le pape contre Garibaldi et les Italiens. Napoléon III refusa de les retirer — il tenait à conserver l’appui du pape et à maintenir son influence en Italie — et il refusa également de s’entendre avec les Italiens sur la présence autrichienne dans la péninsule. Ce refus finit de convaincre l’Autriche d’adopter la neutralité.
Le 30 juillet, les conversations avec Catulle Mendès et Villiers se poursuivent. Cosima note que tout se passe bien avec Catulle et que leurs relations demeurent excellentes ; en revanche, ce n’est pas le cas avec Villiers, qui se montre insultant envers les Allemands.
Après une quinzaine de jours, l’offensive française débute, le 2 août, contre la Sarre allemande. Elle est d’abord victorieuse, mais pour peu de temps : la prise de Sarrebruck inquiète vivement Wagner et Cosima, bien qu’elle ne dure que quelques jours.
Dans le Journal du 4 août, lorsque les Français occupent Sarrebruck, Cosima observe la supériorité des mitrailleuses françaises, dont les Allemands ne disposent pas. Elle appelle « Notre-Dame des mitrailleuses » l’image de Notre-Dame de Paris devant laquelle l’impératrice Eugénie de Montijo vient prier chaque jour.
Le pape soutient les Français et implore que leurs troupes ne l’abandonnent pas à Rome, où elles le protègent des Italiens de Garibaldi.
Mais en quelques jours, la situation bascule totalement.
Le 7 août, Cosima apprend la victoire allemande à Wörth : « Notre Siegfried trouvera un autre monde », dit-elle, songeant à la victoire et à l’unité allemande à venir.
Le 12 août, les Français, déjà battus, se replient sur Metz, immense place forte. Mais là, un vaste corps d’armée de 150 000 hommes se retrouve enfermé et encerclé. Ils ne pourront rien faire et capituleront le 28 octobre.
Le 13 août, les Allemands s’emparent de Strasbourg, capitale de l’Alsace. Dans son Journal, Cosima tient pour avérées les accusations de cruautés commises par les Turcos et les zouaves français contre des prisonniers allemands. Ces accusations étaient fondées, mais il existait aussi des témoignages inverses. Il est manifeste que Wagner et Cosima lisent quotidiennement des journaux suisses de tendances opposées, mais qu’ils ne croient que ceux d’orientation allemande.
Le 16 août, Napoléon III et le reste de l’armée française se replient sur Verdun, après la victoire allemande à Metz.
Wagner s’indigne de ce que 40 000 Allemands soient expulsés de Paris et abandonnés à leur sort dans les champs. On voit apparaître pour la première fois dans la presse l’idée d’un empereur d’Allemagne ; Wagner préférerait qu’on parle plutôt d’un « duc d’Allemagne ».
Même dans ce contexte de guerre, le 20 août, ils reçoivent une lettre de Judith Gautier annonçant qu’elle souhaite se rendre à Tribschen avec Catulle Mendès.
Cosima écrit dans son Journal que son père, Liszt, vénérait Mazzini, Louis-Napoléon et le pape. Or, Mazzini est alors arrêté en Italie et devra ensuite s’exiler à Londres ; Napoléon III est quasiment vaincu ; et le pape, privé des troupes françaises à Rome, voit la Ville éternelle intégrée à l’Italie par Garibaldi au cours de cette même année 1870, ce qui provoque sa profonde colère.
Une lettre de Marie Moukhanoff indique que Liszt est très abattu par la situation du pape et par la brutalité de la guerre.
Rappelons que Mazzini était républicain et opposé à la monarchie italienne que Garibaldi souhaitait instaurer. Arrêté en 1870 par la police italienne, accusé d’avoir fomenté une révolte en Sicile, il fut libéré par une amnistie en octobre de la même année, destinée à célébrer l’entrée des forces piémontaises à Rome. Désabusé, Mazzini partit alors volontairement pour Londres.
Le 24 août, Wagner s’indigne de voir combien les femmes allemandes cherchent à parler avec les officiers français prisonniers pour mieux apprendre le français. L’engouement pour la mode parisienne perdure, et Wagner s’en moquera plus tard dans son œuvre Une Capitulation.
Judith Gautier et Catulle Mendès écrivent pour annoncer qu’ils ne peuvent venir : s’ils quittaient Paris, ils seraient accusés de trahison ou de désertion.
Les défaites de Wörth, le 6 août, et l’impossibilité d’empêcher l’encerclement de Metz amènent les Français à se replier sur Sedan. Paradoxalement, le 25 août 1870, Wagner et Cosima se marient, sans pouvoir convoquer plusieurs invités en raison de la guerre.
Le 31 août, les Allemands commencent à encercler Sedan.
Le 1ᵉʳ septembre, Wagner reçoit une lettre de Nietzsche évoquant l’horreur des blessés.
Nietzsche s’était porté volontaire, mais ne fut accepté qu’au service sanitaire. Ses lettres à Wagner traitent surtout de l’épouvante ressentie devant les blessés, avec un ton pessimiste et accablé par la brutalité de la guerre. Wagner partage ce sentiment.
Le 2 septembre, Napoléon III demande la reddition de l’armée de Sedan, et l’Empereur lui-même devient prisonnier des Allemands.
Fait remarquable : la capitulation est signée le 3 septembre, jour du baptême de Fidi (Siegfried, le fils de Wagner et Cosima). Cosima considère cette coïncidence comme significative, croyant — à tort — que la reddition met fin à la guerre.
Dans le Journal du 4 septembre, Wagner pense composer une musique funèbre pour tous les morts, et non une œuvre de victoire : il serait incapable de se réjouir en composant alors que tant d’hommes ont péri.
Après Sedan, lorsque le roi de Prusse apparaît, on joue la « Prière de Lohengrin ».
Le 3 septembre, Paris apprend la reddition. Une grande insurrection éclate, ouvrant une période chaotique.
Jules Favre, député, réclame la fin de la dynastie napoléonienne. Adolphe Thiers propose la création d’un Comité de Défense nationale. Léon Gambetta demande la destitution de l’Empereur et proclame la République le jour même, devenant ministre de l’Intérieur.
Favre prend le portefeuille des Affaires étrangères. Le général Trochu devient président du gouvernement.
La déclaration de guerre est renouvelée et Paris se fortifie.
La princesse Metternich aide Eugénie de Montijo à fuir vers la Grande-Bretagne via la Belgique.
Cosima note : « tout cela nous est désormais indifférent », et estime que les proclamations parisiennes sont irrationnelles et illusoires.
Mais cette situation entraînera la prolongation de la guerre pendant encore cinq mois.
La capitulation stipule que l’Alsace et la Lorraine deviennent allemandes — elles l’avaient été auparavant. En réalité, le nom même d’Alsace provient du nom allemand de son principal fleuve, l’Elsass, et celui de Lorraine du roi Lothaire.
Ce point devient un sujet de vive polémique. Cosima et Wagner soutiennent le retour de ces régions à l’Allemagne.
Dans l’entrée du 12 septembre, Catulle Mendès leur écrit une lettre : il veut mourir sur les remparts de Paris en combattant. Il leur envoie la proclamation rédigée par Victor Hugo, déjà totalement déconnectée de la réalité.
Wagner lui répond : il ne doit pas mourir, et la faute en revient à la guerre.
La question alsacienne revient de manière récurrente : le 15 septembre, Cosima note que Wagner affirme que la Lorraine et l’Alsace ont toujours été allemandes.
Ce même jour, les Allemands se trouvent aux portes de Paris et, à partir du 20, l’encerclent totalement.
Moltke refuse toute bataille de rue ; il choisit d’affamer et d’épuiser la ville pour la réduire.
Dans le Journal du 26 septembre, il est indiqué qu’un poème publié dans la Gazette Illustrée laisse entendre que Wagner souhaiterait la victoire française. Wagner s’indigne : la presse ment toujours.
Jakoby, homme politique allemand d’origine juive, opposé à Bismarck et à l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine, prend la parole en public. Wagner note : « Nous savons que les Juifs se moquent de la constitution de l’Empire allemand et qu’ils veulent encourager le cosmopolitisme. »
Le 7 octobre survient un fait minime, mais qui deviendra l’élément déclencheur de la décision de Wagner d’écrire Une Capitulation : le voyage en ballon de Gambetta, quittant Paris pour Tours afin d’organiser la défense en constituant quatre nouvelles armées — du Nord, de la Loire, de l’Est et des Vosges (cette dernière sous le commandement de Garibaldi, arrivé d’Italie), qui regroupait une troupe hétéroclite de volontaires venus de nombreux pays, guérilleros portant des noms comme « Guerrilleros de la Mort » ou « Compagnie Vengeance », des troupes coloniales, et ne comptait qu’environ 4 000 hommes.
L’idée d’un « gouvernement dans les airs » que développera Wagner repose sur un double sens : il s’agit d’un ballon dans les airs, mais aussi d’un gouvernement « en l’air », c’est-à-dire sans aucune assise réelle permettant de croire à un succès.
Dans le Journal du 24 octobre, une lettre de Nietzsche, blessé, est rejetée. Nietzsche craint que, dans l’avenir, le militarisme et l’obscurantisme n’étouffent tout.
Wagner répond : « Je peux supporter les soldats, la police, la réduction du parlementarisme, mais non l’obscurantisme. La seule chose dont l’homme doive être fier est la liberté de l’esprit… »
Le 2 novembre, Cosima écrit un poème en mémoire des morts, qu’elle songe à lire à ses enfants.
Dans l’entrée du 6 novembre, la mère de Cosima, Marie d’Agoult, envoie une lettre demandant que l’Alsace soit conservée par la France. Cosima se sent allemande, non française comme sa mère.
C’est à cette date que Wagner commence à nourrir le projet d’écrire Une Capitulation :
« Richard dit que le gouvernement français actuel fournirait un excellent sujet de comédie à la manière d’Aristophane : un gouvernement qui est “dans les airs”, dans les deux sens du terme, pourrait inspirer de très belles trouvailles comiques. »
Il s’attelle aussitôt à la tâche. Ainsi, le 3 novembre, Cosima note dans son Journal :
« Richard m’appelle, il veut que je lise quelque chose. Il n’a cessé d’écrire une farce à la manière d’Aristophane, Une Capitulation. Richter devrait en composer la musique et l’œuvre devrait être représentée dans de petits théâtres. Richard était surtout préoccupé que cela puisse me contrarier ou m’inquiéter, car il a mis de côté son orchestration ; mais tout ce qui le réjouit et lui rend la bonne humeur me convient. »
Journal du 11 novembre : « Nous lisons dans la presse que, sur les murs de Paris, des affiches annoncent que la République a été proclamée à Munich, que la maison de Wagner aurait été pillée et que Wagner lui-même aurait été frappé. Ces absurdités amusent le public. Wagner travaille avec plaisir à Une Capitulación. Richter travaille à la composition. »
La pression excessive exercée par Bismarck sur la Bavière pour qu’elle se joigne à l’Allemagne sans aucune condition déplaît à Wagner, qui souhaiterait une unité non forcée. Ainsi lit-on le 16 novembre : « Wagner déplore que Bismarck ait si peu d’imagination et qu’il ne sache proposer aux autres alliés que leur entrée inconditionnelle dans l’œuvre prussienne. »
Le 18 novembre, une lettre parvient de leur ami Schuré, contenant un texte furieusement pro-français au sujet de l’Alsace. Wagner lui répond par l’intermédiaire de Cosima : « Les Polonais, les Hongrois ou les Irlandais sont demeurés fidèles à leur race malgré la domination russe, autrichienne ou anglaise. L’Alsace doit rester fidèle à son origine allemande. »
Le 30 novembre, une tentative de sortie française depuis Paris échoue.
Dans le Journal du 9 décembre, Cosima revient sur la question du pape et d’une partie de l’Église catholique, favorable à la France en raison du problème romain et de la présence de troupes françaises à Rome contre Garibaldi. Cosima note qu’un mouvement ecclésiastique allemand — une Église allemande libre — serait souhaitable.
Un exemple concret de l’intérêt de Wagner pour une Allemagne unifiée au service de l’Art apparaît dans le Journal de Cosima : elle écrit à la comtesse Bismarck de manière à ce que l’empereur d’Allemagne prenne conscience de la nécessité de soutenir l’art allemand, L’Œuvre d’art de l’avenir.
Même en pleine guerre, la situation évolue : la pression retombe, et même à Paris on ressent le désir d’en finir. Rappelons que c’est précisément cette année-là, le 25 décembre, que Wagner fait jouer l’Idylle de Siegfried à Tribschen.
Le mois de janvier 1871 conduit à la fin du conflit.
Les armées françaises encore en activité sont totalement vaincues. Le 12 janvier 1871, l’armée de la Loire est détruite au Mans. L’armée du Nord tente d’entrer dans Paris le 19 janvier, mais elle est battue à Saint-Quentin et cesse de représenter une menace militaire. L’armée de l’Est est acculée à la frontière suisse et, le 1ᵉʳ février, se rend à la Suisse : 90 000 hommes et tout leur matériel.
Après ces défaites, on tente d’obtenir une capitulation à Paris, mais la Garde nationale et d’autres groupes se soulèvent le 22 janvier pour éviter la reddition. Ils n’obtiennent pas le pouvoir, et l’armistice est signé le 26 janvier, marquant la fin de la guerre.
Cosima formule une opinion singulière sur les Alsaciens qui quittent l’Alsace pour rester français : « Si certains Alsaciens ne veulent pas être allemands, c’est parce qu’il existe encore trop peu de liberté entre les classes en Allemagne. Richard accepte cela et espère que l’unité allemande y mettra fin. »
Le 25 février, Wagner reçoit une lettre de Bismarck le remerciant pour un poème que Wagner lui avait dédié. Cosima est ravie d’en posséder l’autographe : « ce sera un souvenir pour Fidi ».
Les relations se rompent avec Schuré, qui leur écrit qu’il ne retournera jamais en Allemagne : Paris est sa seule patrie.
Le 26 février 1871, l’Allemagne est unifiée.
Le 7 mars, après une frayeur — une fausse rumeur annonçait un attentat contre Bismarck —, on demande à Wagner d’orchestrer sa Marche impériale. Le sujet ne l’intéresse guère, mais il ne peut refuser.
Le 8 mars, des soldats allemands entrent brièvement dans Paris : la paix est signée. Ils défilent un moment seulement sur les principales avenues. Les Français restent silencieux… Wagner dit qu’il ignore s’ils se sont habillés de deuil.
Le 18 mars, il ne reste plus que la Commune de Paris, dirigée par des insurgés, combattue non seulement par les Allemands mais aussi par les troupes françaises du gouvernement.
Wagner et le nationalisme allemand après 1871
 Installé désormais à Bayreuth, Wagner vit ses dernières années dans une Allemagne de plus en plus puissante après la guerre franco-prussienne.
Installé désormais à Bayreuth, Wagner vit ses dernières années dans une Allemagne de plus en plus puissante après la guerre franco-prussienne.
Cette attitude d’appui à l’Allemagne lui vaudra de sérieuses difficultés avec ses admirateurs français… Certains comprennent le sentiment allemand de Wagner, mais éprouvent des difficultés à « se présenter comme wagnériens ». Ce problème fut, dans un premier temps, un véritable frein à l’expansion du wagnérisme en France, sans toutefois altérer les relations personnelles entre wagnériens français et allemands.
On peut interpréter cette question à travers le prisme du « nationalisme », mais pour Wagner, l’enjeu n’était pas là : il raisonnait en termes d’identité, d’art allemand. Il ne rêvait pas « d’empires », mais d’une Allemagne unifiée par un art allemand — ce qui n’empêche en rien qu’il fût nationaliste allemand.
Sa déception envers le pouvoir politique apparaîtra peu à peu :
« Je n’ai aucun préjugé sur la situation actuelle des choses ; je la trouve aussi mauvaise qu’elle peut l’être, et j’attends si peu de l’Allemagne que si j’avais dix ans de moins, j’émigrerais en Amérique. Cependant, lorsque ces messieurs les Français viennent me parler de leurs susceptibilités parce qu’ils ne peuvent supporter qu’on nous rende une province qu’un despote présomptueux nous avait arrachée à une époque où nous ne versions pas notre sang pour notre Foi, alors je leur dis : Que le diable les emporte, il faut battre encore une fois les Français. » (Journal de Cosima, 28 mars 1880.)
On le voit : Wagner est d’une sévérité profonde envers l’Allemagne capitaliste et égoïste, mais radical dans son désir d’unité de tous les Allemands.
L’aspiration de Wagner était que le Reich créât les conditions d’un « Art allemand », favorisant un essor artistique national, absolument nécessaire car l’Allemagne était culturellement colonisée par l’art français et italien, et par une presse capitaliste n’accordant aucun soutien à un art véritablement allemand.
Pure illusion : Bismarck ne s’intéressait ni à l’art ni au spirituel.
Ainsi déclare Wagner le 2 février 1873 :
« Blücher nous dit que Bismarck est inquiet de l’avenir du Reich, et qu’il tente de réformer les relations commerciales. Il ne manque à Bismarck que le sens de l’Idéal, dit Richard : l’absence totale d’intérêt pour les questions artistiques. Croyez-vous que tout cela ne se paiera pas un jour ? »
Mais, comme toujours, le désintérêt de Bismarck pour l’art et la mainmise du capitalisme sur la nouvelle Allemagne conduisent Wagner à exprimer à maintes reprises son dégoût envers l’Allemagne de Bismarck. Il s’en éloigne et se lamente toute sa vie des terribles conditions faites aux ouvriers face à l’usure des financiers.
Les dirigeants ne comprennent rien à la révolution de l’esprit ; ils ne comprennent que l’argent et la gloire… le superficiel…
« Richard me dit le soir : “Je n’ai plus aucune illusion. Quand nous avons quitté la Suisse, je pensais que c’était une heureuse coïncidence que la victoire me permît d’achever mon œuvre ; je me demandais s’il n’y aurait pas mille hommes en Allemagne pour donner chacun 300 marks pour un projet pareil. Quelle misérable réponse j’ai reçue ! Je suis tombé dans la période la plus misérable de l’Allemagne, dirigée par un gardien de porcs. Malgré tout, j’ai pu — ce que personne n’a fait dans l’histoire de l’Art — construire un grand théâtre et attirer les meilleurs artistes dont nous disposions grâce à ma personnalité. Quel fut le résultat ? Ah ! ah ! Je pensais qu’on m’aiderait à combler le déficit… Oui, ils sont venus, les femmes en robes luxueuses, les hommes avec leurs moustaches ; ils se sont amusés et, comme l’Empereur et le Roi étaient là, ils se demandaient : ‘Par Dieu ! que veut de plus Wagner ? Veut-il encore quelque chose ?’.” » (Journal de Cosima, 18 mars 1880.)
On voit donc la constante dans la pensée de Wagner : rechercher ce qui est pur, l’art ; croire qu’une « politique de l’élévation » serait possible ; et se heurter, toujours, à la réalité : les hommes politiques se corrompent, se tournent vers l’argent, n’ont aucun intérêt pour l’Art ni pour l’élévation spirituelle du peuple.
On le voit nettement dans l’évolution de sa position vis-à-vis de Bismarck, de l’espérance à la déception.
« Richard se rend chez le prince Bismarck où il était invité. Il revient très satisfait : les rois de l’ombre l’ont accueilli très aimablement. »
Lorsque Richard exprime son respect, Bismarck lui répond :
« Le seul mérite que j’aie eu envers vous est d’obtenir de temps en temps quelque souscription pour votre projet de Bayreuth, rien de plus. »
Et encore : « Tout ce que j’ai fait, c’est trouver dans la Couronne le trou par lequel laisser sortir la fumée. »
Richard revient consolé par son amabilité et sa simplicité : aucune affectation, un langage accessible, un caractère ouvert, tout en lui inspirait sympathie et confiance.
Mais il ajoute : « Nous ne pouvons que nous observer l’un l’autre, chacun dans sa sphère ; jamais je n’aurais l’idée de chercher une relation directe avec lui, de le gagner à notre cause, de lui demander un soutien. Toutefois, cette rencontre a été pour moi capitale. »
Entre 1876 et 1878, tout a changé : le Reich n’est plus qu’une « entreprise de capitalistes » :
« Hier, nous parlions avec Richard du comportement des gens d’ici : ils ne voient dans les Festivals et dans la venue d’étrangers qu’une occasion de les exploiter. Il n’existe donc nulle part en Allemagne le sentiment de communauté, et avec lui le sens de l’Honneur qu’il implique. » (Journal de Cosima, 26–29 avril 1876.)
« Le temps des génies est achevé, déclare Richard : ‘la vulgarité des clowns — qu’il s’agisse des pitreries estudiantines de Bismarck ou de celles, militaires, du Kronprinz — me répugne.’ Il se remet à Parsifal, et à midi arrive en criant : “Eurêka !”. Quelle joie m’apportent ces mots. Comme nous étions à table avec des invités, je ne pouvais lui demander de quoi il s’agissait ; plus tard, il me dit : “Je l’ai trouvé, c’est très émouvant, tu verras, je ne t’en dis pas davantage.” »
(Journal de Cosima, 28 juillet 1878.)
(Wagner, lorsqu’il travaillait sur Parsifal, s’irritait souvent de ne pas trouver la musique juste ; lorsqu’il y parvenait enfin, il se précipitait au piano avec Cosima.)
Le capitalisme s’empara du pouvoir politique que la révolte romantique et les idéaux identitaires des peuples avaient initiés. Le souffle vital romantique — l’art, la culture, les peuples — portait le même idéal que Wagner, et tous furent trahis par les libéraux qui accédèrent au pouvoir, rétablissant le règne de l’argent, cette fois en version républicaine ou « impériale » — peu importait la forme — mais toujours éloignés de l’idéal humain du romantisme.
Un exemple en est la révolte identitaire et populaire, absolument romantique, du Tyrol menée par Andreas Hofer. Wagner écrit à ce sujet dans le Journal de Cosima, le 16 juin 1874 :
« Certains articles que j’ai lus ces jours-ci sur Andreas Hofer m’ont profondément ému, et je pense que c’est une figure tragique. Richard me dit qu’il avait jadis esquissé une œuvre lyrique sur ce personnage pour Röckel et l’avait divisée en trois actes, comme il est d’usage : le premier acte devait être la réunion clandestine des paysans dans la montagne. Röckel n’en fit rien. »
Andreas Hofer, Tyrolien qui participa à la guerre de Libération, fut livré traîtreusement aux Français jacobins, lesquels l’exécutèrent à Mantoue.
On pourrait en dire autant du soutien de Liszt au mouvement identitaire hongrois de 1848, lui aussi écrasé par les troupes de Vienne, mais qui obtint quelques années plus tard une réelle autonomie de la Hongrie au sein de l’Empire austro-hongrois. Poètes et musiciens, artistes avant tout, furent les véritables chefs de ce mouvement populaire hongrois.
Il existe ainsi un mouvement romantique d’artistes et d’intellectuels qui constitue, en grande partie, la direction populaire des soulèvements nationaux ; mais ce sont les bourgeois et les libéraux, les banquiers et les capitalistes, qui en fin de course accèdent au pouvoir politique. Le mouvement romantique avait besoin de politiciens — de personnes capables de traduire ses idées en actes politiques et de prendre le pouvoir.
« L’Allemand devient paresseux, s’enivre, veut agir comme les Juifs. La fidélité et la Foi sont pour lui devenues des valeurs privées de fondement. La faute principale incombe, certes, à ceux qui nous gouvernent. Tout cela est le destin, et la seule chose qui ne demeure plus à Richard, c’est l’espérance. »
(Journal de Cosima, 27 décembre 1878.)
À propos de Une Capitulation
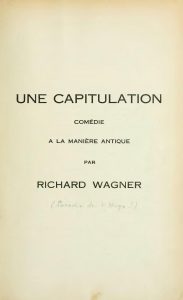 En réalité, Wagner ne composa musicalement que trois œuvres en 1870–1871, et une seule d’entre elles relève du thème nationaliste allemand.
En réalité, Wagner ne composa musicalement que trois œuvres en 1870–1871, et une seule d’entre elles relève du thème nationaliste allemand.
Les deux autres sont :
— la WWW 103, Siegfried-Idyll, Idylle de Siegfried en mi majeur, version originale pour 15 instruments (1870) ;
— la WWW 105, Der Worte viele sind gemacht, On peut faire beaucoup de choses avec des mots, lied humoristique sans accompagnement pour L. Kraft (1871).
Il ne composa donc, à titre expressément patriotique, que la WWW 104, Kaisermarsch, Marche impériale en si♭ majeur avec chœur final (1871), exécutée devant l’Empereur le 5 mai 1871.
On ne peut donc pas affirmer qu’il consacra une production musicale abondante à ce sujet — bien moins, en tout cas, que Verdi au nationalisme italien.
Sur le plan littéraire, il laisse deux œuvres :
— une Ode à Bismarck (1871) ;
— la WWW 102 (1870), Eine Kapitulation. Lustspiel in antiker Manier (Une Capitulation. Comédie à la manière antique), dont seul le texte subsiste, la musique de Richter ayant disparu. L’œuvre ne fut jamais représentée.
Accuser Wagner de cette pièce comique comme d’un écrit politique est donc un contresens délibéré.
J’ai toujours pensé que « le test infaillible » de l’humour d’une personne consiste à savoir rire d’elle-même. Malheur à celui qui se croit spirituel mais ne supporte pas qu’on se moque sincèrement de ses propres défauts.
Il en va ainsi de la parodie que Wagner fit du comportement des Français de Paris durant la fameuse République fantôme de 1871.
À l’automne 1870, il écrit La Capitulation, simple parodie destinée à tourner en ridicule les hommes politiques français… mais aussi certains travers allemands, face aux hystéries de la Commune. Il s’agit d’une satire bouffe à la manière d’Aristophane. Richter en composa la musique ; mais lorsque la situation de la France changea, après la capitulation de Paris en janvier 1871, et que sombra la folie politique « en l’air », Wagner décida de ne pas publier l’ouvrage et Richter détruisit la partition. Une Capitulation demeura donc inédite.
Il s’agit d’une œuvre humoristique, non d’un pamphlet politique. Wagner y tourne en dérision ces politiciens français fanfarons, pleins de prétentions malgré une défaite éclatante, enfermés dans Paris, rêvant et déclamant des discours vides sur des victoires impossibles — jusqu’à Gambetta s’envolant en ballon à la recherche d’une armée… un « gouvernement dans l’air », disait Wagner : non seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré d’un pouvoir flottant sans base réelle.
Mais il s’attaque également aux Allemands : selon lui, si Paris, au lieu de sombrer dans la Commune, avait ouvert ses cafés, ses théâtres, ses opéras, les Allemands se seraient rendus d’eux-mêmes. Ils désiraient tellement imiter « le français » qu’ils auraient succombé à ses séductions, à son « grand monde ».
Dans le prologue de l’œuvre, Wagner écrit :
« Nous autres Allemands, en tentant d’imiter les formes parisiennes, tombons dans un ridicule encore plus profond. »
Nous touchons ici à l’essentiel : deux œuvres ont attiré à Wagner de farouches ennemis : Le Judaïsme dans la musique et Une Capitulation.
Mais ce sont deux thèmes absolument distincts, comme le rappelle fort justement l’auteur.
Si Le Judaïsme dans la musique est un texte sérieux, impossible à analyser sereinement aujourd’hui en raison des hystéries politiques qui l’entourent, Une Capitulation est débarrassée de tout climat polémique : on peut la lire comme une satire visant non pas la France mais certaines misères psychologiques — la fanfaronnade, le fantasme du « grand monde » — et également les propres faiblesses allemandes.
On y croise Victor Hugo (plus raisonnable que d’autres), Gambetta, Favre… des chœurs de la Garde nationale…
La scène se déroule à l’Hôtel de Ville de Paris, en octobre 1870. L’œuvre s’inspire du voyage en ballon de Gambetta : un gouvernement dans les airs.
Écrite en novembre 1870, après ce voyage, elle n’a évidemment rien à voir avec le traité de Versailles ultérieur, mais uniquement avec les hystéries parisiennes qui suivirent Verdun et prolongèrent une guerre déjà insensée, dans un chaos politique irréel.
Le texte, difficile d’accès aujourd’hui, n’a de sens que replacé dans son moment. Personnages, références, allusions : tout cela était connu alors, tout s’est effacé pour nous. La lecture en est aujourd’hui opaque, le comique et la parodie échappent souvent.
Elle ne fut connue en France qu’après 1876, à la suite du premier Festival de Bayreuth. Il est évident que cette œuvre déplut aux Français. Elle ne constitue en rien un motif d’orgueil dans la production de Wagner.
RB
La véritable tragédie de toute guerre demeure : les morts, les veuves, les orphelins, la douleur. Une guerre peut avoir une logique politique ; elle est toujours un échec humain, un désastre pour l’humanité.